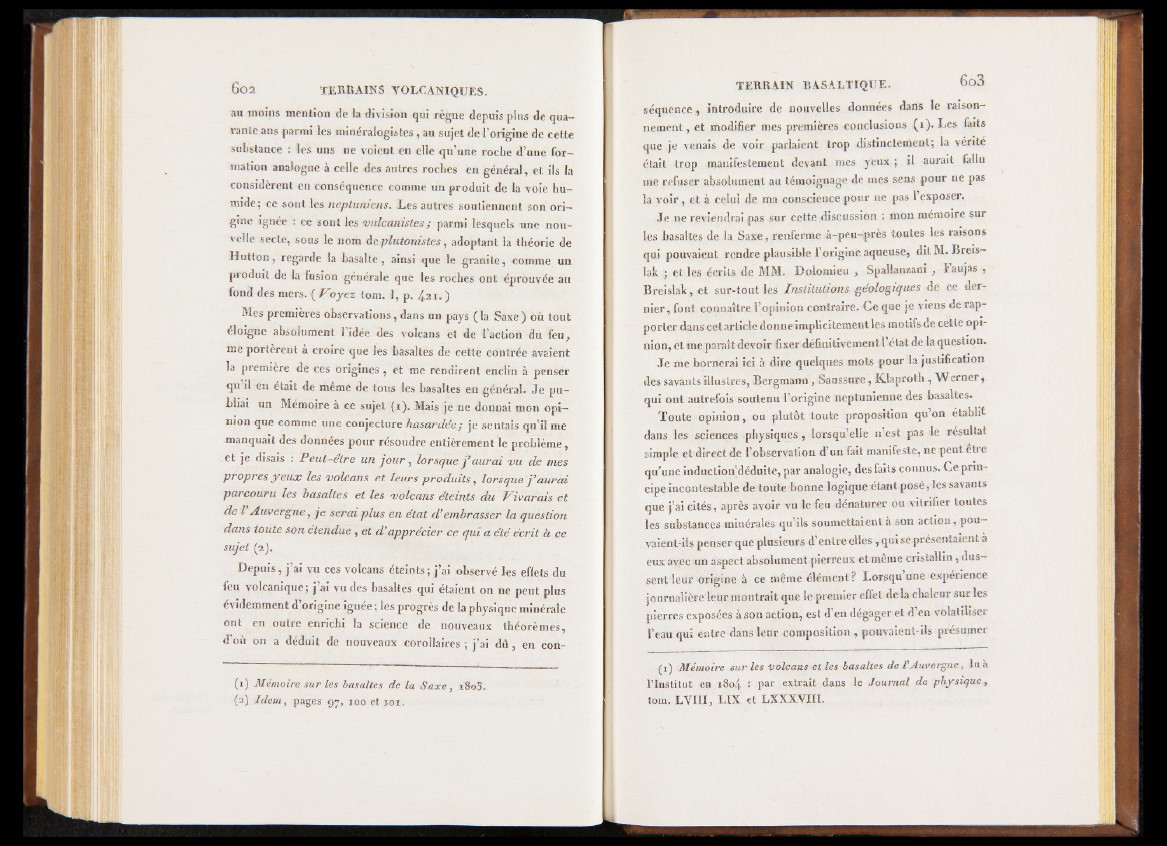
au moins mention de la division qui règne depuis plus de quarante
ans parmi les m inéralogistes, au sujet de l’origine de cette
substance : les uns ne voient en elle qu’une roche d’une formation
analogue à celle des autres roches en général, et ils la
considèrent en conséquence comme un produit de la voie humide;
ce sont les neptuniens. Les autres soutiennent son origine
ignée : ce sont les vulcanistes ; parmi lesquels une nouvelle
secte, sous le nom dcplutonistes, adoptant la théorie de
H u tto n , regarde la basalte, ainsi que le granité, comme un
produit de la fusion générale que les roches ont éprouvée au
fond des mers. ( Voyez tom. I, p. 4.21. )
Mes premières observations, dans un pays ( la Saxe ) où tout
éloigne absolument l’idée des volcans et de l’action du feu,
me portèrent a croire que les basaltes de cette contrée avaient
la première de ces origines , et me rendirent enclin à penser
qu il en était de même de tous les basaltes en général. Je publiai
un Mémoire à ce sujet (1). Mais je ne donnai mon opinion
que comme une conjecture hasardée; je sentais qu’il me
manquait des données pour résoudre entièrement le problèm e,
et je disais : Peut-être un jour, lorsque f aurai vu de mes
propres yeux les volcans et leurs produits, lorsque j ’aurai
parcouru les basaltes et les volcans éteints du Vivarais et
de l Auvergne, je serai plus en état d’embrasser la question
dans toute son étendue , et d’apprécier ce qui a été écrit h ce
sujet (2).
D ep u is, j’ai vu ces volcans éteints; j’ai observé les effets du
feu volcanique, j ai vu des basaltes qui étaient on ne peut plus
évidemment d’origine ignée; les progrès de la physique minérale
ont en outre enrichi la science de nouveaux théorèm es,
d’où on a déduit de nouveaux corollaires ; j’ai dû , en con-
(1) Mémoire sur les basaltes de la S a x e , i 8o3.
(2) Idem, pages 97, 100 et rot.
séquence , introduire de nouvelles données dans le raisonnement
, et modifier mes premières conclusions (1). Les faits
que je venais de voir parlaient trop distinctement; la vérité
était trop manifestement devant mes yeux ; il aurait fallu
me refuser absolument au témoignage de mes sens pour ne pas
la voir , et à celui de ma conscience pour ne pas 1 exposer.
Je ne reviendrai pas sur cette discussion : mon mémoire sur
les basaltes de la S axe, renferme à-peu-près toutes les raisons
qui pouvaient rendre plausible l’origine aqueuse, ditM . B reis-
lak ; et les écrits de MM. D olom ieu , Spallanzani , Faujas ,
Breislak, et sur-tout les Institutions géologiques de ce dernier,
font connaître l’opinion contraire. Ce que je viens de rapporter
dans cet article donne implicitement les motifs de cette opinion,
et me paraît devoir fixer définitivement l’état de la question.
Je me bornerai ici à dire quelques mots pour la justification
des savants illustres, Bergm ann, Saussure, Kdaprofh , AVerner,
qui ont autrefois soutenu l’origine neptunienne des basaltes.
T oute opinion , ou plutôt toute proposition qu on établit
dans les sciences physiques , lorsqu’elle n’est pas le résultat
simple et direct de l’observation d’un fait manifeste, ne peut etie
qu’une induction’déduite, par analogie, des faits connus. C e principe
incontestable de toute bonne logique étant p osé, les savants
que j’ai cités, après avoir vu le feu dénaturer ou vitrifier toutes
les substances minérales qu’ils soumettaient à son action, p ou -
vaient-iis penser que plusieurs d’entre elles , qui se présentaient à
eux avec un aspect absolument pierreux et même cristallin, dussent
leur origine à ce même élément? Lorsqu une expérience
journalière leur montrait que le premier effet de la chaleur sur les
pierres exposées à son action, est d’en dégager et d’en volatiliser
l’eau qui entre dans leur com position , pouvaient-ils présumer 1
(1) Mémoire sur les volcans et les basaltes de VAuvergne, lu à
l’Institut en i8o4 ■ par extrait dans le Journal de p h y s iqu e ,
tom. LVIII, LIX et LXXXVIII.