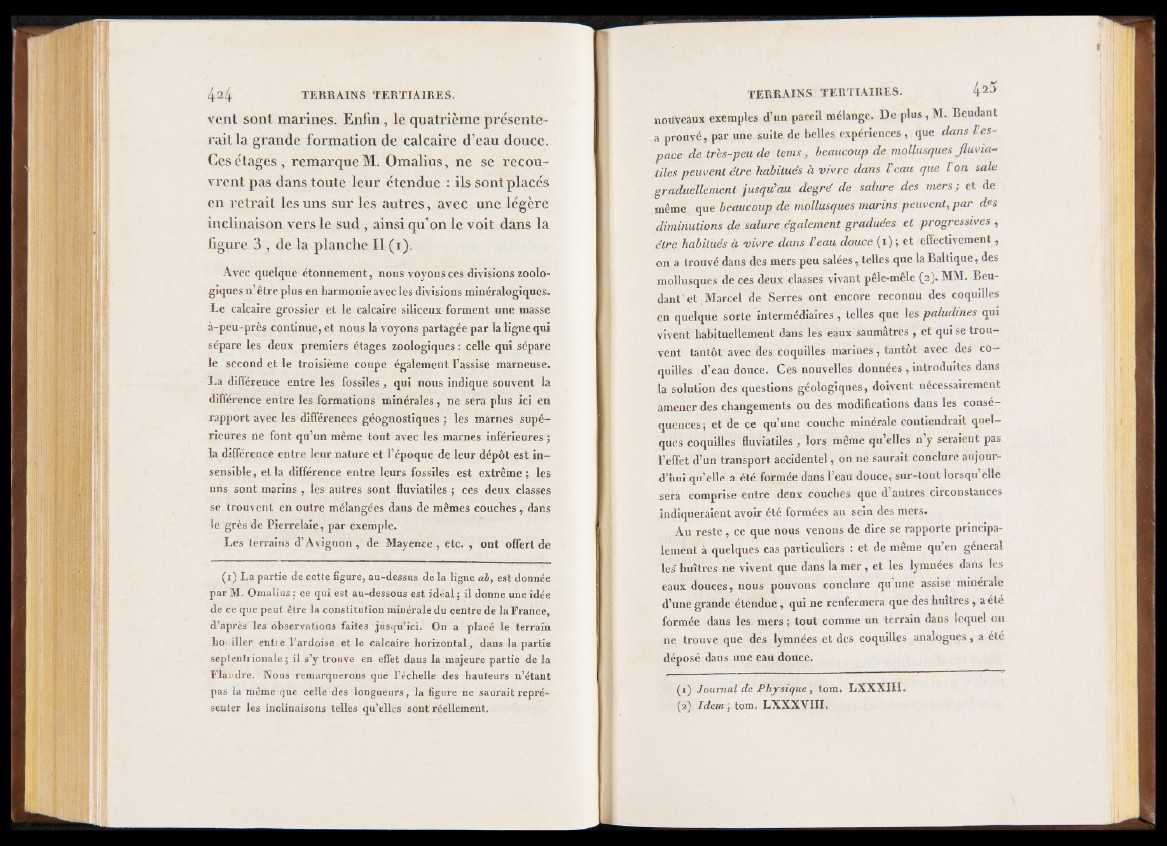
vent sont marines. Enfin , le quatrième présenterait
la grande formation de calcaire d’eau douce.
Ces étages, remarque M. Omalius, ne se recouvrent
pas dans toute leur étendue : ils sont placés
en retrait les uns sur les autres, avec une légère
inclinaison vers le sud , ainsi qu’on le voit dans la
figure 3 , de la planche II (i).
A vec quelque étonnem ent, nous voyons ces divisions zoologiques
n’être plus en harmonie avec les divisions minéralogiques.
L e calcaire grossier et le calcaire siliceux forment une masse
à-peu-près continue, et nous la voyons partagée par la ligne qui
sépare les deux premiers étages zoologiques: celle qui sépare
le second et le troisième coupe également l’assise marneuse.
La différence entre les fossiles, qui nous indique souvent la
diffé rence entre les formations m inérales, ne sera plus ici en
rapport avec les différences géognostiques ; les marnes supérieures
ne font qu’un même tout avec les marnes inférieures ;
la différence entre leur nature et l’époque de leur dépôt est insensible,
et la différence entre leurs fossiles est extrême ; les
uns sont marins , les autres sont fluviatiles ; ces deux classes
se trouvent en outre mélangées dans de mêmes cou ch es, dans
le grès de Pierrelaie, par exemple.
Les terrains d’A vignon , de Mayence , etc. , ont offert de
(1) La partie de cette figure, au-dessus de la ligne ah, est donnée
par M. Omalius ; ce qui est au-dessous est idéal ; il donne une idée
de ce que peut être la constitution minérale du centre de la France,
d’après les observations faites jusqu’ici. On a placé le terrain
hot iller entre l’ardoise et le calcaire horizontal, dans la partie
septentrionale ; il s’y trouve en effet dans la majeure partie de la
Flandre. Nous remarquerons que l’échelle des hauteurs n’étant
pas la même que celle des longueurs, la figure ne saurait représenter
les inclinaisons telles qu’elles sont réellement.
nouveaux exemples d’un pareil mélange. D e p lu s, M. Beudant
a prouvé, par une suite de belles expériences , que dans l'espace
de très-peu de tems , beaucoup de mollusques jluvia-
tiles peuvent être habitués à vivre dans Veau que Ion sale
graduellement jusqu'au degré de salure des mers ; et de
même que beaucoup de mollusques marins peuvent, par des
diminutions de salure également graduées et progressives ,
être habitués à vivre dans Veau douce ( 1 ) ; et effectivem ent,
on a trouvé dans des mers peu salées, telles que la B altique, des
mollusques de ces deux classes vivant pêle-mêle (2). MM. B eudant'
et ; Marcel de Serres ont encore reconnu des coquilles
en quelque sorte intermédiaires, telles que les paludines qui
vivent habituellement dans les eaux saumatres , et qui se trouvent
tantôt avec des coquilles marines, tantôt avec des coquilles
d’eau douce. C es nouvelles données , introduites dans
la solution des questions géologiques, doivent nécessairement
amener des changements ou des modifications dans les conséquences;
et de ce qu’une couche minérale contiendrait quelques
coquilles fluviatiles, lors même qu’elles n’y seraient pas
l’effet d’un transport accidentel, on ne saurait conclure aujourd’hui
qu’elle a été formée dans l’eau douce, sur-tout lorsqu’elle
sera comprise entre deux couches que d’autres circonstances
indiqueraient avoir été formées au sein des mers.
A u re ste, ce que nous venons de dire se rapporte principalement
à quelques cas particuliers : et de même qu’en général
les' huîtres ne vivent que dans la mer , et les lymnées dans les
eaux douces, nous pouvons conclure qu’une assise minérale
d’une grande éten du e, qui ne renfermera que des hu îtres, a été
formée dans les mers ; tout comme un terrain dans lequel on
ne trouve que des lymnées et des coquilles analogues, a été
déposé dans une eau douce.
(1) Journal de Physique , tom. LXXXIII.
(2) Idem, tom. LX X X Y III.