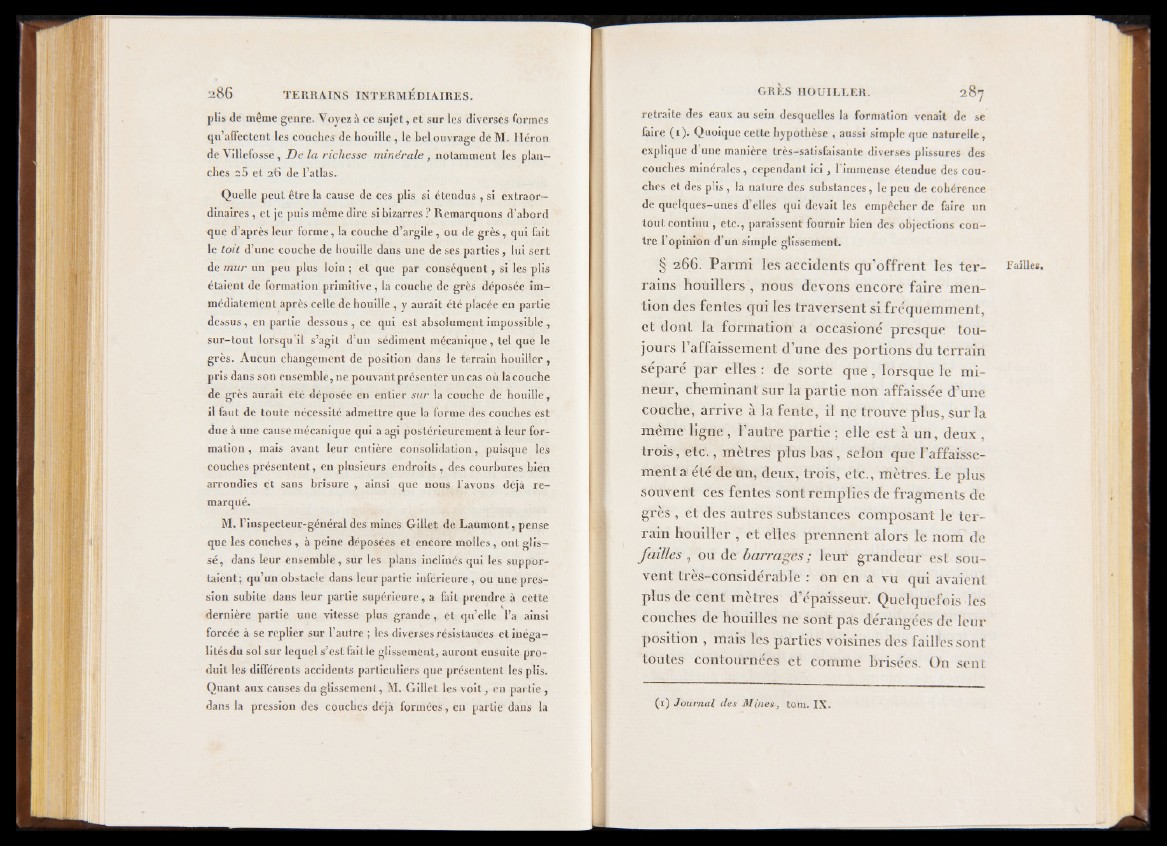
plis de même genre. Voyez à ce sujet, et sur les diverses formes
qu’affectent les couches de houille, le hel ouvrage de M. Héron
de Villefosse, D e là richesse minérale, notamment les planches
s 5 et 26 de l’atlas.
Quelle peut être la cause de ces plis si étendus , si extraordinaires
, et je puis même dire si bizarres ? Remarquons d’abord
que d’après leur forme, la couche d’argile, ou de grès, qui fait
le toit d’une couche de houille dans une de ses parties, lui sert
de mur un peu plus loin ; et que par conséquent, si les plis
étaient de formation primitive , la couche de grès déposée immédiatement
après celle de houille , y aurait été placée en partie
dessus, en partie dessous , ce qui est absolument impossible ,
sur-tout lorsqu’il s’agit d’un sédiment mécanique, tel que le
grès. Aucun changement de position dans le terrain houiller,
pris dans son ensemble, ne pouvant présenter un cas où lacouche
de grès aurait été déposée en entier sur la couche de houille,
il faut de toute nécessité admettre que la forme des couches est
due à une cause mécanique qui a agi postérieurement à leur formation
, mais avant leur entière consolidation, puisque les
couches présentent, en plusieurs endroits , des courbures bien
arrondies et sans brisure , ainsi que nous l’avons déjà remarqué.
M. l’inspecteur-général des mines Gillet de Laumont, pense
que les couches , à peine déposées et encore molles, ont glissé,
dans leur ensemble, sur les plans inclinés qui les supportaient;
qu’un obstacle dans leur partie inférieure, ou une pression
subite dans leur partie supérieure, a fait prendre à cette
dernière partie une vitesse plus grande, et quelle l’a ainsi
forcée à se replier sur l’autre ; les diverses résistances etinéga-
lilésdu sol sur lequel s’est faitle glissement, auront ensuite produit
les différents accidents particuliers que présentent les plis.
Quant aux causes du glissement, M. Gillet les voit, en partie ,
dans la pression des couches déjà formées, en partie dans la
retraite des eaux au sein desquelles la formation venait de se
faire (1). Quoique cette hypothèse , aussi simple que naturelle,
explique d’une manière très-satisfaisante diverses plissures des
couches minérales, cependant ic i, l’immense étendue des couches
et des plis, la nature des substances, le peu de cohérence
de quelques-unes d’elles qui devait les empêcher de faire un
tout continu , etc., paraissent fournir bien des objections contre
l’opinion d’un simple glissement.
§ 266. Parmi les accidents qu’offrent les terrains
houillers , nous devons encore faire mention
des fentes qui les traversent si fréquemment,
et dont la formation a occasioné presque toujours
l’affaissement d’une des portions du terrain
séparé par elles : de sorte que, lorsque le mineur,
cheminant sur la partie non affaissée d’une
couche, arrive à la fente, il ne trouve plus, sur la
meme ligne, l’autre partie ; elle est à un, deux ,
trois, etc., mètres plus bas, selon que l ’affaissement
»été de un, deux, trois, etc., mètres. Le plus
souvent ces fentes sont remplies de fragments de
grès , et des autres substances composant le terrain
houiller , et elles prennent alors le nom de
failles , ou de barrages; leur grandeur est souvent
très-considérable : on en a vu qui avaient
plus de cent mètres d’épaisseur. Quelquefois les
couches de houilles ne sont pas dérangées de leur
position , mais les parties voisines des failles sont
toutes contournées et comme brisées. On sent 1
Failles.
(1) Journal des Mines, tom. IX.