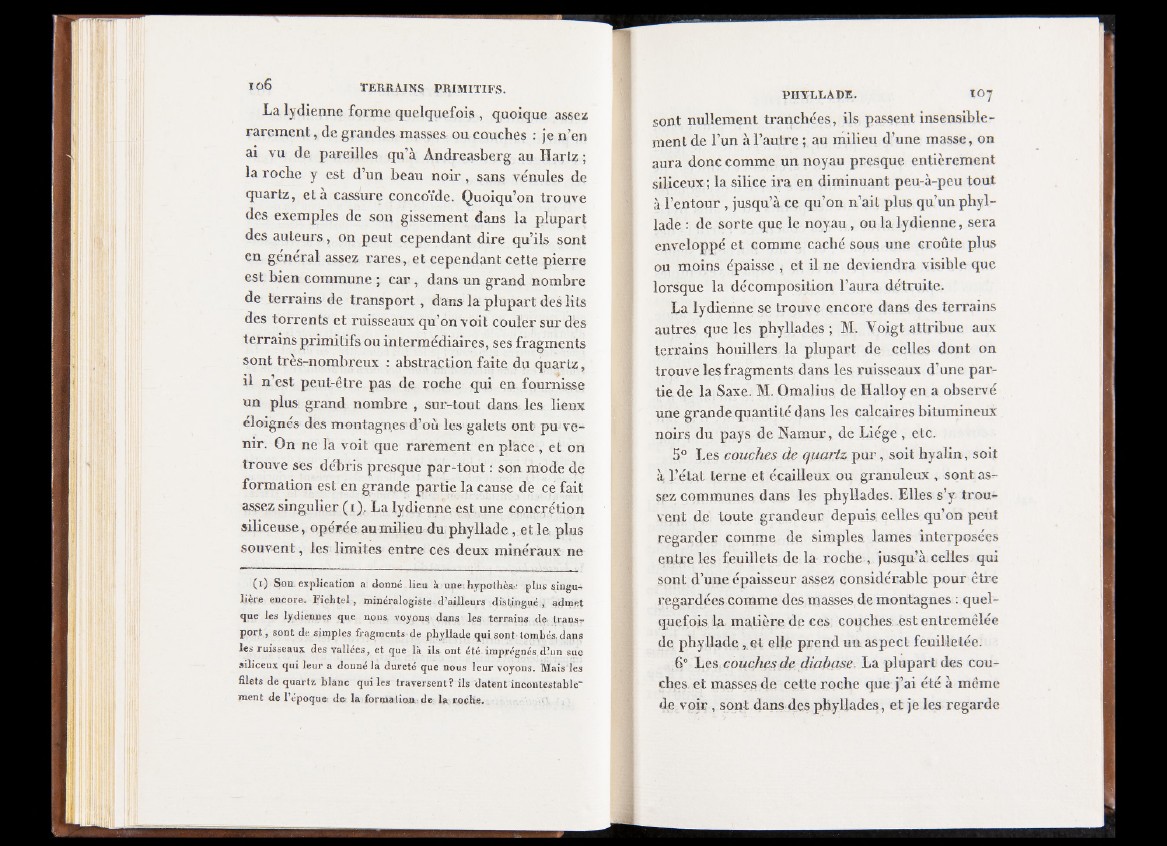
La lydienne forme quelquefois , quoique assez
rarement, de grandes masses ou couches : je n’en
ai vu de pareilles qu’à Andreasberg au Hartz ;
la roche y est d’un beau noir, sans vénules de
quartz, et a cassure concoïde. Quoiqu’on trouve
des exemples de son gissement dans la plupart
des auteurs , on peut cependant dire qu’ils sont
en general assez rares, et cependant cette pierre
est bien commune ; car, dans un grand nombre
de terrains de transport, dans la plupart des lits
des torrents et ruisseaux qu’on voit couler sur des
terrains primitifs ou intermédiaires, ses fragments
sont très-nombreux : abstraction faite du quartz,
il n’est peut-être pas de roche qui en fournisse
un plus grand nombre , sur-tout dans les lieux
éloignés des montagnes d’où les galets ont pu venir.
On ne la voit que rarement en place , et on
trouve ses débris presque par-tout : son mode de
formation est en grande partie la cause de ce fait
assez singulier (i), La lydienne est une concrétion
siliceuse, opérée au milieu du phyllade , et le plus
souvent, les limites entre ces deux minéraux ne
(i) Sx)a explication a donné lieu à une:hypothèse plus singulière
encore. Fichtel, minéralogiste (bailleurs distingué , admet
que les lydiennes que nous voyons dans les terrains de transr
port, sont de simples fragments de phyllade qui sont’tombés, dans
les ruisseaux des vallées, et que là ils ont été. imprégnés dîun suc
siliceux qui leur a donné la dureté que nous leur voyons. Mais les
filets de quartz blanc qui les traversent? ils datent incontestable"
ment de l’époque: de la formalion de la roche. ■'
sont nullement tranchées , ils passent insensiblement
de l’un à l’autre ; au milieu d’une masse, on
aura donc comme un noyau presque entièrement
siliceux ; la silice ira en diminuant peu-à-peu tout
à l’entour , jusqu’à ce qu’on n’ait plus qu’un phyllade
: de sorte que le noyau , ou la lydienne, sera
enveloppé et comme caché sous une croûte plus
ou moins épaisse , et il 11e deviendra visible que
lorsque la décomposition l’aura détruite.
La lydienne se trouve encore dans des terrains
autres que les phyllades ; M. Yoigt attribue aux
terrains houillers la plupart de celles dont on
trouve les fragments dans les ruisseaux d’une partie
de la Saxe. M. Omalius de Halloy en a observé
une grande quantité dans les calcaires bitumineux
noirs du pays de Namur, de Liège , etc.
5° Les couches de quartz, pur, soit hyalin, soit
à l ’état terne et écailleux ou granuleux , sont assez
communes dans les phyllades. Elles s’y trouvent
de toute grandeur depuis celles qu’on peut
regarder comme de simples lames interposées
entre les feuillets de la roche , jusqu’à celles qui
sont d’une épaisseur assez considérable pour être
regardées comme des masses de montagnes : quelquefois
la matière de ces couches est entremêlée
de phyllade, et elle prend un aspect feuilletée.
6° Les couches de diahase. La plupart des couches
et masses de cette roche que j’ai été à même
de voir , sont dans des phyllades, et je les regarde