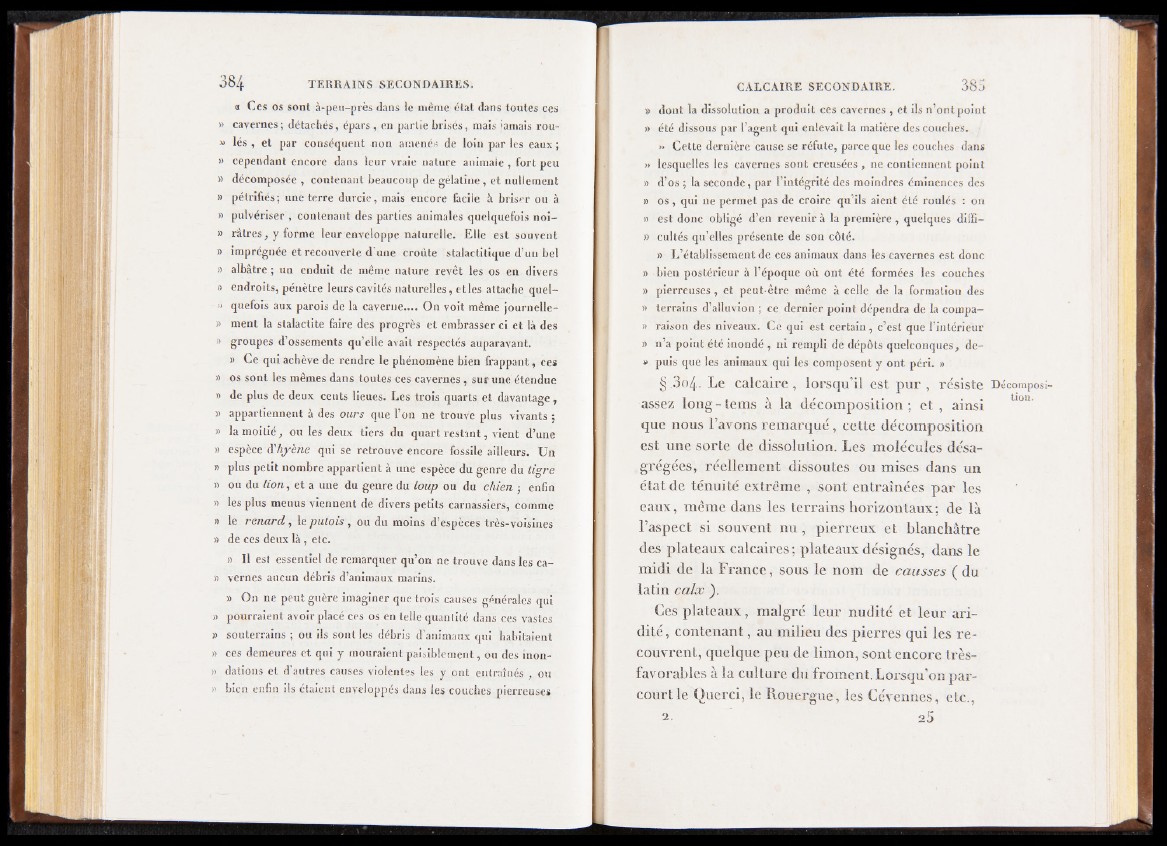
TERRAINS 384 SECONDAIRES.
a Ces os sont à-peu-près dans le même état dans toutes ces
» cavernes ; détachés, épars, en partie brisés, mais iamais rou-
» lés , et par conséquent non amenés de loin par les eaux ;
» cependant encore dans leur vraie nature animale , fort peu
» décomposée , contenant beaucoup de gélatine, et nullement
» pétrifiés; une terre durcie, mais encore facile à briser ou à
» pulvériser , contenant des parties animales quelquefois noi-
» ràtres, y forme leur enveloppe naturelle. Elle est souvent
» imprégnée et recouverte d’une croûte stalactitique d’un bel
» albâtre; un enduit de même nature revêt les os en divers
» endroits, pénètre leurs cavités naturelles, et les attache quel-
» quefois aux parois de la caverne.... On voit même journelle-
» ment la stalactite faire des progrès et embrasser ci et là des
» groupes d’ossements qu’elle avait respectés auparavant.
» Ce qui achève de rendre le phénomène bien frappant, ces
» os sont les mêmes dans toutes ces cavernes , sur une étendue
» de plus de deux cents lieues. Les trois quarts et davantage,
» appartiennent à des ours que l’on ne trouve plus vivants ;
» la moitié, ou les deux tiers du quart restant, vient d’une
» espèce à'hyène qui se retrouve encore fossile ailleurs. Un
a plus petit nombre appartient à une espèce du genre du tigre
» ou du lion, et à une du genre du loup ou du chien ; enfin
» les plus menus viennent de divers petits carnassiers, comme
# le renard , le putois , ou du moins d’espèces très-voisines
» de ces deux là , etc.
» Il est essentiel de remarquer qu’ on ne trouve dans les ca-
» vernes aucun débris d’animaux marins.
» On ne peut guère imaginer que trois causes générales qui
» pourraient avoir placé ces os en telle quantité dans ces vastes
» souterrains ; ou ils sont les débris d’animaux qui habitaient
» ces demeures et qui y mouraient paisiblement, ou des înon-
» dations et d’autres causes violentes les y ont entraînés , ou
» bien enfin ils étaient enveloppés dans les couches pierreuses
CALCAIRE SECONDAIRE. 385
» dont la dissolution a produit ces cavernes , et ils n’ont point
» été dissous par l’agent qui enlevait la matière des couches.
» Cette dernière cause se réfute, parce que les couches dans
» lesquelles les cavernes sont creusées , ne contiennent point
» d’os ; la seconde, par l’intégrité des moindres éminences des
» os , qui ne permet pas de croire qu'ils aient été roulés : on
» est donc obligé d’en revenir à la première, quelques diffi-
» cultés qu’elles présente de son côté.
» L ’établissement de ces animaux dans les cavernes est donc
» bien postérieur à l’époque où ont été formées les couches
» pierreuses, et peut être même à celle de la formation des
» terrains d’alluvion ; ce dernier point dépendra de la compa-
» raison des niveaux. Ce qui est certain , c’est que l’intérieur
» n’a point été inondé , ni rempli de dépôts quelconques, de-
» puis que les animaux qui les composent y ont péri. »
§ .3o4- Le calcaire , lorsqu’il est pur , résiste Décomposi-
assez long - tems à la décomposition ; e t , ainsi
que nous l’avons remarqué, cette décomposition
est une sorte de dissolution. Les molécules désagrégées,
réellement dissoutes ou mises dans un
état de ténuité extrême , sont entraînées par les
eaux, même dans les terrains horizontaux; de là
l ’aspect si souvent nu, pierreux et blanchâtre
des plateaux calcaires ; plateaux désignés, dans le
midi de la France, sous le nom de causses ( du
latin calx ).
Ces plateaux, malgré leur nudité et leur aridité,
contenant, au milieu des pierres qui les recouvrent,
quelque peu de limon, sont encore très-
favorables à la culture du froment. Lorsqu’on parcourt
le Querci, le Pvouergue, les Cévennes, etc.,