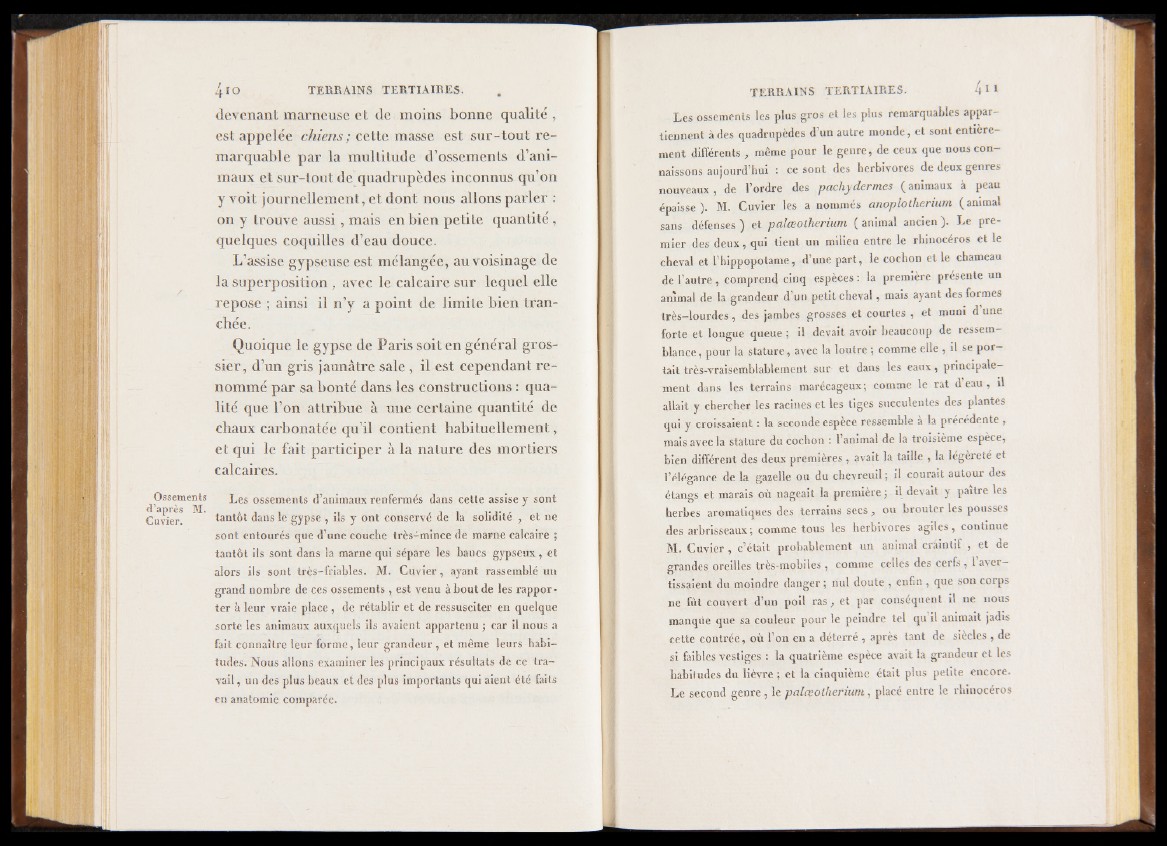
devenant marneuse et de moins bonne qualité ,
est appelée chiens ; cette masse est sur-tout remarquable
par la multitude d’ossements d’animaux
et sur-tout de quadrupèdes inconnus qu’on
y voit journellement, et dont nous allons parler :
on y trouve aussi, mais en bien petite quantité,
quelques coquilles d’eau douce.
L’assise gypseuse est mélangée, au voisinage de
la superposition * avec le calcaire sur lequel elle
repose ; ainsi il n’y a point de limite bien tranchée.
Quoique le gypse de Paris soit en général grossier,
d’un gris jaunâtre sale , il est cependant renommé
par sa bonté dans les constructions : qualité
que l’on attribue à une certaine quantité de
chaux carbonatée qu’il contient habituellement,
et qui le fait participer à la nature des mortiers
calcaires.
Ossements
d’après M.
Cuvier.
Les ossements d’animaux renfermés dans cette assise y sont
tantôt dans le gypse , ils y ont conservé de la solidité , et ne
sont entourés que d’une couche très-mince de marne calcaire ;
tantôt ils sont dans la marne qui sépare les bancs gypseux, et
alors ils sont très-friables. M. C u vier, ayant rassemblé un
grand nombre de ces ossements , est venu à bout de les rapporter
à leur vraie place , de rétablir et de ressusciter en quelque
sorte les animaux auxquels ils avaient appartenu ; car il nous a
fait connaître leur form e, leur grandeur , et même leurs habitudes.
N ous allons examiner les principaux résultats de ce travail
, un des plus beaux et des plus importants qui aient été faits
en anatomie comparée.
Les ossements les plus gros et les plus remarquables appartiennent
à des quadrupèdes d’un autre m onde, et sont entièrement
différentsf> même pour le genre, de ceux que nous connaissons
aujourd’hui : ce sont des herbivores de deux genres
nouveaux, de l’ordre des pachydermes (animaux à peau
épaisse ). M. Cuvier les a nommés anoplotherium (animal
sans défenses ) et paloeotherium ( animal ancien ). Le premier
des d eu x, qui tient un milieu entre le rhinocéros et le
cheval et l’hippopotame, d’une part, le cochon et le chameau
de l’autre, comprend cinq espèces : la première présente un
animal de la grandeur d’un petit ch eval, mais ayant des formes
très-lou rd es, des jambes grosses et courtes , et muni d une
forte et longue queue ; il devait avoir beaucoup de ressemblance,
pour la stature, avec la loutre ; comme elle , il se portait
très-vraisemblablement sur et dans les eau x, principalement
dans les terrains marécageux; comme le rat d’eau , il
allait y chercher les racines et les tiges succulentes des plantes
qui y croissaient : la seconde espece ressemble a la précédente ,
mais avec la stature du cochon : l’animal de la troisième espèce,
bien différent des deux premières , avait la taille , la légeieté et
l’élégance de la gazelle ou du chevreuil ; il courait autour des
étangs et marais où nageait la première ; il devait y paître les
herbes aromatiques des terrains sec s, ou brouter les pousses
des arbrisseaux; comme tous les herbivores agiles, continue
M. Cuvier , c’était probablement un animal crâintif , et de
grandes oreilles très-mobiles , comme celles des cerfs, 1 avertissaient
du moindre danger ; nul doute , enfin , que son corps
ne fût couvert d’un poil ras, et par conséquent il ne nous
manque que sa couleur pour le peindre tel qu il animait jadis
cette contrée, où l’on en a déterré , après tant de siècles , de
si faibles vestiges : la quatrième espèce avait la grandeur et les
habitudes du lièvre ; et la cinquième était plus petite encore.
Le second gen re, le paloeotherium, placé entre le rhinocéros