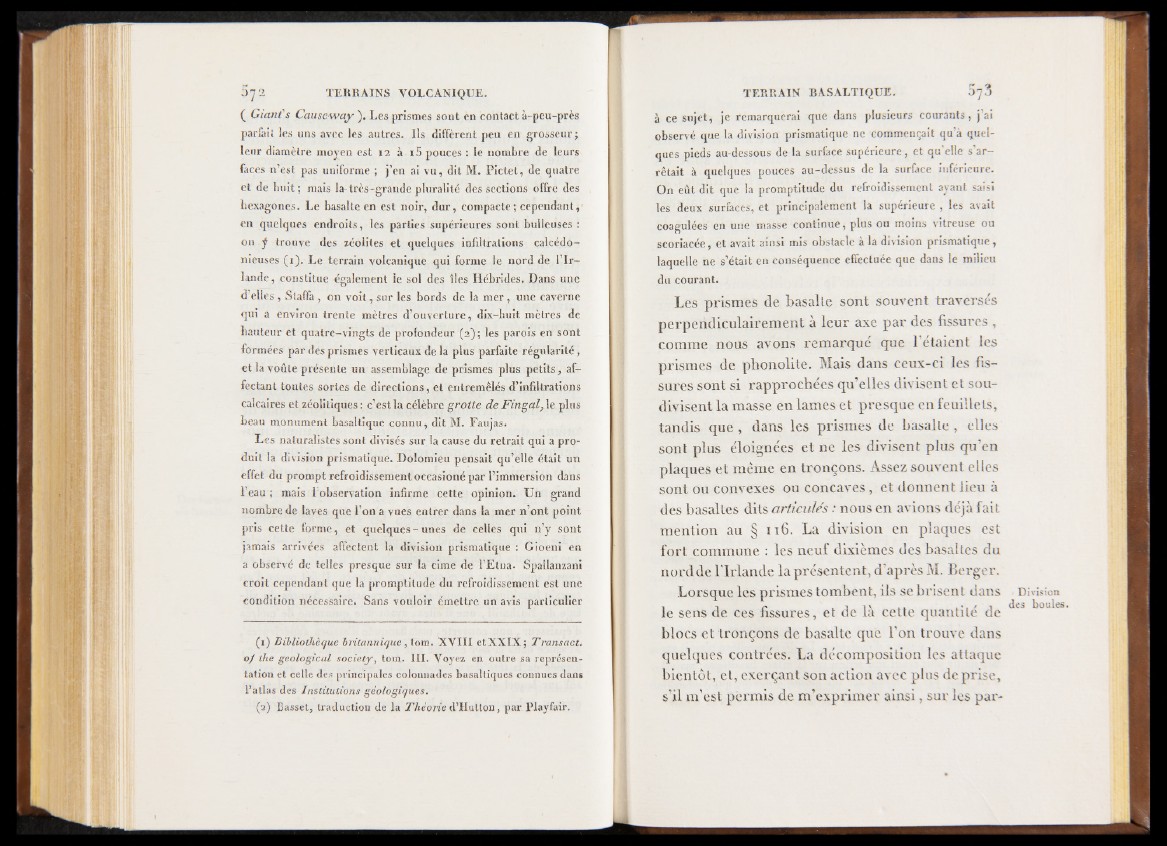
( Giant's Causeway ). Les prismes sont èn contact à-peu-près
parfaii les uns avec les autres. Ils diffèrent peu en grosseur ;
leur diamètre moyen est 12 à i 5 pouces : le nombre de leurs
faces n’est pas uniforme ; j’en ai vu, dit M. Pictet, de quatre
et de nuit ; mais la-très-grande pluralité des sections offre des
hexagones. Le basalte en est noir, dur, compacte; cependant,
en quelques endroits, les parties supérieures sont bulleuses :
on ÿ trouve des zéolites et quelques infiltrations calcédo-
nieuses (1). Le terrain volcanique qui forme le nord de l’Irlande,
constitue également le sol des îles Hébrides, Dans une
d’elles, Staffa, on voit, sur les bords de la mer, une caverne
qui a environ trente mètres d’ouverture, dix-huit mètres de
hauteur et quatre-vingts de profondeur (2); les parois en sont
formées par des prismes verticaux de la plus parfaite régularité,
et la voûte présente un assemblage de prismes plus petits, affectant
toutes sortes de directions, et entremêlés d’infiltrations
calcaires et zéolitiques : c’est la célèbre grotte de Fingal, le plus
beau monument basaltique connu, dit M. Faujas.
Les naturalistes sont divisés sur la cause du retrait qui a produit
la division prismatique. Dolomieu pensait qu’elle était un
effet du prompt refroidissement occasioné par l’immersion dans
l’eau ; mais 1 observation infirme cette opinion. Un grand
nombre de laves que l’on a vues entrer dans la mer n’ont point
pris cette forme, et quelques-unes de celles qui n’y sont
jamais arrivées affectent la division prismatique : Gioeni en
a observé de telles presque sur la cime de l’Etna. Spallanzani
croit cependant que la promptitude du refroidissement est une
condition nécessaire. Sans vouloir émettre un avis particulier 1
(1) Bibliothèque britannique, torn. X V III et X X IX ; Transact,
0/ the geological society, tom. III. Voyez en outre sa représentation
et celle des principales colonnades basaltiques connues dans
l’ atlas des Institutions géologiques.
(2) Basset, traduction de la Théorie d’Hutton, par Playfair.
à ce sujet, je remarquerai que dans plusieurs courants, j’ai
observé que la division prismatique ne commençait qu’à quelques
pieds au-dessous de la surface supérieure, et qu’elle s’arrêtait
à quelques pouces au-dessus de la surface inférieure.
On eût dit que la promptitude du refroidissement ayant saisi
les deux surfaces, et principalement la supérieure , les avait
coagulées en une masse continue, plus ou moins vitreuse ou
scoriacée, et avait ainsi mis obstacle à la division prismatique,
laquelle ne s’était en conséquence effectuée que dans le milieu
du courant.
Les prismes de basal le sont souvent traversés
perpendiculairement à leur axe par des fissures ,
comme nous avons remarqué que l ’étaient les
prismes de phonolite. Mais dans ceux-ci les fissures
sont si rapprochées qu’elles divisent et sou-
divisent la masse en lames et presque en feuillets,
tandis que , dans les prismes de basalte, elles
sont plus éloignées et ne les divisent plus qu’en
plaques et même en tronçons. Assez souvent elles
sont ou convexes ou concaves, et donnent lieu à
des basaltes dits articulés : nous en avions déjà fait
mention au § 116. La division en plaques est
fort commune : les neuf dixièmes des basaltes du
nord de l'Irlande la présentent, d’après M. Berger.
Lorsque les prismes tombent, ils se brisent dans
le sens de ces fissures, et de là cette quantité de
blocs et tronçons de basalte que l’on trouve dans
quelques contrées. La décomposition les attaque
bientôt, et, exerçant son action avec plus de prise,
s’il m’est permis de m’exprimer ainsi, sur les par-
Division
des boules.