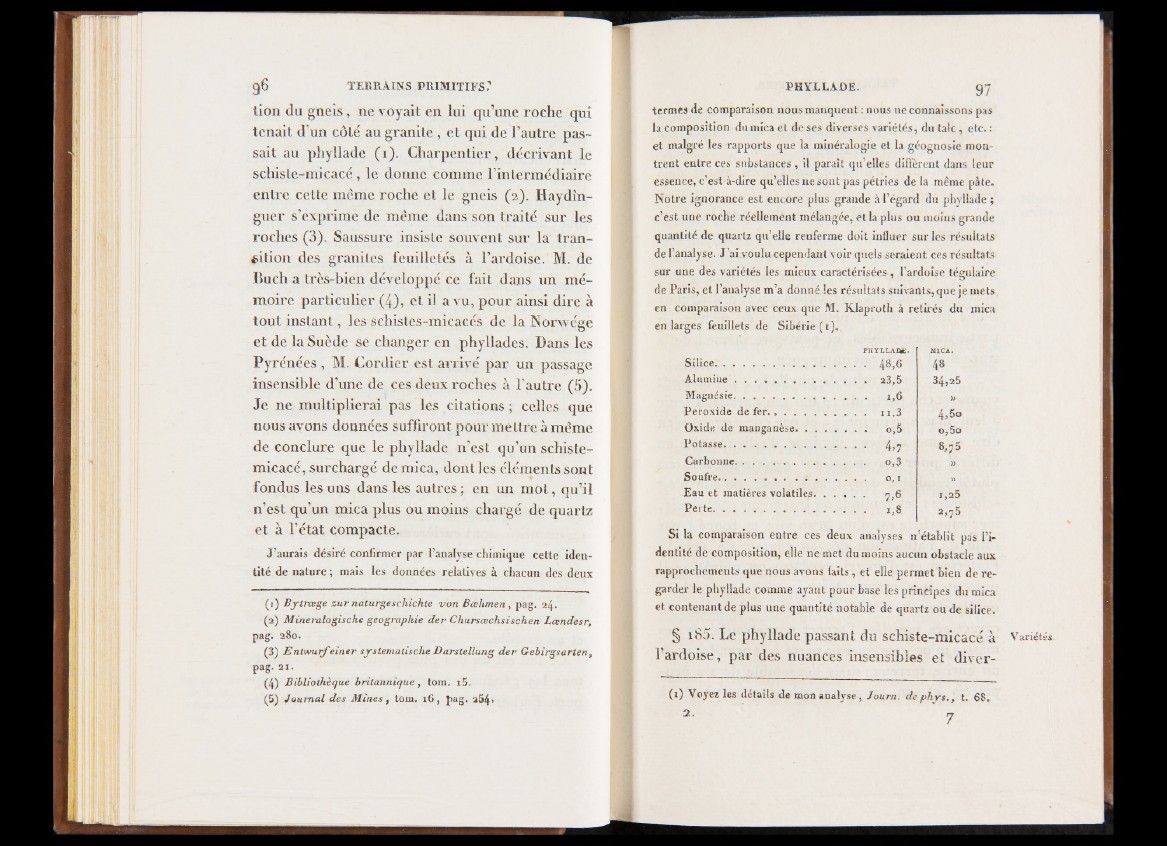
tion du gneis, ne voyait en lui qu’une roche qui
tenait d'un côté au granité , et qui de l’autre passait
au phyllade (i). Charpentier, décrivant le
schiste-micacé , le donne comme l’intermédiaire
entre cette même roche et le gneis (2). Haydîn-
guer s’exprime de même dans son traité sur les
roches (3). Saussure insiste souvent sur la transition
des grandes feuilletés à l’ardoise. M. de
Buch a très-bien développé ce fait dans un mémoire
particulier (4), et il a vu, pour ainsi dire à
tout instant, les schistes-micacés de la Norwége
et de la Suède se changer en phyllades. Dans les
Pyrénées , M. Cordier est arrivé par un passage
insensible d’une de ces deux roches à l’autre (5).
Je ne multiplierai pas les citations ; celles que
nous avons données suffiront pour me ttre à même
de conclure que le phyllade n’est qu’un schiste-
micacé, surchargé de mica, dont les éléments sont
fondus les uns dans les autres ; en un mot, qu’il
n’est qu’un mica plus ou moins chargé de quartz
et à l’état compacte.
J ’aurais désiré confirmer par l’analyse chimique cette identité
de nature ; mais les données relatives à chacun des deux 1 2 3 4 5
(1) Bytroege zur naturgeschîchte von Boehmen, pag. 24.
(2) Mineralogische géographie der Chursoechsischen Loendesr,
pag. 280.
(3) Entwurfeiner syslematische Darstellung der Gebirgsarten,
pag. 21.
(4) Bibliothèque britannique, tom. i 5.
(5) Journal des Mines, tom. 16 , pag. a54>
termes de comparaison nous manquent : nous ne connaissons pas
la composition du mica et de ses diverses variétés, du talc, etc.:
et malgré les rapports que la minéralogie et la géognosie montrent
entre ces substances, il paraît qu’elles diffèrent dans leur
essence, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas pétries de la même pâte.
Notre ignorance est encore plus grande à l’égard du phyllade ;
c’est une roche réellement mélangée, et la plus ou moins grande
quantité de quartz qu’elle renferme doit influer sur les résultats
de l’analyse. J ’ai voulu cependant voir quels seraient ces résultats
sur une des variétés les mieux caractérisées, l’ardoise tégulaire
de Paris, et l’analyse m’a donné les résultats suivants, que je mets
en comparaison avec ceux que M. Klaproth à retirés du mica
en larges feuillets de Sihéi’ie (i) ,
FHYLLAH£.
Silice.'........................ 48,6
Alumine .............................. . . 23,5
Magnésie.......................... 1,6
Peroxide de fer................................ n ,3
Oxide de manganèse....................... o,5
Potasse.................................... 4)7
Carbonne.......................................... o,3
Soufre............................. o, t
Eau et matières volatiles................ 7,6
Perte. ............................................... 1,8
MICA.
48
34,25
»
4, 5°
o,5o
8.75
))
»
1,25
2.75
Si la comparaison entre ces deux analyses n’établit pas l’identité
de composition, elle ne met du moins aucun obstacle aux
rapprochements que nous avons faits, et elle, permet bien de regarder
le phyllade comme ayant pour base les principes du mica
et contenant de plus une quantité notable de quartz ou de silice.
§ 180. Le phyllade passant du schiste-micacé à
l’ardoise, par des nuances insensibles et diver-
(1) Voyez les détails de mon analyse, Journ. depky s., t. 68.
2. 7
Variétés.