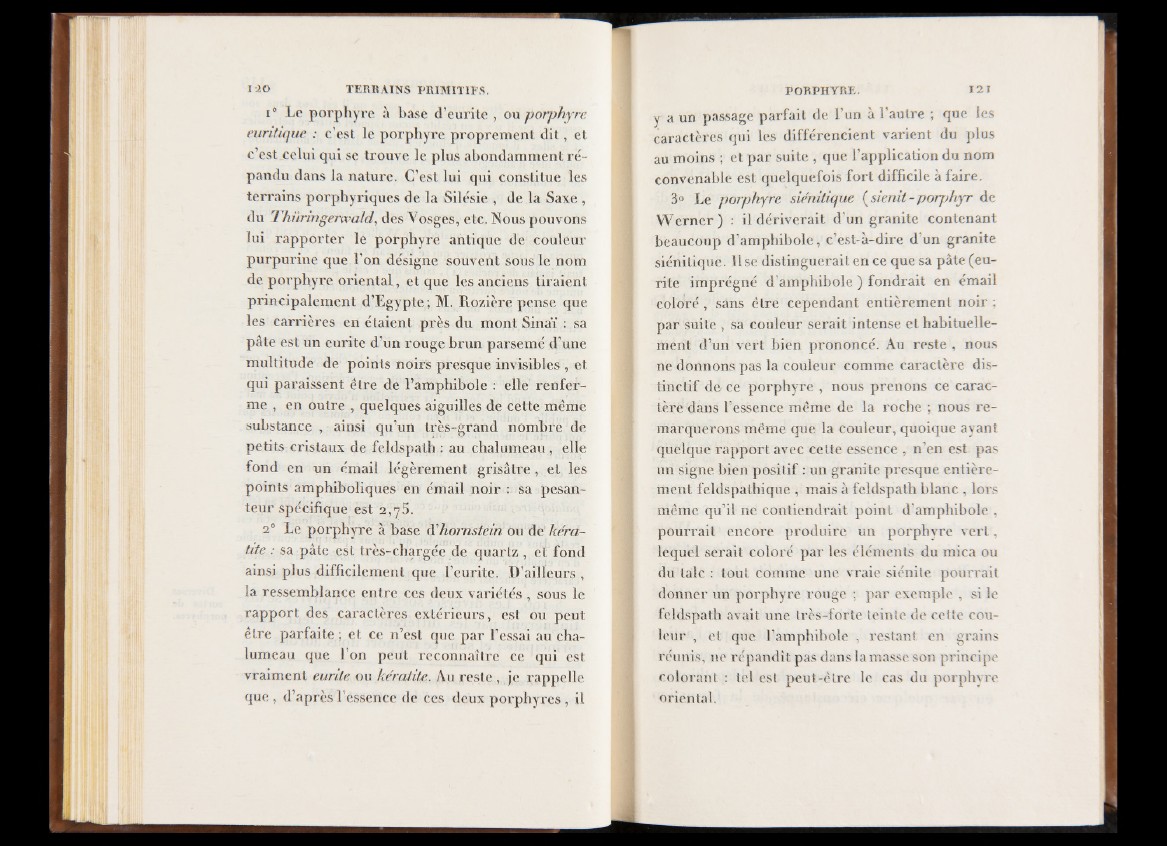
i° Le porphyre à base d’eurite , ou porphyre
euritique : c’est le porphyre proprement dit, et
c’est celui qui se trouve le plus abondamment répandu
dans la nature. C’est lui qui constitue les
terrains porphyriques de la Silésie , de la Saxe ,
du Thürmgerwald, des Vosges, etc. Nous pouvons
lui rapporter le porphyre antique de couleur
purpurine que l’on désigne souvent sous le nom
de porphyre oriental, et que les anciens tiraient
principalement d’Egypte ; M. Rozière pense que
les carrières en étaient près du mont Sinaï : sa
pâte est un eurite d’un rouge brun parsemé d’une
multitude de points noirs presque invisibles , et
qui paraissent être de l’amphibole : elle renferme
, en outre , quelques aiguilles de cette même
substance , ainsi qu’un très-grand nombre de
petits cristaux de feldspath : au chalumeau, elle
fond en un émail légèrement grisâtre , et les
points amphiboliques en émail noir : sa pesanteur
spécifique est 2,75.
20 Le porphyre à base (Yhoinstein ou de kératite
: sa pâte est très-chargée de quartz , et fond
ainsi plus difficilement que l’eurite. D’ailleurs ,
la ressemblance entre ces deux variétés , sous le
rapport des caractères extérieurs, est ou peut
être parfaite ; et ce n’est que par Fessai au chalumeau
que l’on peut reconnaître ce qui est
vraiment eurite ou kératite. Au reste , je rappelle
que , d’après l’essence de ces deux porphyres , il
y a un passage parfait de l’un à l’autre ; que les
caractères qui les différencient varient du plus
au moins ; et par suite , que l’application du nom
convenable est quelquefois fort difficile à faire.
3° Le porphyre siénitique ( sienil - porphyr de
Werner) : il dériverait d’un granité contenant
beaucoup d’amphibole, c’est-à-dire d’un granité
siénitique. lise distinguerait en ce que sa pâte (eurite
imprégné d’amphibole ) fondrait en émail
coloré, sans être cependant entièrement noir ;
par suite , sa couleur serait intense et habituellement
d’un vert bien prononcé. Au reste , nous
ne donnons pas la couleur comme caractère distinctif
do ce porphyre , nous prenons ce caractère
dans l’essence même de la roche ; nous remarquerons
même que la couleur, quoique ayant
quelque rapport avec cette essence , n’en est pas
un signe bien positif : un granité presque entièrement
feldspathique , mais à feldspath blanc , lors
même qu’il ne contiendrait point d’amphibole ,
pourrait encore produire un porphyre v e rt,
lequel serait coloré par les éléments du mica ou
du talc : tout comme une vraie siénite pourrait
donner un porphyre rouge ; par exemple , si le
feldspath avait une très-forte teinte de cette couleur
, et que l’amphibole , restant en grains
réunis, ne répandit pas dans la masse son principe
colorant : tel est peut-être le cas du porphyre
oriental.