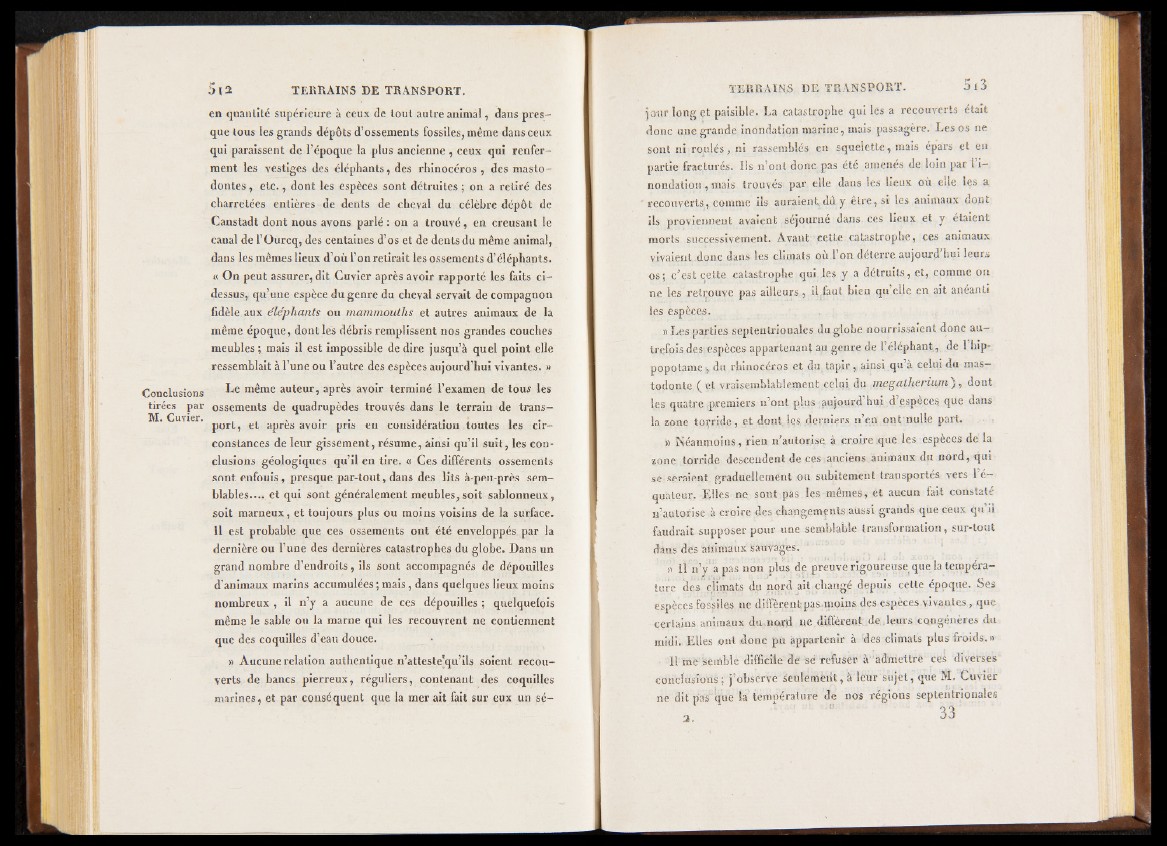
Conclusions
tirées par
M. Cuvier.
en quantité supérieure à ceux de tout autre animal, dans presque
tous les grands dépôts d’ossements fossiles, même dans ceux
qui paraissent de l’époque la plus ancienne, ceux qui renferment
les vestiges des éléphants, des rhinocéros , des mastodontes
, etc., dont les espèces sont détruites ; on a retiré des
charretées entières de dents de cheval du célèbre dépôt de
Canstadt dont nous avons parlé : on a trouvé, en creusant le
canal de l’Ourcq, des centaines d’ os et de dents du même animal,
dans les mêmes lieux d’où l’on retirait les ossements d’éléphants.
« On peut assurer, dit Cuvier après avoir rapporté les faits ci-
dessus, qu’une espèce du genre du cheval servait de compagnon
fidèle aux éléphants ou mammouths et autres animaux de la
même époque, dont les débris remplissent nos grandes couches
meubles ; mais il est impossible de dire jusqu’à quel point elle
ressemblait à l’une ou l’autre des espèces aujourd’hui vivantes. »
Le même auteur, après avoir terminé l’examen de tous les
ossements de quadrupèdes trouvés dans le terrain de transport,
et après avoir pris en considération toutes les circonstances
de leur gissement, résume, ainsi qu’il suit, les conclusions
géologiques qu’il en tire. « Ces différents ossements
sont enfouis, presque par-tout, dans des lits à-peu-près semblables....
et qui sont généralement meubles,soit sablonneux,
soit marneux, et toujours plus ou moins voisins de la surface.
11 est probable que ces ossements ont été enveloppés par la
dernière ou l’une des dernières catastrophes du globe. Dans un
grand nombre d’endroits, ils sont accompagnés de dépouilles
d’animaux marins accumulées ; mais, dans quelques lieux moins
nombreux , il n’y a aucune de ces dépouilles ; quelquefois
même le sable ou la marne qui les recouvrent ne contiennent
que des coquilles d’eau douce.
» Aucune relation authentique n’atteste'qu’ils soient recouverts
de bancs pierreux, réguliers, contenant des coquilles
marines, et par conséquent que la mer ait fait sur eux un scjour
long et paisible. La catastrophe qui les a recouverts était
donc une grande inondation marine, mais passagère. Les os ne
sont ni roulés, ni rassemblés en squelette, mais épars et en
partie fracturés. Ils n’ont donc pas été amenés de loin par 1 i—
nondation, mais trouvés par elle dans les lieux où elle les a
recouverts, comme ils auraient,du y être, si les animaux dont
ils proviennent avaient séjourné dans, ces lieux et y étaient
morts successivement. Avant cette catastrophe, ces animaux
vivaient donc dans les climats où l’on déterre aujourd’hui leurs
os; c’ est cette catastrophe qui les y a détruits, et, comme on
ne les retrouve pas ailleurs , il.faut bien quelle en ait anéanti
les espèces.
» Les parties septentrionales du globe nourrissaient donc autrefois
des espèces appartenant au genre de l’éléphant,,, de l’hippopotame;,
du rhinocéros et du tapir, ainsi qu’à celui du mastodonte
^ et vraisemblablement celui du mégathérium^, dont
les quatre premiers n’ont plus-aujourd’hui d’espèces, que dans
la zone torride, et dont les derniers n’en ont nulle part.
» Néanmoins, rien n’autorise à croire que les espèces de la
zone torride descendent de ces anciens animaux du nord, qui
se-seraient, graduellement ou subitement transportes vers l é—
quateur. Elles ne sont pas les mêmes, et aucun fait constaté
n’autorise à croire des changements aussi grands que ceux qu il
faudrait supposer pour une semblable transformation, sur-tout
dans dés animaux Sautages. '
>i II n’y a pas non plus de preuve rigoureuse que la température
des climats du nord ait changé depuis cette époque. Ses
espèces fossiles ne diffèrent; pas .moins des espèces .vivantes,, que
certains animaux du.nard ne diffèrent de leurs congénères du
midi. Elles ont donc pu appartenir à des climats plus froids. »
Il me semble difficile de sé refuser à admettre eeS diverses
conclusions ; j’observe seulemërit, à leur sujet, que M. Cuvier
ne dit pas que la température de nos régions septentrionales
33