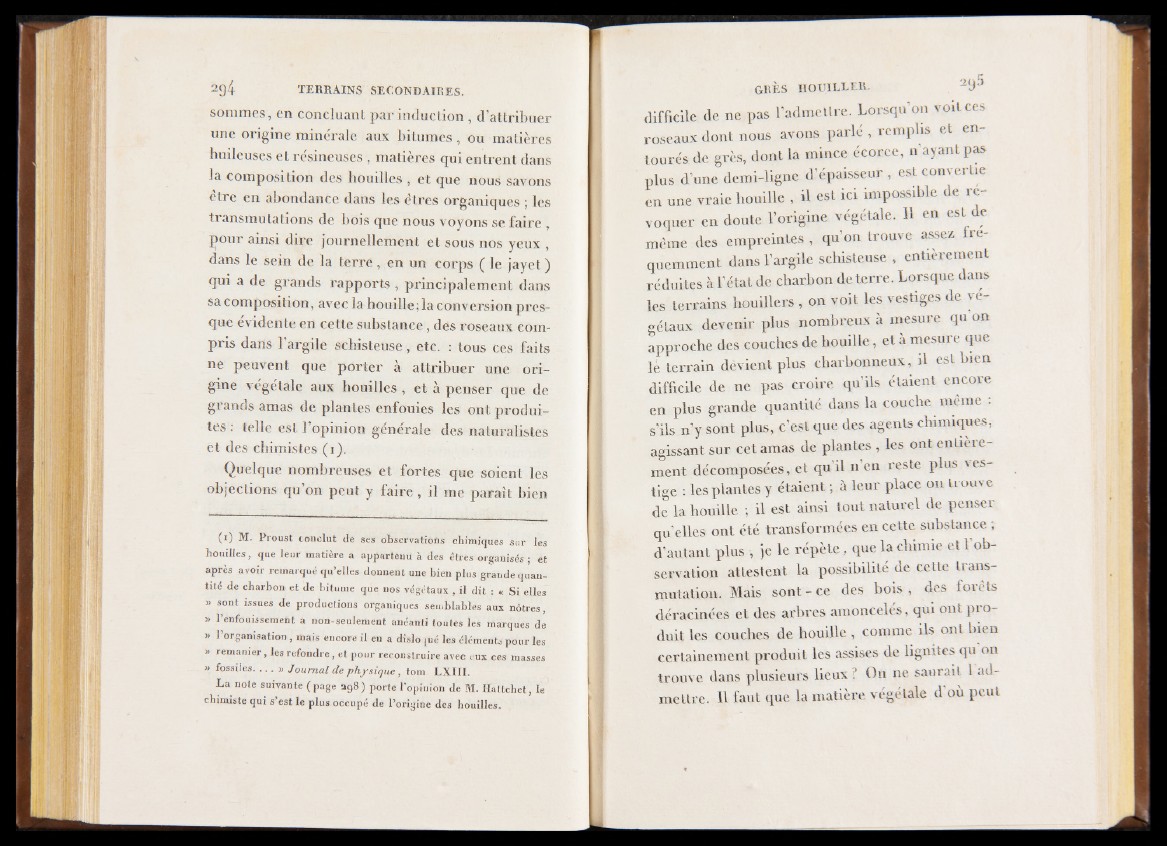
sommes, en concluant par induction , d’attribuer
une origine minérale aux bitumes , ou matières
hmleuses et résineuses , matières qui entrent dans
la composition des houilles , et que nous savons
être en abondance dans les êtres organiques ; les
transmutations de bois que nous voyons se faire ,
j)our ainsi dire journellement et sous nos yeux ,
dans le sein de la terre, en un corps ( le jayet )
qui a de grands rapports , principalement dans
sa composition, avec la houille; la conversion presque
évidente en cette substance, des roseaux compris
dans l’argile schisteuse, etc. : tous ces faits
ne peuvent que porter à attribuer une origine
végétale aux houilles , et à penser que de
grands amas de plantes enfouies les ont produites
: telle est l ’opinion générale des naturalistes
et des chimistes (i).
Quelque nombreuses et fortes que soient les
objections qu’on peut y faire , il me paraît bien
(i) M. Proust conclut de ses observations chimiques sur les
houilles, que leur matière a appartenu à des êtres organisés ; et
après avoir remarqué qu’elles donnent une bien plus grande quantité
de charbon et de bitume que nos végétaux , il dit : « Si elles
» sont issues de productions organiques semblables aux nôtres,
3> l’enfouissement a non-seulement anéanti toutes les marques de
j) l’organisation , mais encore il en a dislo jué les éléments pour les
» remanier, les refondre , et pour reconstruire avec eux ces masses
33 fossiles. ... 33 Journal de physique , tom LXIII.
La note suivante ( page ag8) porte l'opinion de M. Hattchet, le
chimiste qui s’est le plus occupé de l’origine des houilles.
difficile de ne pas l’admetlre. Lorsqu’on voit ces
roseaux dont nous avons parlé , remplis et entourés
de grès, dont la mince écorce, n ayant pas
plus d’une demi-ligne d’épaisseur , est convertie
en une vraie houille , il est ici impossible de révoquer
en doute l’origine végétale. Il en est de
même des empreintes , qu’on trouve assez fréquemment
dans l’argile schisteuse, entièrement
réduites à l’état de charbon deterre. Lorsque dans
les terrains houillers , on voit les vestiges de végétaux
devenir plus nombreux à mesure qu on
approche des couches de houille, et à mesure que
le terrain devient plus charbonneux, il est bien
difficile de ne pas croire qu’ils étaient encore
en plus grande quantité dans la couche même :
s’ils n’y sont plus, c’est que des agents chimiques,
agissant sur cet amas de plantes , les ont entièrement
décomposées, et qu’il n en reste plus i es-
tige : les plantes y étaient ; à leur place on trouve
de la houille ; il est ainsi tout naturel de penser
qu’elles ont été transformées en cette substance ;
d’autant plus , je le répète, que la chimie et 1 observation
attestent la possibilité de cette transmutation.
Mais sont - ce des bois , des forêts
déracinées et des arbres amoncelés, qui ont pio-
duit les couches de houille , comme ils ont bien
certainement produit les assises de lignites qu on
trouve dans plusieurs lieux ? On ne saurait 1 admettre.
11 faut que la matière végétale d où peut