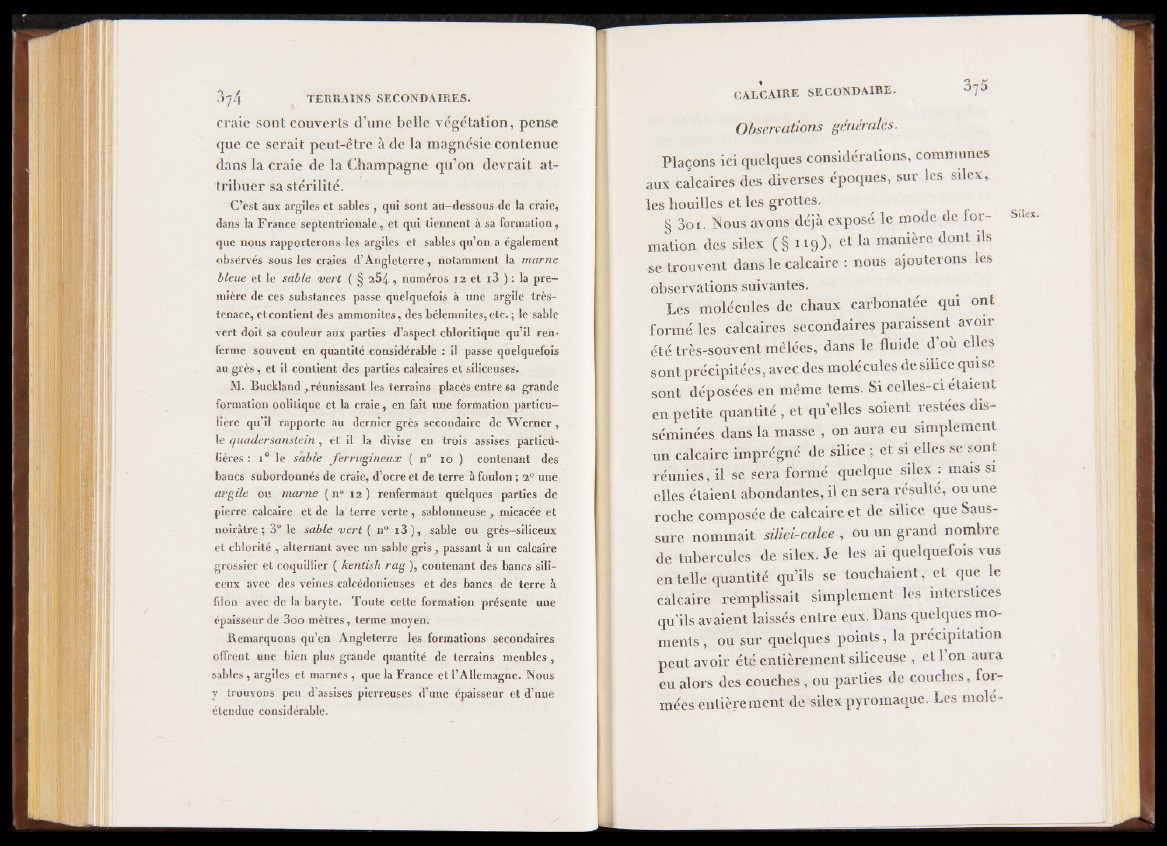
craie sont couverts d’une belle végétation, pense
que ce serait peut-être à de la magnésie contenue
dans la craie de la Champagne qu’on devrait attribuer
sa stérilité.
C ’est aux argiles et sables , qui sont au-dessous de la craie,
dans la France septentrionale, et qui tiennent à sa formation,
que nous rapporterons les argiles et sables qu’on a également
observés sous les craies d’A ngleterre, notamment la marne
bleue et le sable vert ( § 254 i numéros 12 et i3 ) : la première
de ces substances passe quelquefois à une argile très-
tenace, et contient des ammonites, des bélemnites, etc. ; le sable
vert doit sa couleur aux parties d’aspect cbloritique qu’il renferme
souvent en quantité considérable : il passe quelquefois
au g rès, et il contient des parties calcaires et siliceuses.
M. Buckland , réunissant les terrains placés entre sa grande
formation oolitique et la craie, en fait une formation particulière
qu’il rapporte au dernier grès secondaire de W e r n e r ,
le quadersanstein, et il la divise en trois assises particû-
lières : i° le sable ferrugineux ( n° 10 ) contenant des
bancs subordonnés de craie, d’ocre et de terre à foulon ; 20 une
argile ou marne ( n° 12 ) renfermant quelques parties de
pierre calcaire et de la terre v erte, sablonneuse , micacée et
noirâtre; 3° le sable vert ( n° i 3 ) , sable ou grès-siliceux
et chlorité , alternant avec un sable g ris, passant à un calcaire
grossier et coquillier ( kentish rag ), contenant des bancs siliceux
avec des veines calcédonieuses et des bancs de terre à
filon avec de la baryte. T oute cette formation présente une
épaisseur de 3oo m ètres, terme moyen.
Remarquons qu’en Angleterre les formations secondaires
offrent une bien plus grande quantité de terrains meubles ,
sables , argiles et marnes , que la France et l’A llem agne. N ous
y trouvons peu d’assises pierreuses d’une épaisseur et d’une
étendue considérable.
Observations générales.
Plaçons ici quelques considérations, communes
aux calcaires des diverses époques, sur les silex,
les houilles et les grottes.
§ 3oi. Nous avons déjà exposé le mode de for-
mation des silex (§ >19). et la manière dont ils
se trouvent dans le calcaire : nous ajouterons les
observations suivantes.
Les molécules de chaux carbonatée qui ont
formé les calcaires secondaires paraissent avoir
été très-souvent mêlées, dans le fluide d où elles
sont précipitées, avec des molécules de silice quise
sont déposées en même terns. Si celles-ci étaient
en petite quantité , et qu’elles soient restées disséminées
dans la masse , on aura eu simplement
un calcaire imprégné de silice ; et si elles se sont
réunies, il se sera formé quelque silex : mais si
elles étaient abondantes, il en sera résulte, ou une
roche composée de calcaire et de silice que Saussure
nommait siliei-calce , ou un grand nombre
de tubercules de silex. Je les ai quelquefois vus
en telle quantité qu’ils se touchaient, et que le
calcaire remplissait simplement les interstices
qu’ils avaient laissés entre eux, Dans quelques moments
, ou sur quelques points, la précipitation
peut avoir été entièrement siliceuse , et 1 on aura
eu alors des couches , ou parties de couches, formées
entièrement de silex pyr orna que. Les molé-
Silex.