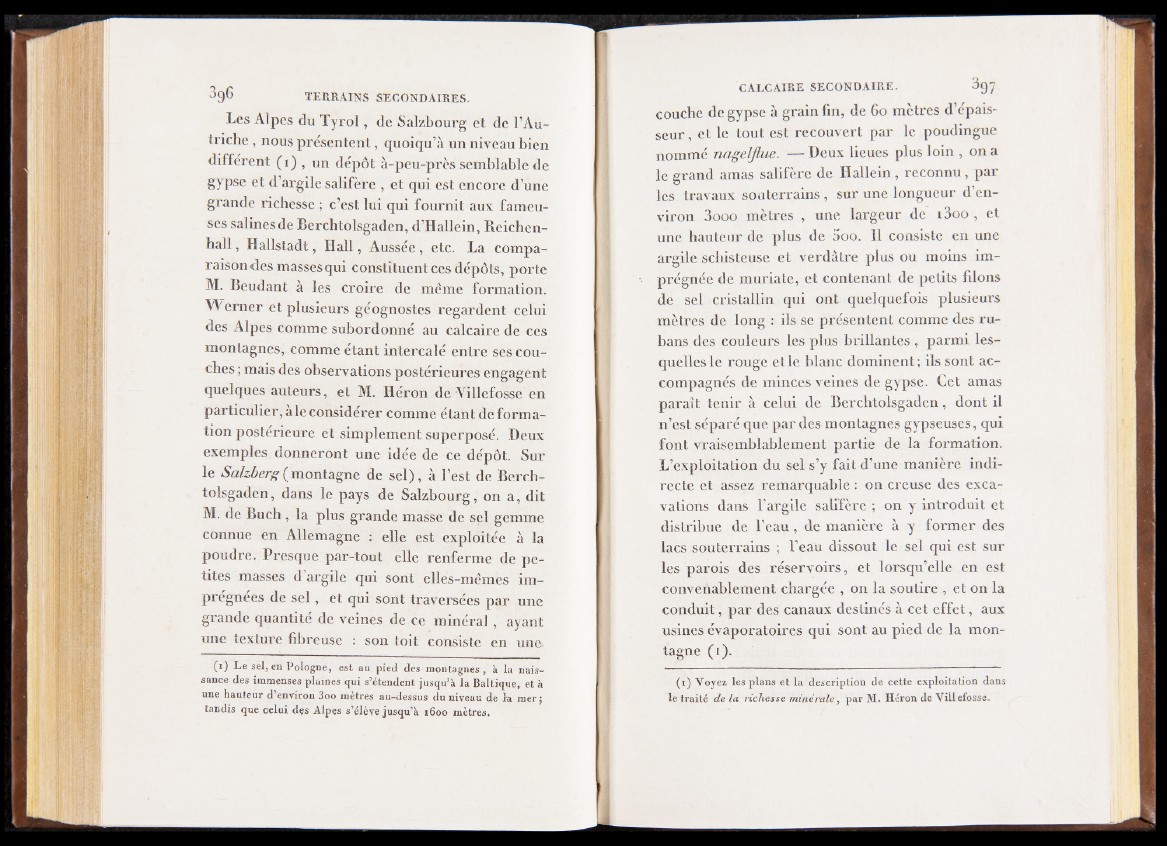
Les Alpes du Tyrol, de Salzbourg et de l’Autriche
, nous présentent, quoiqu’à un niveau bien
différent (1) , un dépôt à-peu-près semblable de
gypse et d’argile salifère , et qui est encore d’une
grande richesse ; c’est lui qui fournit aux fameuses
salines de Berchtolsgaden, d’Hallein, Reichen-
hall, Hallstadt, Hall, Aussée, etc. La compa-
raison<les massesqui constituent ces dépôts, porte
M. Beudant à les croire de meme formation.
Werner et plusieurs géognostes regardent celui
des Alpes comme subordonné au calcaire de ces
montagnes, comme étant intercalé entre ses couches
; mais des observations postérieures engagent
quelques auteurs, et M. Héron de Villefosse en
particulier, aie considérer comme étant deformation
postérieure et simplement superposé. Deux
exemples donneront une idée de ce dépôt. Sur
le Sahberg( montagne de sel), à l ’est de Berchtolsgaden,
dans le pays de Salzbourg, on a, dit
M. de Buch , la plus grande masse de sel gemme
connue en Allemagne : elle est exploitée à la
poudre. Presque par-tout elle renferme de petites
masses d argile qui sont elles-mêmes imprégnées
de s e l, et qui sont traversées par une
grande quantité de veines de ce minéral , ayant
une texture fibreuse : son toit consiste en une-
(0 Le sel, en Pologne, est au pied des montagnes, à la naissance
des immenses plumes qui s’étendent jusqu’à la Baltique, et à
une hauteur d’environ 3oo mètres au-dessus du niveau de la mer ;
tandis que celui dçs Alpes s’élève jusqu’à 1600 mètres.
couche de gypse à grain fin, de 60 mètres d’epais-
seur, et le tout est recouvert par le poudingue
nommé nageljlue. — Deux lieues plus loin , on a
le grand amas salifère de Hallein, reconnu, par
les travaux souterrains , sur une longueur d’environ
3ooo mètres , une largeur de i 3oo , et
une hauteur de plus de 5oo. 11 consiste en une
argile schisteuse et verdâtre plus ou moins imprégnée
de muriate, et contenant de petits filons
de sel cristallin qui ont quelquefois plusieurs
mètres de long : ils se présentent comme des rubans
des couleurs les plus brillantes , parmi lesquelles
le rouge e t le blanc dominent ; ils sont accompagnés
de minces veines de gypse. Cet amas
paraît tenir à celui de Berchtolsgaden, dont il
n’est séparé que par des montagnes gypseuses, qui
font vraisemblablement partie de la formation.
L’exploitation du sel s’y fait d’une manière indirecte
et assez remarquable : on creuse des excavations
dans l’argile salifère ; on y introduit et
distribue de l’eau, de manière à y former des
lacs souterrains ; l’eau dissout le sel qui est sur
les parois des réservoirs, et lorsqu’elle en est
convenablement chargée , on la soutire , et on la
conduit, par des canaux destinés à cet effet, aux
usines évaporatoires qui sont au pied de la montagne
(1). 1
(1) Voyez les plans et la description de cette exploitation dans
le traité de la richesse minérale, par M. Héron de ViUefosse.