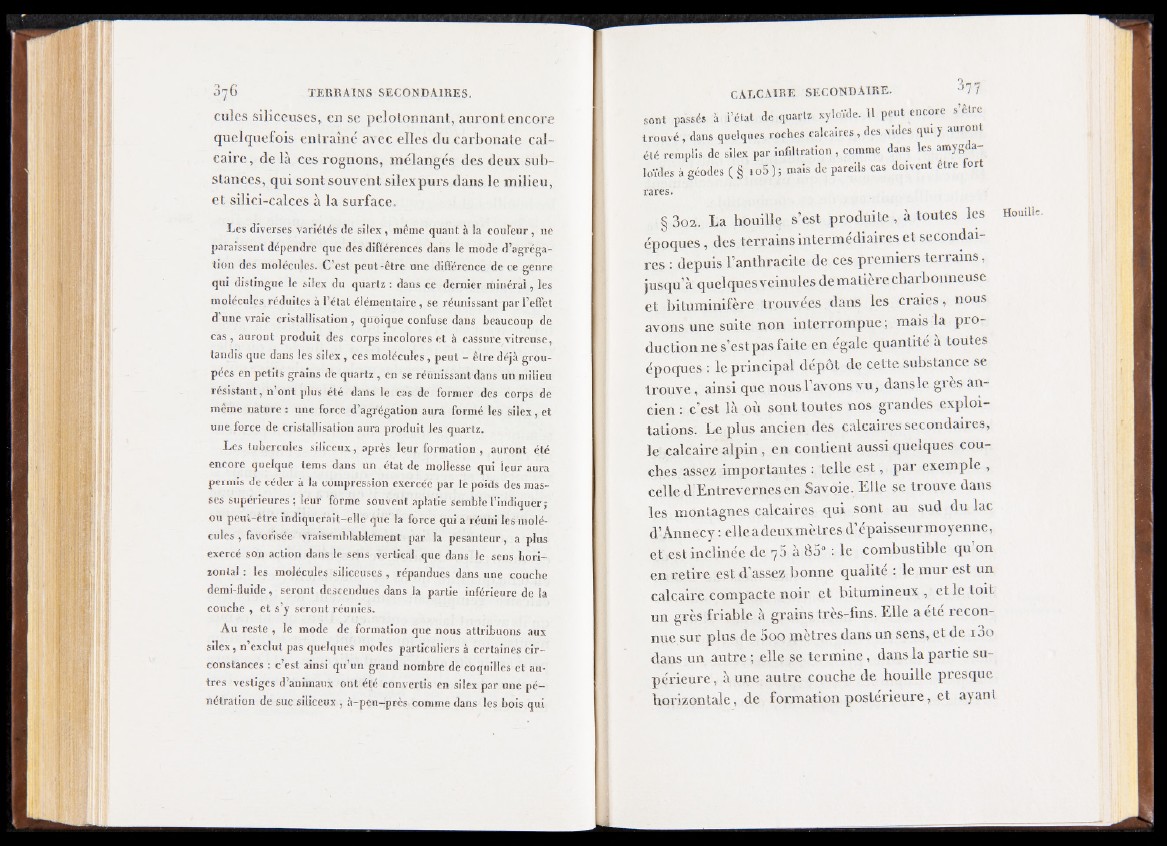
culcs siliceuses, en se pelotonnant, auront encore
quelquefois entraîné avec elles du carbonate calcaire,
delà ces rognons, mélangés des deux substances,
qui sont souvent silexpurs dans le milieu,
et silici-calces à la surface.
Les diverses variétés de silex, même quant à la couleur, ne
paraissent dépendre que des différences dans le mode d’agréga-
tion des molécules. C’est peut-être une différence de ce genre
qui distingue le silex du quartz : dans ce dernier minéral, les
molécules réduites à l’état élémentaire , se réunissant par l’effet
d’une vraie cristallisation, quoique confuse dans beaucoup de
cas, auront produit des corps incolores et à cassure vitreuse,
tandis que dans les silex, ces molécules, peut - être déjà groupées
en petits grains de quartz, en se réunissant dans un milieu
résistant, n’ont plus été dans le cas de former des corps de
même nature : une force d’agrégation aura formé les silex, et
une force de cristallisation aura produit les quartz.
Les tubercules siliceux, après leur formation , auront été
encore quelque tems dans un état de mollesse qui leur aura
permis de céder à la compression exercée par le poids des masses
supérieures ; leur forme souvent aplatie semble l’indiquer ;
ou peut-être indiquerait-elle que la force qui a réuni les molécules
, favorisée vraisemblablement par la pesanteur, a plus
exercé son action dans le sens vertical que dans le sens horizontal
: les molécules siliceuses , répandues dans une couche
demi-fluide, seront descendues dans la partie inférieure de la
couche , et s’y seront réunies.
Au reste , le mode de formation que nous attribuons aux
silex, n’exclut pas quelques modes particuliers à certaines circonstances
: c’est ainsi qu’un grand nombre de coquilles et autres
vestiges d’animaux ont ete convertis en silex par une pénétration
de suc siliceux , à-peu-près comme dans les bois qui
CALCAIRE SECONDAIRE. ^77
sont passés à l’état de quartz xyloïde. Il peut encore s’être
trouvé, dans quelques roches calcaires , des vides qui y auront
été remplis de silex par infiltration , comme dans les amygda-
loïdes à géodes ( § io 5 ) ; mais de pareils cas doivent être fort
rares.
§ 302. La houille s’est produite , à toutes les
époques , des terrains intermédiaires et secondaires
: depuis l’anthracite de ces premiers terrains,
jusqu’à quelques veinules de matière charbonneuse
et bituminifère trouvées dans les craies, nous
avons une suite non interrompue; mais la production
ne s’est pas faite en égale quantité à toutes
époques : le principal dépôt de cette substance se
trouve, ainsi que nous l’avons vu, dansle grès ancien
: c’est là où sont toutes nos grandes exploitations.
Le plus ancien des calcaires secondaires,
le calcaire alpin, en contient aussi quelques couches
assez importantes : telle est, par exemple ,
celle d Enlrevernes en Savoie. Elle se trouve dans
les montagnes calcaires qui sont au sud du lac
d’Annecy : elle a deuxmètres d’épaisseur moyenne,
et est inclinée de 75 à 85° : le combustible qu’on
en retire est d'assez bonne qualité : le mur est un
calcaire compacte noir et bitumineux , et le toit
un grès friable à grains très-lins. Elle a ete reconnue
sur plus de 5oo mètres dans un sens, et de i 3o
dans un autre ; elle se termine, dans la partie supérieure
, à une autre couche de houille presque
horizontale, de formation postérieure, et ayanl
Houille.