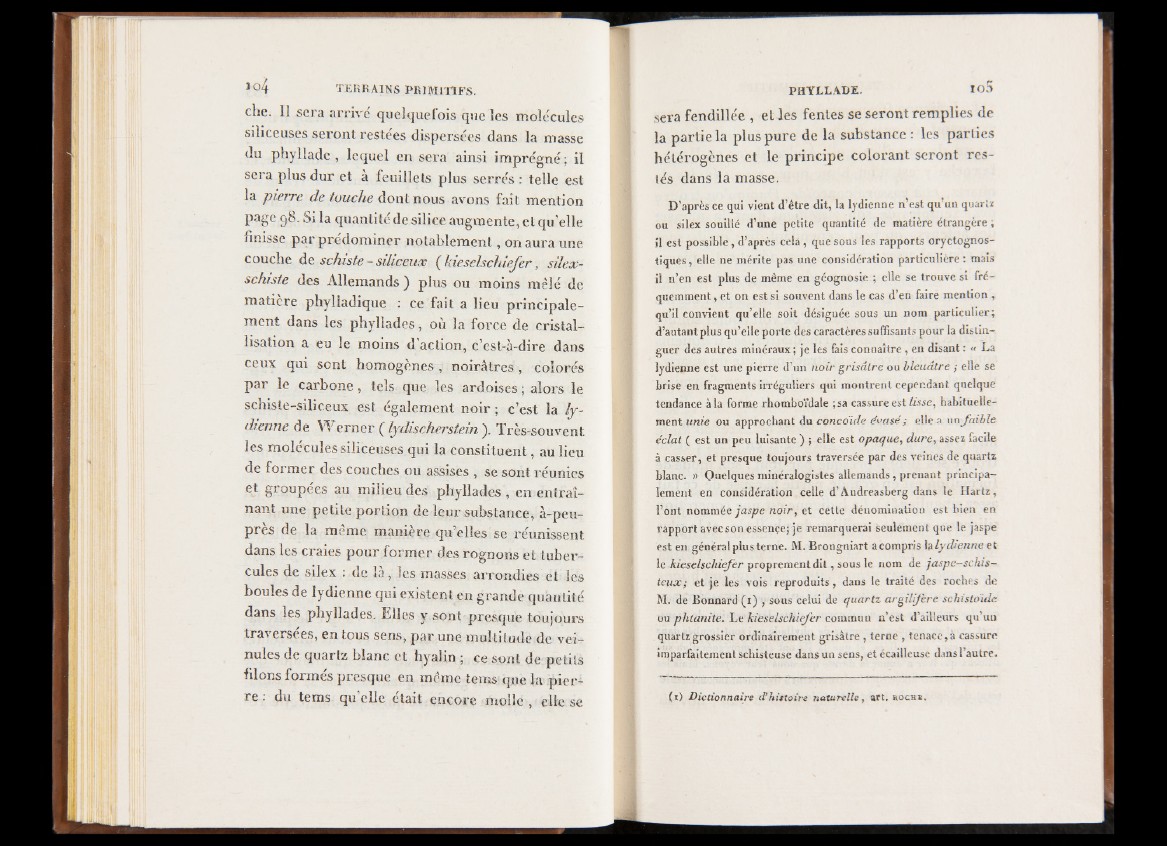
che. Il sera arrive quelquefois que les molécules
siliceuses seront restées dispersées dans la masse
du phyllade, lequel en sera ainsi imprégné; il
sera plus dur et a feuillets plus serrés : telle est
la pierre de touche dont nous avons fait mention
page g8. Si la quantité de silice augmentent qu’elle
finisse par prédominer notablement, on aura une
couche de schiste - siliceux ( kieselschiefer, silex-
schiste des Allemands ) plus ou moins mêlé de
matière phylladique : ce fait a lieu principalement
dans les phyllades, où la force de cristallisation
a eu le moins d’action, c’est-à-dire dans
ceux qui sont homogènes , noirâtres , colorés
par le carbone, tels que les ardoises ; alors le
schiste-siliceux est également noir ; c’est la lydienne
de Werner ( lydischerstein ). Très-souvent
les molécules siliceuses qui la constituent, au lieu
de former des couches ou assises , se sont réunies
et groupées au milieu des phyllades , en entraînant
une petite portion de leur substance, à-peu-
pres de la meme maniéré qu’elles se réunissent
dans les craies pour former des rognons et tubercules
de silex : de là, les masses arrondies et les
boules de lydienne qui existent en grande quantité
dans les phyllades. Elles y sont presque toujours
traversées, en tous sens, par une multitude de veinules
de quartz blanc et hyalin ; ce sont de petits
filons formés presque en même tems que la pierre
: du tems qu’elle était encore molle , elle se
sera fendillée , et les fentes se seront remplies de
la partie la plus pure de la substance : les parties
hétérogènes et le principe colorant seront restés
dans la masse.
D’après ce qui vient d’être dit, la lydienne n’est qu’un quartz
ou silex souillé d’une petite quantité de matière étrangère ;
il est possible, d’après cela, que sous les rapports oryctognos-
tiques, elle ne mérite pas une considération particulière : mais
il n’en est plus de même en géognosie ; elle se trouve si fréquemment
, et on est si souvent dans le cas d’en faire mention ,
qu’il convient qu’elle soit désignée sous un nom particulier;
d’autant plus qu’elle porte des caractères suffisants pour la distinguer
des autres minéraux ; je les lais connaître , en disant : « La
lydienne est une pierre d’un noir grisâtre ou bleuâtre ; elle se
brise en fragments irréguliers qui montrent cependant quelque
tendance à la forme rhomboïdale ;sa cassure est lisse, habituellement
unie ou approchant du concoïde évasé ; elle a un fa ib le
éclat ( est un peu luisante ) ; elle est opaque, dure, assez facile
à casser, et presque toujours traversée par des veines de quartz
blanc. » Quelques minéralogistes allemands, prenant principalement
en considération celle d’ Andreasberg dans le Hartz,
l’ont nommée jaspe noir, et cette dénomination est bien en
rapport avec son essençe; je remarquerai seulement que le jaspe
est en général plus terne. M. Brongniart a compris la lydienne et
le kieselschiefer proprement dit, sous le nom de jaspe—schisteux;
et je les vois reproduits, dans le traité des roches de
M. de Bonnard ( i) , sous celui de quartz argilijere schistoïde
ou phtanite. Le kieselschiefer commun n’est d’ailleurs qu’un
quartz grossier ordinairement grisâtre , terne , tenace, à cassure
imparfaitement schisteuse dans un sens, et écailleuse dans l’autre.
(i) Dictionnaire d’ histoire naturelle, art, r o c h s .