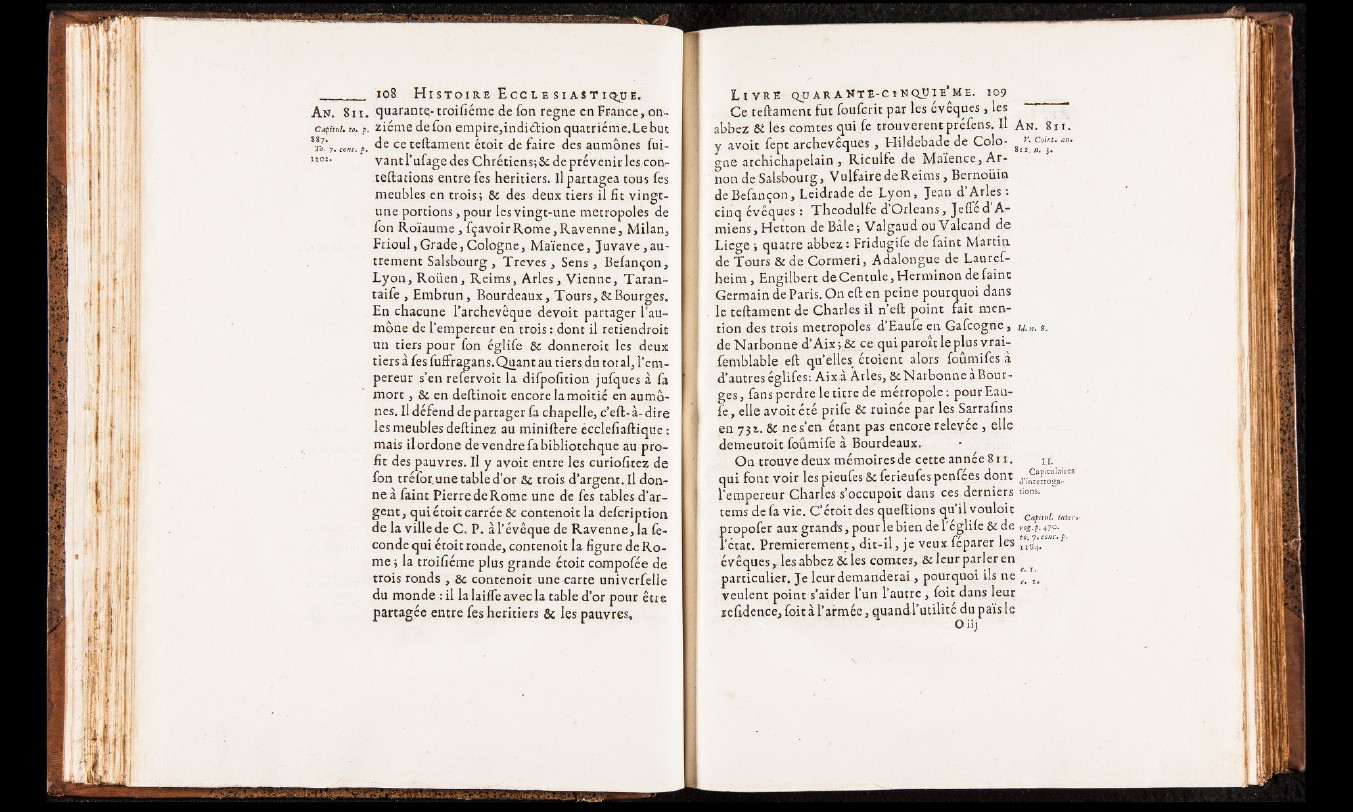
._______ io8 H i s t o i r e E c c i . e s i a s t iq j j e.
An. 8 i i . quarante- troifiéme de fon regne en France, on-
capital, u. p. ziéme de Ion empire,indication quatrième. Le but
*».'7. conc. p. ceteftament étoit de faire des aumônes fui-
itoi. van tl’ufagedes Chrétiens; 8c de prévenir les conteftarions
entre fes héritiers, il partagea tous fes
meubles en trois; 8c des deux tiers il fit vingt-
une portions, pour lesvingt-une métropoles de
fon Roïaume, fç a vo irR om e ,R a v en n e , Milan,
Friou l,G rad e ,C o lo gn e , Maïence, Ju v a v e ,a u trement
Salsbourg , Treves , Sens , Befançon,
L y o n , Roiien, Reims, A rles, Vienne, Taran-
taife , Embrun, Bourdeaux, Tours,8cBourges.
En chacune l’archevêque devoit partager l’aumône
de l’empereur en trois : dont il retiendrait
un tiers pour fon églife 8c donnerait les deux
tiers à fes fuffragans.Quant au tiers du total, l’empereur
s’en refervoit la difpofition jufques à fa
m o r t , 8c en deftinoit encore la moitié en aumônes.
Il défend de partager fa chapelle, c’eft-à-dire
les meubles deftinez au miniftere écclefiailique :
mais ilordone de vendre fa bibliotehque au profit
des pauvres. Il y avoit entre les curioficez de
fon tréfor.une table d’or & trois d’argent. Il don-
n eà faint PierredeRome une de fes tables d’argent,
qui étoit carrée 8c contenoit la defçription
de la ville de C. P. à l’évêque de Ravenne, la iè-
conde qui étoit ronde, contenoit la figure de R o me
; la troifiéme plus grande étoit compofée de
trois ronds , 8c contenoit une carte univerfelle
du monde : il lalaifleavecla table d’or pour être
partagée entre fes héritiers 8c les pauvres.
L i v r e q j j a r a n t e - c i n q u i e ’ m e . 109
Ce teftamenc fut foufcrit par les eveques, les
abbez 8i les comtes qui fe trouvèrent préfens. Il An. 8 11.
y avoit fept archevêques, Hildebade de Colo- ^coim.an.
gne archichapelain , Riculfe de Maïence, Ar-
non de Salsbourg, Vulfaire de R e im s , Bernoüin
deBefançon, Leidrade de L yon , Jean d’Arles :
cinq évêques : Theodulfe d’Orleans, Jeffé d’A-
miens,Hetton deBâle; Valgaud ou Valcand de
Liege ; quatre abbez : Fridugife de faint Martin
de Tours 8c de Cormeri, Adalongue de Lauref-
h e im , Engilbert deCentule,Herminondefaint
Germain de Paris. On eft en peine pourquoi dans
le teftament de Charles il n’eft point fait mention
des trois métropoles d’Eaufe en Gafcogne, Jd.„. 8.
de Narbonne d’Aix ; 8c ce qui paraît le plus vrai-
femblable eft quelles étaient alors foûmifes à
d’autres églifes: Aix.à Arles, 8cNarbonne àBour-
g e s , fans perdre le titre de métropole : pour Eau-
fe , elle avoit été prife 8c ruinée par les Sarrafins
en 7 3 1. 8c ne s’en étant pas encore relevée , elle
demeurait foûmife à Bourdeaux..
On trouve deux mémoires de cette année 8 1 1 . ti.
qui font voir les pieufes 8c ferieufes penfées dont
l’empereur Charles s’occupoit dans ces derniers tions-
tems de fa vie. C ’étoit des queftions qu’il vouloir ^
propofer aux grands, pour le bien de l’égliie 8c de
. , / * _ . 1 . • 1 r ' 1 ^ to. 7 . conc. P. 1état. Premièrement, d it-il, je veux leparer les lIg4.
évêques, les abbez 8c les comtes, 8c leur parler en
particulier. Je leur demanderai, pourquoi ils n e ^
veulent point s’aider l’un l’autre, foit dans leur
refidence, foit à l’armée, quand l’utilité du païs le