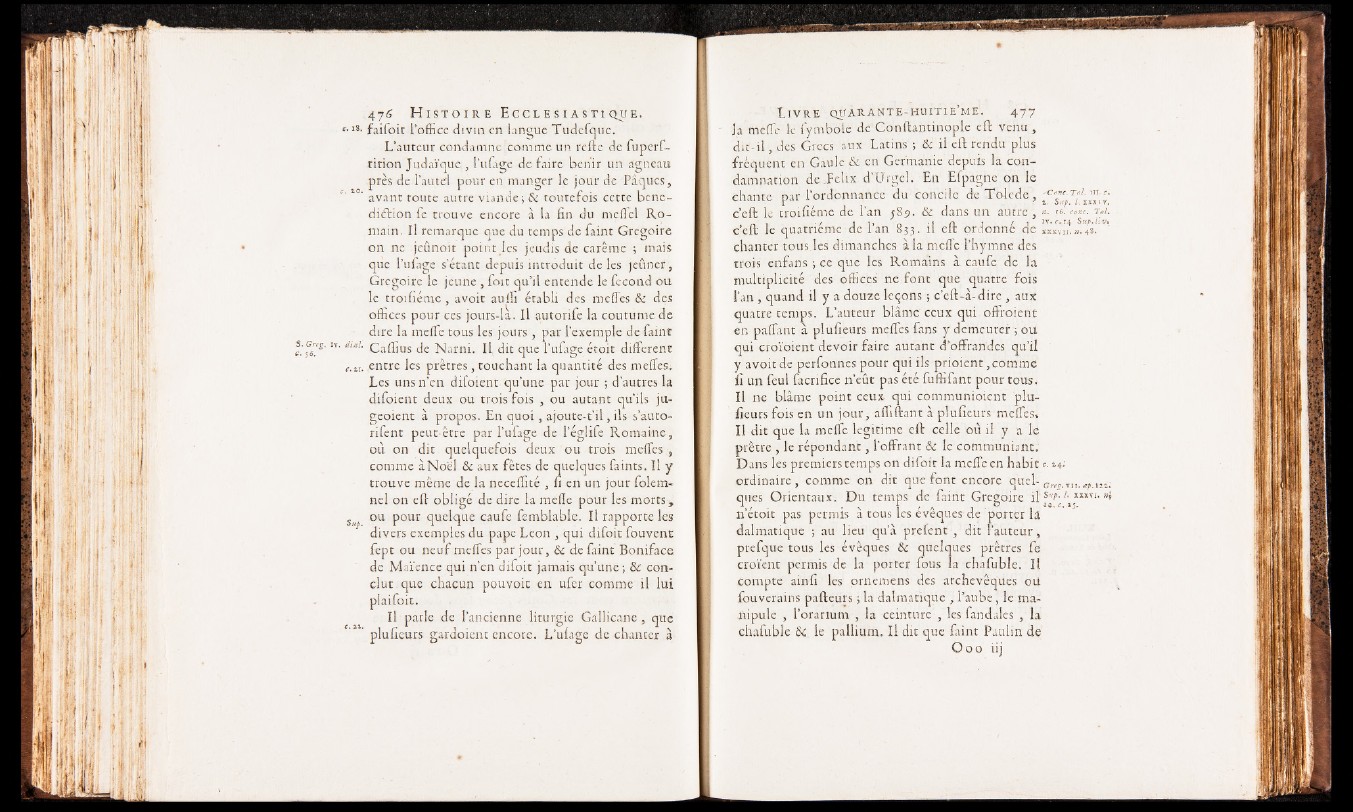
4 7 ^ H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
'• l8- faifoit l’office divin en langue Tudefque.
L’auteur condamne comme un refte de fuperf-
tition Judaïque , l’ufàge défaire bénir un agneau
près de l'autel pour en manger le jour de Pâques,
' avant toute autre viande ;& toutefois cette bene-
diition fe trouve encore à la fin du meffel R o main.
Il remarque que du temps de faint Grégoire
on ne jeûnoit point les jeudis de carême ; mais
que l’ufage s’étant depuis introduit de les jeûner,
Grégoire le jeune , fort qu’il entende le fécond ou
le troifiéme, avoit auifi établi des méfiés & des
offices pour ces jours-la. Il antorife la coutume de
dire la meffe tous les jours, par l’exemple de faint
d‘a1' Caffius de Narni. Il, dit que l’ufage étoit différent
î-.ii. ¡entre les prêtres, touchant la quantité des meffes;
Les uns n’en difoient qu’une par jour ; d’autres la
difoient deux ou trois fois , ou autant qu’ils ju-
geoient à propos. En q u o i, ajoute-t’i l , ils s’auto-
rifent peut-être par l’ufage'de l’églife Romaine,
où on dit quelquefois deux ou trois meffes ,
comme àNoël & aux fêtes de quelques faints. Il y
trouve même de la neceffité , fi en un jourfolem-
nel on eft obligé de dire la mefle pour les morts,
||| ou pour quelque caufe femblable. Il rapporte les
divers exemples du pape Léon , qui difoit fouvent
fèpt ou neuf meffes par jour, Sc de faint Boniface
de Maïence qui n’en difoit jamais qu’une; & conclut
que chacun pouvoir en ufer comme il lui
plaifoit.
: Il parle de l’ancienne liturgie Gallicane, que
plufieurs gardoient encore. L ’uiage de chanter à
L i v r e q u à r a n t e - h u i t i e ’m e . 4 7 7
la mefle. le fymbôle de Conftantinople eft venu,
d it - il, des Grecs aux Latins'; & il eft rendu plus
fréquent en Gaule & en Germanie depuis la condamnation
de .Félix d’Urgel. En Efpagne on le
chante par l’ordonnance du concile de To led e , ' cf 1 r °l L 1 , . . ., 2«. oUp, L. XXXlv,
c’eft le troifiéme de l’an j8<>. & dans.un autre, »■ « « • ' t<,i.
c’eft le quatrième de l’an 833. il eft ordonné de S «“ «.* ’
chanter tous,les dimanches à la meffe l’hymne des
trois enfans ; ce que les Romains à caufe de la
multiplicité des offices ne font que quatre fois
l’an , quand il y a douze leçons ; c’eft-à-dire , aux
quatre temps. L’auteur blâme ceux qui offroient
en paffant à plufieurs meffes fans y demeurer ; ou
qui croïoient devoir faire autant d’offrandes qu’il
y avoit de perfonnes pour qui ils prioient, comme
fi un feul facrifice n’eut pas été fuffifant pour tous.
Il ne blâme point ceux qui communioient plufieurs
fois en un jour, affiftant à plufieurs meffes»
Il dit que la meffe légitimé eft celle où il y a lé
prêtre , le répondant, l’offrant & le communiant.
Dans les premiers temps on difoit la meffe en habit 14;
ordinaire , comme on dit que font encore quel- Gm.vlI.ap
oues Orientaux. Du temps de faint Grégoire K h H B B p
L, ■ WÊM n etoit pas permis a tous Fle s e/ vea ques d, e . porter ,l a «•*•»>•
dalmatique ; au lieii qu’à prefent , dit l’auteur,
prefque tous les évêques & quelques prêtres fe
croient permis de la porter fous la ehafuble. Il
dompte ainfi les ornemens des archevêques oïl
fcuverains pafteurs ; la dalmatique , l’aube, le mafiipulè
, l’orarium , la ceinture , les fandales , la
ehafuble le pallium. Il dit que faint Paulin de
O o o iij