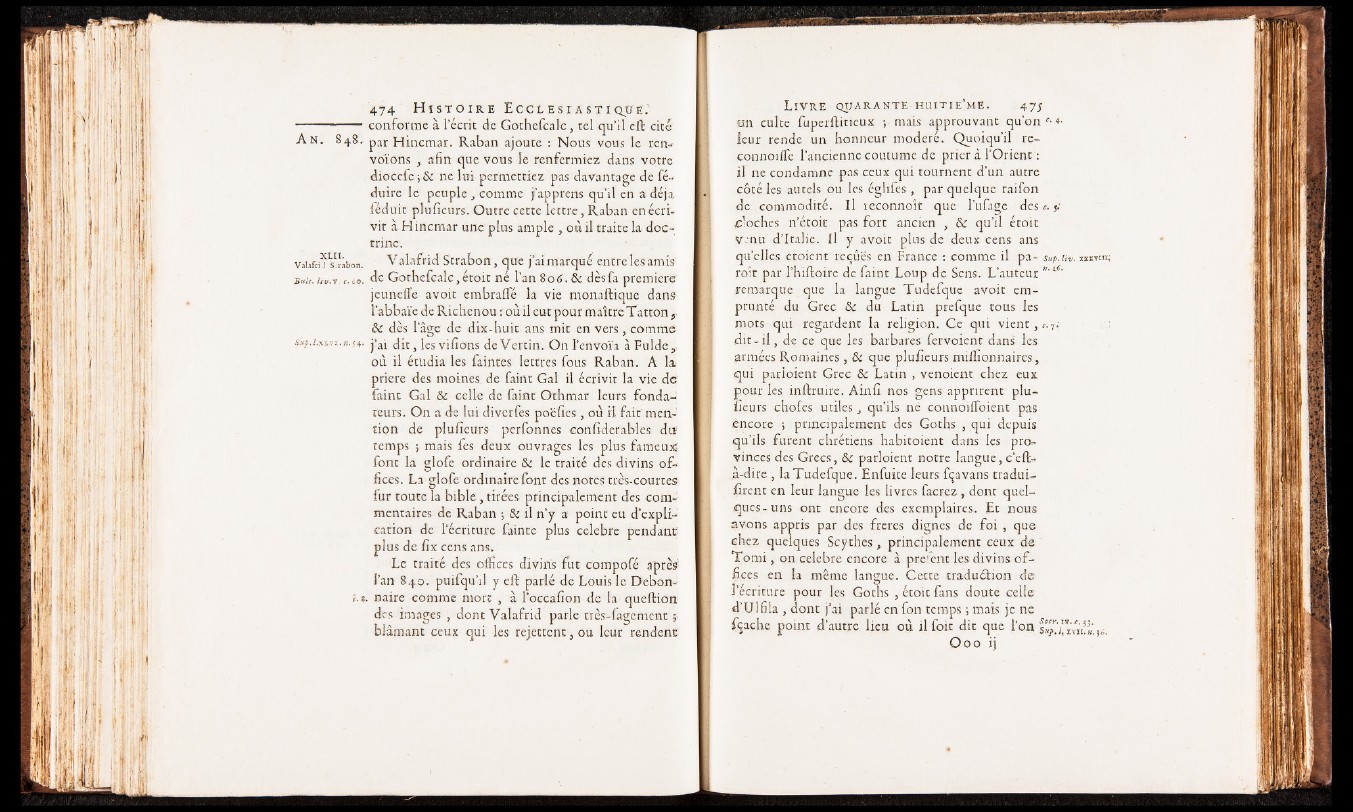
■ ^ .• ^ , u \ v • * , < . • ‘ • s * ? » ‘ f w . » '
4 7 4 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .’
. — ——— conforme à l’écrit de Gothefcalc, tel qu’il eft cite
A n . 848. par Hincmar. Raban ajoute : Nous vous le ren-*
votons , afin que vous le renfermiez dans votre
diocefe ; & ne lui permettiez pas davantage de fé-
duire le peuple ,■ comme j’ apprens qu’il en a déjà
féduit plufieürs. Outre cette lettre, Raban en écrivit
à Hincmar une plus ample , où il traite la doctrine.
vaufe^rabon. Valarrid Strabon, que j’ai marqué entre les amis1
B»it. U v . v . c. 6 0 . de Gothefcalc, étoit né l’an 806. & dès fa premiers
jeuneffe avoir embraffé la vie monaftique dans
l’abbaïe de Richenou ioùil eut pour maîtreTatton,-
& dès l’âge de dix-huit ans mit en v e rs, comme
j’ai d it, les vifions de Vertin. On l’enVoïa à Fui de s
où il étudia les faintes lettres fous Raban. A la
priere des moines de faint Gai il écrivit la vie de
faint Gai & celle de faint O’thmar leurs fondai
teurs. On a de lui diverfes poëfies, où il fait mention
de plufieurs pcrfoiines eonfiderables du
temps ; mais les deux ouvrages les plus fameux?
font la glofe ordinaire & le traité des divins offices.
La glofe ordinaire font des notes très-courtes
fur toute la b ib le , tirées principalement des commentaires
de Raban ; & il n’y a point eu d’explication
de l’écriture fainte plus célébré pendant?
plus de fix cens ans.
Le traité des offices divins fut compofé après
i’an 840. puifqu’il y eft parlé de Louis le Debon-
i. 8. naire comme mort , à l’oecafion de la queftion
des images , dont Valafrid parle très-fagement ;•
blâmant ceux qui les rejettent, ou leur rendent
L i v r e q u a r a n t e -h u i t i e ’m e . 475
an culte fuperftitieux mais approuvant qu’on
leur rende un honneur modéré. Quoiqu’il re-
connoiife l’ançipnne coutume de prier à l’Orient :
il ne condamne pas ceux qui tournent d’un autre
côté les autels ou les églifes , par quelque raifon
de commodité. Il reconnoît que l’ufage des
cloches n’étoit pas fort ancien , & qu’il étoit
V-nu d’Italie. Il y avoit plus de deux cens ans
qu’elles etoient reçûes en France : comme il pa-
roît par l’hiftoire de faint Loup de Sens. L’auteur
remarque que la langue Tudefque avoir emprunté
du Grec & du Latin prefque tous les
mots qui regardent la religion. Ce qui v ien t,
d i t - i l , de çe que les barbares fervoient dans les
armées Romaines, & que plufieurs millionnaires,
qui parloient Grec & Latin , venoient chez eux
pour les inftruire. Aînfi nos gens apprirent plu-
iieurs chofes utiles, qu’ils ne connoifToiént pas
encore ; principalement des Goths , qui depuis
qu’ils furent chrétiens habitoient dans les provinces
des Grecs, & parloient notre langue, c’eft-
à-dire , la Tudefque. Enfuite leurs fçavans tradui-
iîrent en leur langue les livres facrez , dont quelques
uns ont encore des exemplaires. Et nous
avons appris par des freres dignes de foi , que
chez quelques Scythes, principalement ceux de
T om i, on célébré encore à preient les divins o ffices
en la même langue. Cette traduâion. de'
l’écriture pour les Goths , étoit fans doute celle
d’Ulfiia , dont j’ai parlé en fon temps ; mais je ne
Cçache point d’autre lieu où il foit dit que l’on
O o o il