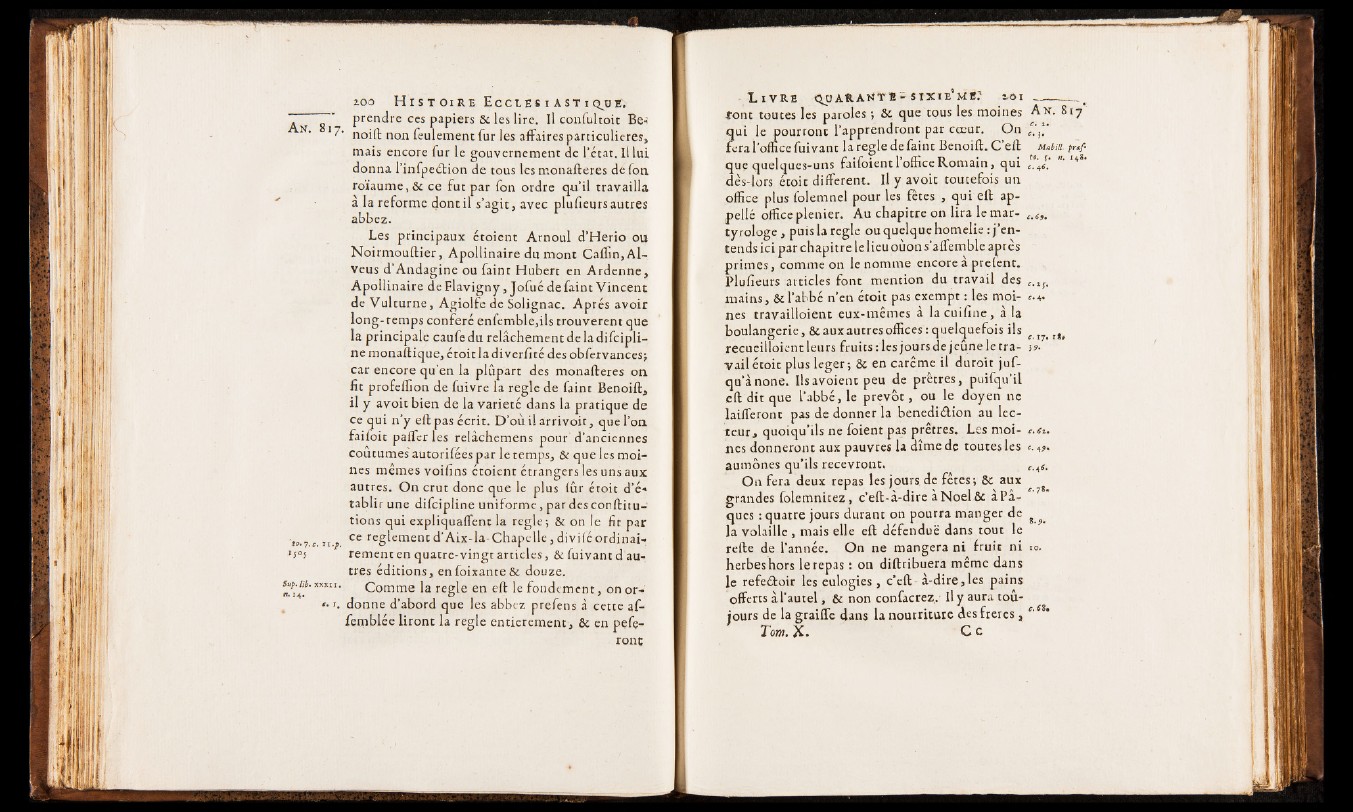
aoo H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e '.
" prendre ces papiers 8t les lire. Il confultoit Be-
1 noift non feulement fur les affaires particulières,
mais encore fur le gouvernement de l’état. Il lui
donna l’infpeôbion de tous les monafteres de ion
roïaume,& ce fut par fon ordre qu’il travailla
a la reforme dont il s’ag it, avec plufieurs autres
abbez.
Les principaux étoient Arnoul d’Herio ou
Noirmouftier, Apollinaire du mont Caflîn, Al-
Veus d’Andagine ou faint Hubert en Ardenne,
Apollinaire de F lav ign y , Jofué de faint Vincent
de Vulturne, Agiolfe de Solignac. Après avoir
long-temps conféré enfemble,ils trouvèrent que
la principale caufe du relâchement de la difcipli-
ne monaftique, étoit la di verfi té des obfervances;
car encore qu’en la plupart des monafteres on
fit profeifion de fuivre la réglé de faint Benoift,
il y avoit bien de la variété dans la pratique de
ce qui n’y eft pas écrit. D’où il arrivoit, que l’on
faifoit pafTer les relâchemens pour d’anciennes
coutumes'autorifées par le temps, & que les moines
mêmes voifins étoient étrangers les uns aux
autres. On crut donc que le plus fûr étoit d’établir
une difcipline uniforme, par des conftitu-
tions qui expliquaffent la réglé; 8c on le fit par
■tl). y c , , f ce règlement d’Aix-la-Chapelle, divifé ordinai-
*5°j rement en quatre-vingt articles, & fuivant d autres
éditions, en foixante 8c douze.
Comme la réglé en eft le fondement, on or-
*• u donne d’abord que les abbez prefens à cette af-
femblée liront la réglé entièrement , 8t en pefçront
L i v r e q u a r a n t e - s i x i e ’ m b ? i » i ---------
ront toutes les paroles ; 8c que tous les moines A n . 817
qui le pourront l’apprendront par coeur. On
fera l’office fuivant la réglé de faint Benoift. C ’eft MM.prt.f-
que quelques-uns faifoient l’office Romain, qui ";//
dês-lors étoit différent. Il y avoit toutefois un
office plus folemnel pour les fêtes , qui eft ap-
pellé office plenier. Au chapitre on lira le mar- c,6>.
tyrologe, puis la réglé ou quelque homelie : j ’entends
ici par chapitre le lieu oùon s’aifemble après
primes, comme on le nomme encore a prefent.
Plufieurs articles font mention du travail des c, 1$%
mains, 8c l’abbé n’en étoit pas exempt : les moi- >.*■
nés travailloient eux-mêmes à lacui fine, à la
boulangerie, & aux autres offices: quelquefois ils c |L
recueilloientleurs fruitsdesjoursdejeûneletra- 3?-
v a il étoit plus leger-, 8c en carême il duroit juf-
qu’ànone. Ilsavoient peu de prêtres, puifqu’il
eft dit que l’abbé, le p ré vô t, ou le doyen ne
laiiferont pas de donner la benediétion au lect
e u r , quoiqu’ ils ne foient pas prêtres. Les moi- c .ei.
nés donneront aux pauvres la dîme de toutes les o>.
aumônes qu’ils recevront.
On fera deux repas les jours de fêtes; 8c aux
grandes folemnitez, c’eft-à-dire à Noël 8c à Pâques
: quatre jours durant on pourra manger de g
la volaille , mais elle eft défendue dans tout le
refte de l’année. On ne mangera ni fruit ni 10.
herbes hors le repas : on diftribuera même dans
le refeéfoir les eulogies, c’eft- à-dire, les pains
offerts à l’autel, 8e non confacrez, Il y aura toujours
de la graiffe dans la nourriture des frcres, e' 6 *
Tom. X» C e