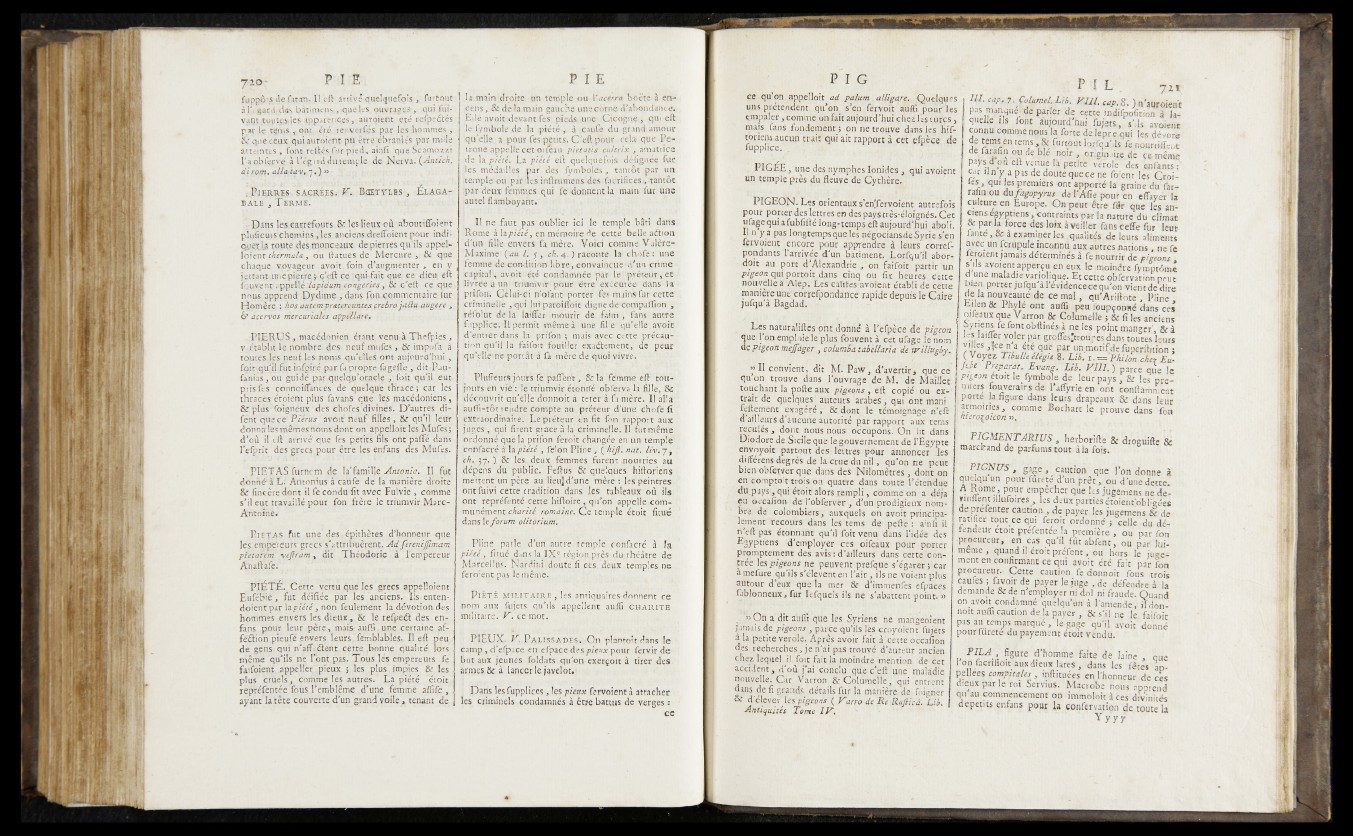
4e fstasn- Il eft dnrëÿ&4|U$igj}«f9 !$ji farfcwrt
à Ijt gard. des bâtinteos,, ,que les ouyrjgts „ qui fui-
vancitoiiceSjjes apparences,-.auraient été .pefpêftës
par le tSmS.*Qnt. :rèpjéè1tfâs;.par les hommes ,\
& qpeèéux- qui auroiènt, pu être!?branles par mille
atteintes , font reliés fur pied, ainfî que Scamo7.zi
l'a qbferv'e à l’ ëg rr| du temple de Nerva. (Antich.
ai rom. aLla-iav.- ÿ . ) » - *]•
, PiBRR-BS, SACREfS;. V. B.<ETYLfcS-, É lAÇA-
balh , T erme!
*' Bans leç eatrefours, 8c les -lieux où aboutifToient
plufieu,isÇhemins,,;les anciens dreffoient pour indique
ilia route .des.mpnceaux de pierres quaisappelé:
loienr thermals, , ou ftatues de Mercure ,1 & que
chaque voyageur. avoit. foin d’augmenter , en y
jettànr une pierre, ÿ ç’.eff ce, ^qui-fait que Ce djett éft
fQU-yent: appeilé.'/ap/Va^2-;con^eçÊ« , .fie .c’eft Ce que
no,us-, apprend- B y dime, dans fon çqmmentaire,.fuf
Homère : hos autem-prstereuntesçrebrûjaSu augere,
& àcervos mercuriales appellare. .
•PlJâl^IJS,, macédonien étant venu-à The/pies ,
y-.établit le nombre, des neuf, mufeis, & impofû . à
toutes les neuf.les-norns .qu’elles, ont aujourd’hui *
foit-.qû’il-'fut infpire par,fa prppre.fagëfledit Pau-
fanias , ou guîdé par,qnelqo’ora€le ,• foit. qu’.il eut.
pris ft s < cônnoiflances de quelque th'race ;'eâr lès
thrapes étoiefit plus fayàfts que r lék macédoniens,
&T plds ' (bigiîétiX • des chofeS‘divides'. D autres ‘dS—
fébe cjhé de1 Pierûs ; dy 6jç ÊelqFftffts , fiequ’il' leût
dûhnalèsmêmesnôms dont on appelloit'les Mufes5
d’où il t ft arrivé' que fes petits fils ont pafle oebis
l’efprit des grec? pour yfre‘ lès enfans des Mufes.
PIET'AS furnem tje IaTamillé Antomà. II fùjt
dônrié'à' TJ Aritoniusà caufe de la manière[imfyiÈ.
& fincère dont il fecondufit avec Fulvie , cVïmrrie
s’ il eut travaillé pour fon. .frète le; triumvir Marc-
Avtomè/
P;ie ta s fut une des, épithètes d’honneur qije
les èfepréreurd grecs s’ attiiHùèrén
pî&u&Ài veJFfàiti^ dit I Théodoric, â ^rpïnpçréiir
Anaffafe.
P IÉ TE . Çôtte vertu due* le s . grecs appeîloient,
Euféoié y fut deified par,' les anciens. I|s:enten"i
dotent par là/zers-y non feulement la dévotion des
hommes’envers lésdieux^ & iLptëÿÿM d f l ‘
fans pour leur père, mais- auffî, ùjjç.
feili0h.Rieufe.envetsrieursr'j!etnhwfesv H èft p e u ,
dé gÇPSi.phf n’ affïéfpnt. cette .hanne qualité; lors
même qn’ils né l’ont.pas, Tous! lés èurpérepts'Jèp
fatfoienf. jppiéirerüptéux > les. .plus , impies. & Ips.
plus qrueb’^ corruikdeiAutres/ Là^pîetq
repréfentée fous, l’emblème d’une .femme
ayant la tête couverte d’un grand yoilV, tenant de
la main droite un ternple ouTacerra boëte à encens
j & de la.main gauche une cérufe d’abo.ndance1.
Eî-le- avoit devant fes pieds:lune.. Cicagnérj qui eft
iîeîfymbole de la p i é t é à caufe du grand amour
qu’elle^:a .pour fes petits; Cleftpour cela;.q;ue Pétrone
appelle cet oifèau pietatis pultrix , amatrice
de la piété; La piété eft quel.qtiejois dé.fign.ée. fut
; |.les médailles par des fymboles tantôt par un
; itemple-ou pif des inftrum'ens^dé«! facrifices^.tantôt
spar deux fÿmmes, qui fe1 donnent la main, tfur une
■autel' flamboyant. <
| Il ne .faut pas" oublier ici le ..temple bâti dans
Rome à la piété, en mémoire de cette belle aétion
è ’nni fille- envers fa'rtfère. Voici .comme Vïlère-
Maxime ( au i. i. 4, ) raconte! i'â! chofe : une
femme de condition libre, convaincue d’un crime *
capital:, avoit;.été condamnée par lel'préteur, et1
livrée:à un triümvir1 pour.^êfre:: exécutée- dans la -
iptd’ôtfi Gel#*©i R^ofanÿ poréér fts m jw fS 'f cëttè*':
cri'minéhè , qui hii'parOiflbit d.igfiéd^prApiffidn1^1
féfblut deda laiftèr,î'n)bub}r. de -faim-; fan's autre
fipplicâïOMipermit >mêmeiJunë filfèlüqiifëllé avoit
îd'énfrferdafis la1' p*fîfo_n mais avef cette îp ttÿ ù ^ j
Iti.oh qu’il la' faifoif fouiller! exaiftèment, de peur
squ’ellei-ne^Ofrât à fa !mère de'quohvivré.
i» PIufîeurs'joids'fe1 ^affenf, & la fdmm’e efr tod-
|otérs én Vié': 'le triumvir étonrfe^dbferyf 1^ nlfê, 8k ,
;|dééc?uVrifhnè^e'tl^nnoitîà' rerèt'à fa mère. If'all'd
'aufii-tôf ieudre co'mpfe'uu.préfeùr d’® a choreïi
extraordfnaire.''Le?pi’êtbur en Sf Iç^poft aux
^ uglss\, "qui fl?çnt'‘gtat:ê à la trimïnejlè! Il frfÿtîiême
ordonné cya'ëla prifon fèroft cHangefeeri irti"temple’
Jçonfâtire^lk piété,y f&én née.
\ 8f les^deuXj,femmes furent [nourries au
depèffs du fnîblir. Feftus ’& qué’qfiès, hîftoriê!rrs ;
piefteht un p'èce auJlieu]d’unè htère 1 les"peintres,
pnffuivi cetire tradition1 datis! ^es tableaux où ils.’
ont repréfenté cette miliaire., qii’oif!app’ell’é,com- '
munément cmrîï'é 'rûmàine. C e \emple ètoit ^'fitué
daflylé/irtam alîtoeiûïrt'. y ,
s. Pline -p’al-tq' d uttlgufr*e#ppp$e rojatâcnq^à Ta
^zézé, fitué dans la IX1;: région près:duf.thégtnî''de
Marceliu». Nardihi doufç^fi ceXdeiix.temp^es.nc
feroleiit pa). le même. ^
PiÉXÉ stjLtTASRE , le,s Jhïiq^res qonrtent ce
nom aux fujets qu’ils appellent au.ffi, CHARITE
militaire. V .' ce-mot?1’ . ,
' PXËUX.,T'.,Pa ï .i!ssa:p ? sw-Qp ‘planfùittdans le !
camp, d efp^ce en1 efpace dés pieux, pour fervir début
a.ux jeunesTpldats qu’ion-exerçoifâ tirer des
armes 8c à lancer le javelot.
j 'P f^ .1éfrf^pp4igeAv>^ les i^mBelsrjconda^tîési -à êwè battes de, Vergés t.
ce
çc qu’on appelloit, ad palum.
uns prétendent qu’on s’en fervoft auflî poùr'les
empaler, cornue oiÿaitaujourd’hui çlUzles u]pcs,>
mais fan? fondemèrit ; on ne trouve dans les hif-
tpriensAucun trait qui ait rapport 3 cet e.fp'èce de
, fppphcelfpS?
-- .PIGÉp, ,'une de^ nymphes lonides « qui avoient
un temple près du fleuve de Cythèr’éJ'
IlLcqp,. 7. Çolumel Lib. K I I l.C(tp , f , ) nTuroient
■ pas manque-de parler :de cette indifpofîcion à la-
. quelle ils font aujourd’ hui fujets, s’ils avoient
connu comme nous la. forte déJepre.qfi les dévoré \
f j £ ^.emSr encems,'&;furtOutlorfqu’ils fe-nourriff-i,t
j de,.««fin ou.de bfé noir , origin'jirA dé ce même
| pays d ou.eft venue la petite vérole des enfants :'
Hf f i t 11 n y a pasde doute que ce ne fofcnc les ( io i -
«R, xjui iesipremieTS ont apporté la graine du far-
rafm.ou dafagopyrus. de l’Afie pouf -eh effayér la
culture eu Europe. O a peut-être fdr que les arii
etensegymiens, contraints parla natUTé du climat
& par la force des loix à veiller fans céffe fur leur
lante ,.& a examiner les .qualités de leurs alimtsnts
av?c un fqrùpulqihcorinù. aux autresyiations, ne fe
i|rpjênf jamais déterminés à . fe iourrir de pigeons ,
; j,lls aV0Ifn t .^ % ä .£ n eux le.moinare fymvt&aut
d .une maladie variolique. Et cette obférvation peut
j ^ n s porter jùfiîu’àllévidencôGe qtf&n vient de dire
j|elanouveantéstfe ce niai, cfu'AriftoÉè , Pline,
- Rtlep 8c l ’hyle ont auffi. peu feupçonaé dans ces
oifeaux que Varton & Columelle j & fi fes anciens
I ne les point manger’, 8c à
i les iaiiîer yolei, par, grpflesj'troupes.dans toutes leurs
I JIc% î ! > | î i ^ J ^ ù h ;moti|ÿleiui}qrftltion i WËËB •/*** prfP?rae. Eyang. *Lib. VIÙ'. % pârcè que le
pigeon etoit le fymbole de. leur pays / & les pre-
^ • ^ Ter a® * i# f ir y r ia ’eri»oot • e è o f t à Â i t
porte la figure dans leurs drapeaux & dans leur
B armoiries, comme Bochart le prouve dans fou
K toièroçàscon'xidrl
PIGEON. Les orientaux s’en.Tervoient- autrefois
-pour porter des lettres en des pays três-èlôignés. Cet
ufagequi afübfifté long-temps^ftaujourd’hui abpli.
dja,n y.a Pas longtemps que les négdciansde Syrie s,’en
lei voient ^encore pour apprendre à lèurs I
pondants Tarrivée d’un patimen’t. Lorfqu’il abor-,
, doit au part d’Alexandrie ,'o it faifoit-partir'ùn
pigeon quipQrt;oit,daps cinq ou fix cp te
nouvelle à Alepi Le^'califes avôîent établi deedete I
manière Un'd-cofrefpohdance rapide depuis le Caire
-jufqidà'Bagdad. -
Les natutaliftès pht donnp à l ’èfpèce-çlç pi^on
quel 1 on emploie le^pks fouvent àjjççt ufage lq nom*
de pigeon mejfager , côïuhlfra tabellàrid de wiÛugbyl
7 I I co'nviënr, dit M rp aw , d’avertirËiquiîfiê5
",«ujoh trouve dans l’buvrage de M. ' d e M lilîet'
polie aux pigeons eft copié ou ex-
trait de quelques “ âîiteure 'arabes, qui ont mani
Kremept êxàgé’fê ^ & dont^ lé témoignage ri’eft
a arlleuis d ducuqe autorité par rappbrt aux tethd
re lié s - , -dont nous nous occdpons.'On lit dans
LModore de Sicile quèle gouvernement de FEgypte
envoÿioit partout des: lettrés-pour annoncer iles
differens degrés de la crue du nily qu’on ne peut
bien o'bfeÇVèt-qtie' dans des Nilomètres , dont on
enî®o>Ti.pt(a,'t't'rois>0u quatre dans foute l’éteâdàe
du» pays*, qui ècoif alors rempli, comme on a déjà
eu- ôvcàlîon A e l’ôbferve-r, d’un prodigieux nombre
dé colombiers, auxquels oîi avoit peineipa-
lement^ecôivrs dans les'tems de pefte : a-nfi-d
tt eft pas éto'nnktit qu’tl’îfbit Venu dans l’idé’e des
Egyptiens d ’ employer-ces oifeâux- pour p&tter
promptement des avis : d’ailleurs dans détte;con-
tréeièsp*g-eè/2t ne peuvent prefque s’égarer y-car
a fflefnre qu’ils s’élèvent en l’air , ils ne voient plus
autour d’eux qùè'la mer & d’ immerifss efp’a’èes'
fablonneux, fur lefquels ils -ne s’abattent fpoiiîtSi
Or /Oh a dit auffi que les Syriens ne mangeoient
J^mai? de pigeons, pàrce qu’ils le's çrpyoieYit fujets
5 U, petite verble. Après avoir fait,à cette .oecafîôn
d.esRecherches,, je n’afpas trouye d’-auteur ancien
clje^ lequel il fou fait la moindre mention de! cet
accident, d’où j ’ai conclu que c’elf une maladie
nouvelle. C ad Vatron .& Columelle, qui entrent î
dans de fi grands détails fur la maniéré de foigner
6 d’élever tes pigeons ( 'fa.no de Re Rufiicâ. Lib.
Antiquités Tente IV~.
PIGMENTARIUS t herborifte & drogùifte &
y roarcfcana de par&ms tout à la fors.
[ cau-tion. que Ion donne à
P ^ u un P°ur fureté d’un prêt, ou d’une dette
A Rome, pour empêcher que les jugemèns ne de-
vinlieqt îllufoires i^deüxparaesétbientdblîo-ées
de.R5?,fW de payer lès jugemens & de
ratifier tout ce qui fçroit ordonne' ; celle du défendeur
étoit ptéfèntee la preinjère, ou par fon
-procureûr, en cas qu’il fût abfent, ou par tüi-
meme , quand il étoit p réfent, ou hors le juge-
! ment en confirmant ce qui avoit été fait par fou
j procureur. Cette.:caution, fe donnoit fous trois
taufes ; favoir de payer le juge , de défendre- à. la
demande' & de n’employer ni dol ni fraudé. Quand
on avoit condàmné quelqu’ tin à l'aniendèy il don-
I noit auflî caution de la payer , 8c s’ il ne le faifoic
pas su temps marqué, le gage qu il avoir'donné
pour furete du payement étoit vendu.
PILA , figure d’homme faite de laine , que
I’od faenfioit aux dieux lares , dans les fêtes ap-
P?llees compilâtes , inftituées en l'honneur de ces
dieux par le roi Servius. Macrobe notis apprend
qu’au commencement' on immoloit à ces divinités
dcpeçîis çrifan? pour la confervatiçn toute la