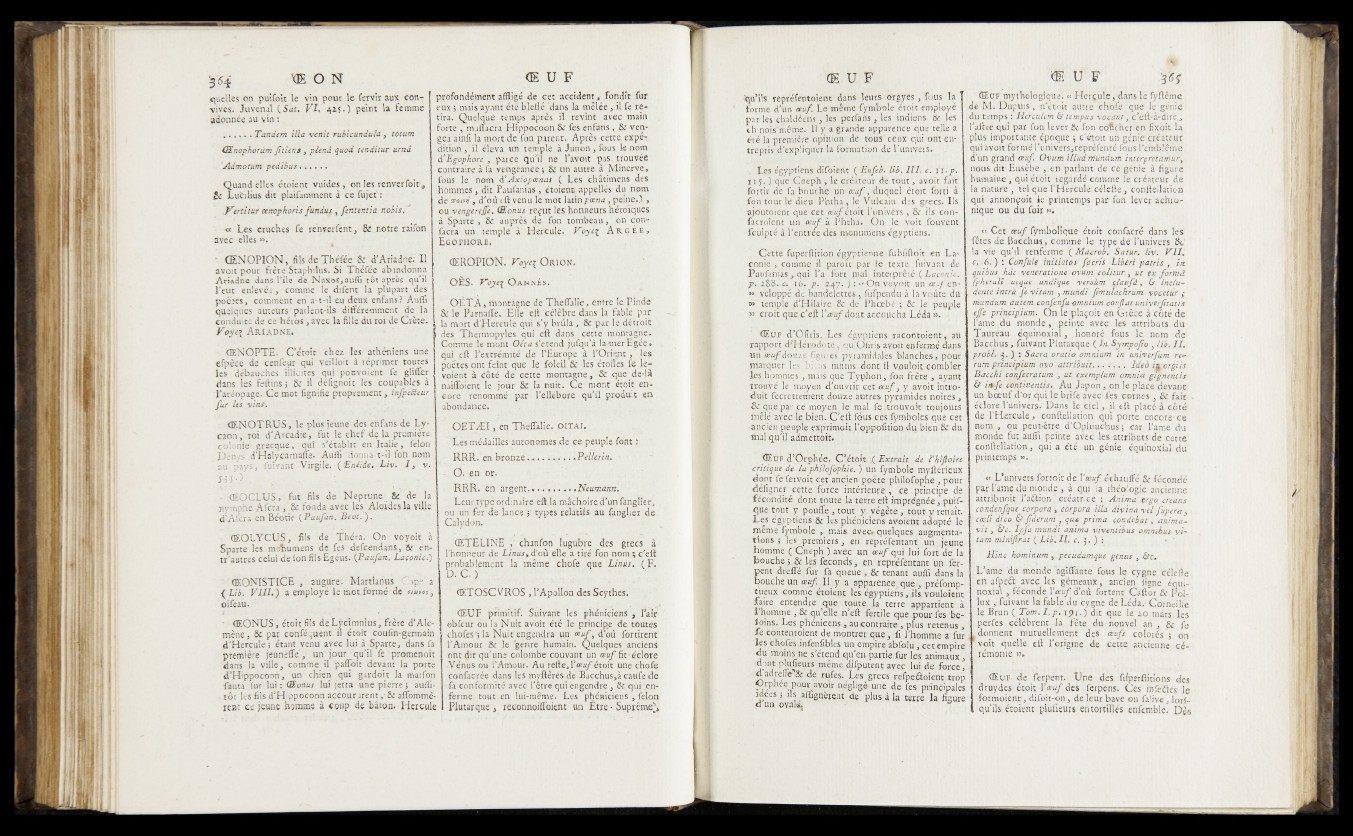
quelles on puifoit le vin pour le ferrit aux convives.
Juvenal (S a t. V I 4 15 .) peint la femme
adonnée au vin :
. . . . . . Tandem iÜa venit rubicundula , totum
(Enophorum f i tien s , plenâ quoi tendit ur umâ
Admotum pedibus............
Quand elles étoient vuides, on les renverfoin.
Si Lucilius dit plaifamment à ce fujet":
Vertitur cerropkoris fundus , fentendu nobis.
« Les cruches fe renverfent, & notre raifon
avec elles * . •
• G EN O P IO N , fils de Théfée & d’Ariadne: Il
avoit pour frète Staphtlus. Si Théfée abindonna
Ariadne dans Tîle de Naxbs,auffi tôt après qu'il
Peut enlevée, comme le difent la plupart des
poëies, comment en a-t-il eu deux enfans? Aufli
quelques auteurs parlent-ils différemment de la
conduite de ce héros , avec;la fille du roi de Crète.
Voyez A riadne.
(EN O PTE . C ’étoit chez les athéniens une
efpèce de cenfeur qui veilloît à réprimer toutes
les débauches illicites qui'poavoient fc glifler
dans les feftins, & il défignoir lés coupables à
l'aréopage. C e mot lignifie proprement, injpeBcur
fur les vins,
(E N O T R U S , le plus jeune desenfaùsde Ly-
caon, roi d'Arcadie’, fut le chef de la prcmièrê-
colonie grecque, qui s'établit en Italie, félon
Denys d’Halycarnafle. Aufli "donna-t-T fon nom
au pays, fuivant -Virgile. ( Enéide, Ltv. I , v,
s u - ) . [
- (E Q C LU S , fut fils de Neptune 8c de la
nymphe Afcra , & fonda avec les Aloïdes la ville
d’Afcra en Béotie ( Paufan. JBeot.).
: (E O L Y C Ü S , fils de Théra. On voyoit à
Sparte les. mobumens de fes dcfcendans, Se èn-
tr'antres celui de Ion fils Egéus. (Paufan, Laconie.)
' (EONISTICE , augure. Martianus Cape', a
/ Lib. V I I I .) a employé le mot.formé de ««»»s,
oifeau.
• (BONUS , étdit fils de Lÿçîmnius, frère d'Alcmène,
& par conféquent il éfoit coulm-germain
profondément affligé de cet accident, fondît fur
eux , mais ayant été bleiïé ‘dans la mêlée ,11 fe retira.
d’Hercule ; étant venu avec lui à Sparte Idans fa
première jeunëffé , un'jour qu'il fe proménoit
dans la ville, comme il pafioir devant la porte
d'Hippocoon, un chien qui gardoit la maifon
fauta fur lui-: (Emus lui jet ta une pierfe; a’ufîi-
tôt les fils d'Hippocoon accourarent , & afïbmmè-
ient ce jeune homme à coup de bâton. Hercule
Quelque temps après il revint avec main
fa r te , nuuacra Hippocoon & fès en fans, & vengea
ainfi la mort de foh parent. Après cette expfe-.
dition, il éleva un temple, à Jupon j fous le nom
d‘Egopkore , parce qu'il ne l'avoit pas trouvée
contraire à fa vengeance ; 8s un autre a Minerye,
fous le nom à’ Axiopcenat ( Les châtirnens des
hommes, dit Paufanias', étoienu appelles du nom
de 3-oiw», d'où eftvenu fe; mot latin poena, peine.J.»
ou vcngerçjfe. (Eonusxeqm lés honneurs héroïques
à Sparte -, & auprès de fon tombeau, ob cpn-
fâcrà un. fenaple'àr H^tüîé. Voyez
Egoehore.
(EROPION. Voyez O r ïo n *
' OÈS. Voyc% O an né s.'
O É .T À , montagne de Theffalie, entre fe’Pinde
& le Parnaffe. Elle ^êft célèbre dans la Fatale p-aç
i la mort d’Jrlerculequi s’y brûla V & par le détroit
( des, Thermopyles'qùi eft dans ’cette' montagne.
Comme le mont Oêia s’étend jtifqu a la-ruer Egée,
qui eft l'extrémité de l’Europe a"*1 l’O ri^ C CJes
poët çs ont Feint que le foleil & Les etôues^Xe le-
voient à côté de cette montagne,'St qfle de-là
naiffoient le jour 8c. la nuit. -Ce 'niont etoît eh-
cote renommé par l'ellébore qu’l] produit en
abondance’.
O E TÆ I , en Theffalïev orTAiV >v
T-Lès médailles autonomies de ce peuple font î _ '
R R R . en b rû h zé .^.. . . . . . . . Peilerfn.,»
jO.-en or-
RRR . en arg ent... . . ; i„;. .Neumann.
Leur type ordinaire eft la. mâchoire d’ un fanglier,
où un fer de- îance.T types.relatif s au fapgkêr de
Câlydon.
(ETELINE chanfon lugubre des grées:-à
l’honneur de Linus, d’où elle a tiré Fon nom ; c’eft
probablement la même' xhofeYqué Linus. ( ‘Et
D .C . )
(ETÔSCVROS, l'Apollon des Scythes!
<EUF primitif. Suivant les phéniciens’i F.aîr
ebfcùr ou la Nuit avôit été le principe <de toutes
chofeS'j la Nuitengendra' un oe‘if i d’où fortirent
l’Amour & le genre humain. Queiques anciëns
ont dit qu’une colombe:tômmtyxn é'uf fit-éë\oxe
■ Vénus ou’ i'Amour.Au refte., l’ng/rétoit une chofe.
confacrée dans les myfterés de Bacchus),à caufe de
fa conformité' avec l'être qui engendre , & qui ", enferme
tout^^ en lui-même. Les phéniciens , fdbtf
Plutarque, reconnoiffoient un Etre - Suprême^
(Eof mythologique. « H erçù le, dans le fyftême
de M. Dupuis, n’étoit autre chofe que le génie
du temps :■ lierculem 6 ’ tempus vocanr, c’eft-à-dire J
Qu’ils repréfentoient dans leurs -orgy es, fous- la
forme d'un eeuf. Le même fymbole étoic employé 1
par les chaldéeiis , les perfans , les indiens ete'Jes
ch nois^mêfiafe.-ll y a grande' aôparènçe que'tetfe’^a ‘
‘été la*prethiècë opf|s(3'n’^de tbùS' ceux qui ont bn-
tftpris d’expliqrfer la fhfm'âtjion dë l’uniyrîs. h
. Les égyptiens difoient ( .Eü/cÆ. 'lib\ III. c. 11. p. 1
1 j ytj^qtré Cffsphïi le oféateur dè fo u t, aÿdit Alt
fortir «fe fa bouché* un /«dptjftêfjîétbfFïorh à ;
fon four'ië-dieù P h tfhSÎ1*lë''.V n
addutoien't que cet,oeînféio|isI'unlvèrs ; & [ il's! S n -
facfoîébï m)f<xuf à PhthMïQhii le vqit fouvéïft
fculptéw entree dès mpnuirlen.s, ég'ÿptiëns.f
. Cette fuperftitîon égyptienne fubfiftoit en Laconie
j comme il paroit par le texte fuivant de ;
paujnfhjasC p'pi l ’a£ :£ort,m^ ip.re rp rê (s gcu/iip.
p. iS^. c . ; ^*4"!* ; {vPvxvpfVtOit'Uiifjo^/îcii-
^ v llq p p c d,' I j a r r d v l ç j l f yl p^-ndu, 1 1 \ tpûtetda -
» .tt'pqle^d'f-Jda 15 b. d e .P lu rb tF Î .^ le. peuple.
» eiOjtjquc.c’éft 1 a^ d p n f iç c pu ç jja/F ^1 a ^ A .> '
I E ü f -;L es”; 1 xdQo atpi è n t „.au
d^ j& od ote, qu.Ojii H ayoït cnienne danS^
unyüüjf dquze n g i i r e s . - p y i j p ° h r
•"ùnafquer les biv.ns i n f i n i s 1 oifenmp!er
flous ^ L liras eu ft'Qi^ifJaet ;ar*.ç5 sjj^avo<t iqnîô- '
duit ctteftjîplit cfoti/’
ScVuejû jÊÇjnioy. cn^’le^ ijr^l, r^.;tr.qu«®!tï toujours';
'.;rrfêle âyeq,,fehlén.iGleft fousxey,’fymboles que cet,:
-âne ër i ’pç; mofe 1 x ;û i moi t l’qppoîition;du bien & du
mal qu'il admétwic..*' )
*tEÛF djQrpbéq. ExtrpitÊjde, F/fiJïoire
iymbole myftérieux
dont f&&ry^Yt;%èt anden poptq' philqfophepbur
ddi-»iei chtt^ foi ce inttiicure , ce prit cipc de!
'^fjppndi.té vdo,qt^uce|la.teiîre\eft1iii}.glégnée , puif-'}
y tpüti ,y renaît.
ffi'ÇîjeJti le s^ i^ jp én s avofèae^jppté Tel
mêm^iyijîboJ&^jtr^aia a'yec^quelques augmentations
j les premiers , en représentant ‘ un, jeune
' ' hbn)^e.-(i‘CnepK ï as ec un oe:ÿ,qui lui fortÆ.la
bouchpF&Fçs féconds , en -répréfentant.ùnf fér-
pent ârélfé Fur fa. qilqûe^, & tenant aitûi défis W
hop^he pn yeuf. J1 y g . apparèpçe^que, Ipj^ïamp- J
tueujc'cpmujp'ieitpienr les égyptiens,ylsVauloient
Faire entërjdre que, tput'&jla terre appartient à
l.mmqie ..SeQu’elle n’ eft fertile quempur fes'be-'
ioins^ Les phenicegs,, au contraire, plus retenus,
fe conpMwent de.mpriâ’eq qu e,d iv,-l’homme a fur
les chofesunfenfibles un'enp,pye,ahlfdu .cet empire:
: ^ en ■ patrieiiturîli^ animaux
dtnt plüfiejurs tpêpBdifputenj aVep iltdyjld force,
-d’adre(îè,& de rufes. Les grecs rafpeéoient trop
Orphee pomnayoïr négligé, une de fys principales
idées 5 ils affignèrept de plus à la terre la figure
; cl un ovate,; • > ' l
S(.foh coflcher én fixoit la
plus importante époque » c’étoit un génie créâtèur
[ quiàvoit formé runiversjrepréfenré.’foüs l’emblëmé
d'un g rand oeuf. Ovum illudmundum intérpretàrnur\
nous dit Eusèbe , en 'parlant de ce génie à figuré
humaine, qui écoit regardé comme le créateur dè
l'a nature tel que l’Hercule célefte, 'conftellàtîoH
qui1 annoriçoit le printemps par fon lever' achro-
\ ù^de’ *oü( duFoir
i '4 ’« Cet oei^'^nibDlièjiie'ptdih confaçré :dans les
ffaffs,d'e Bacchus, comme4 e ‘ type‘de’l’ilnivers &d
> lk'tpê’iqu’il' fèhfêrme ( M2 itp)W$fô;xcliird,lîv'. V I L
‘ ' Cdnfùle iniiiâios' fdpr-is 'Libcri patpig , in
t quibus thflÊ ç â è l p d u r - f , ut ex fotjnâ
undique versiim çlaufâ, & inelu—
j c^enpe.^tfyfaffANÿfcMi^, mundi fipn’ùpaçhrùtn v ’ocetur ,*
ï ’imyÆm: ai{temf cqpf^ttfp. anphiumpQnfiat upùverfitqtis
y^^.rp^mjfium.), Qnle%plj§pjt en Gfècc à< côté de
; l’ame du monde, peinte avec les attributs -du-
Taüteau équinoxial, honoré fous le nom de
Baeçhus ^,fu 1 P]utarqxxfi^^In Symppfio s <hb. I t .
pwbfy ÿ . ( f f l t h i W l in uptiverfum-re-‘
- ra'V2 prâczpVüOT oyo Æ«ri4«rV. • • ■ . . . Ideo in orgïis
. Bdcclf.1 csÆecrdtumt ,,ut exemplum omn^a^gignentis
& imfe continentis. Au Japon, oh le place devant
MvÆheufja’or quilte bÿfe aVeç;1fei£ eprnes , & fait
^eUc^c l'univers.'Dans le c iel, il eft placé à côté
de l’Hercule, ccnftellatîon qui porte encore’ ce
nom , ou peut-être d’Ophiuchus j car l’ame dût
f monde fut aufli peinte avec les attributs de cette
edfiftèllajipn a été un g«ii'4 4fjWoxiaI dis
1 p’ritùplnp^». f :
“ L’univers fortoit de l’a?«/ échauffé & fécondé
i par lame du monde , à qui la théologie ancienne
attribùoit l’aûion créatrice : Anima ergo créons
| cafiâmfque^c/fipor^,,j:,orpor,d Hla divina vel fupera , ,
I cccli dico &.fiderum , que, prima: condebat, anima-.,
i v ï ï j &c. Ipj'a mundi anima viveraibus omnibus vi-
! tarit rhin^rdÆfnb.M. c.
1 'kHthc- hommukt'0 petûdumqut genus l &c.
i L ’âme ’dù:'ùiqn& âgiffa^rite' fous'lq cygne célefte
en afpeét avec les gémeaux, ancien ligne équinoxial
, féconde l’oe«/d’où fortent Caftor Se Pol- ■
lux fuivant la fable du cygne de Léda.- ÇojrnèiBe
^ jde Br-ian Q FW- A ÿ îjip r . ) dit qpe le *0, mari le s '
4 r perle s célèbrent Ja ,ff te du-nouvel an , 8c fe
1 1donfienV mutuellement des beufs ’ colorés } on
. f voit .quelle eft l’origine de cette ancienne cé-
| rémonie _
i J. (Eue- de ferpent. Une des ftiperftitions des
druydes' étoit l’oe«/ des . ferpens. Ces infeftes le
1 formoient, difoit-on, de leur bave ou falive, lorl-
Pqu^is é'toient plufreurs entortillés enfemble. Dès