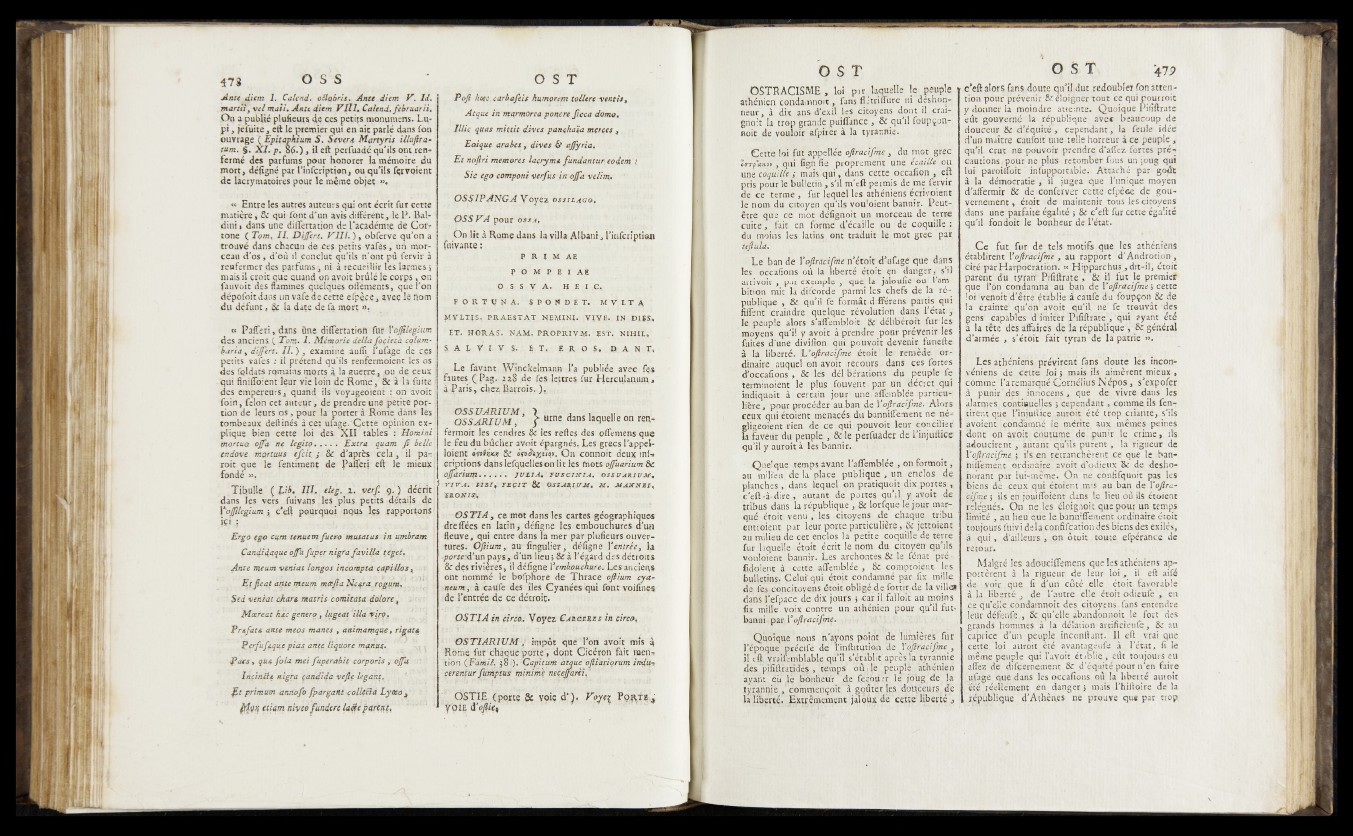
473 O S S
Ante diem I. Calend. oBobris. Ante d'uni V. Id.
mardi, v il maii. Ann diem F I I I . Calend. februarii.
On s publié plusieurs 4e ces petits manumens. Lu-
pi , jéfùite , eft le premier qui en ait parlé 4ans fan
ouvrage (Epitapkium S. Severt Martyres illufira-
fttm. §. XJ. p. 8<5. ) , il eft perfuadé qu'ils ontren-
fermé des parfums pour honorer la mémoire du
mort j défigné par l’infcription, ou qu'ils fçrvoient
3c iacrymatoires pour le même objet »,
« Entre les autres auteurs qui ont écrit fur cette
fmtière > & qui font d'un avis différent, le P. Bal-
dini » dans une differtatien d e l‘àçadértite de Corr
tone ( Tçm, IJ. Diffère. F I J I .) , obferve qu'on a
trouvé dans chacun de ces petits vafes» un mbr-
ceau d 'o s , d'où il conclut qu'ils n'ont pû fervir à
renfermer dés parfums p n i à recueillir lés larmes ;
mais il croit que quand on avoit brûlé le corps . on
fauvoit des flammes quelques olïéments, que r on
dépofoitdans un vafe de cette efpççç j aveç le nom
du dçfpnt, 8e la date de fa mort »,
« Pafferi, dans üne dilfertation fur XoffiBgium
des anciens ( Tarn- i . Mémorie délia foçîetà cqlam-
‘ baria, dijfert. JI. ) , examine auflr l’uûge de cgs
petits vafes : il prétend qu’ils renférmoiént les ois
des fqldats romains morts à la guerre,, pu de ceux
qui finiffoient leurvie loin de Romé j -« à 4i fèite
des empereurs, quand ilsvoyageoient ; cm avoit
foin, félon cet auteur , de prendre une petite portion
d e leurs o s , pour la p a rte rà ’Ronïë dans- lès
tombeaux deftipés à çef ufage.'Çettê opinion exr
plique bien cette loi des XII tablés ( Bomini
mortua ojfa rte legito. . . . . Extra quam f i belle
endove mortuus t f c i( y 8c d'après cela, il pa-s
ro it que le fentiment de Paiferj eft le mieux
fondé ». -
TibuHe ( Jàb, III,\ eieg, ^ , yerfi ‘fiLj déèrit
dans les vers fuivaps. les plus petits détails dp
Y'offllegium j c’eft pourquoi pqus les rapportons i
jçi j
Ergo ego cum tenuem fuero mutât us in ambrant \
Candijaque offh fltpfr nigra favifia ' tèget.
Ante TJieutn veniat langos incamp ta capillos, - -■ r
E t fie a t ante meurn mafia Mefra^pçgitrn, . .
Sed ventât chars, tkatris comitata dolore, ,!
Moereat hue généra , lugeat ilia viro.
Prefais ante meos mânes , animamque, ri gâte
, Perfufsqu,epias ante liquore manits.
pars, que foin mei fuperabit corporis } dffk n
InçinBs, nigra çàndida vefte legant. h .
fit primum annofofpargant çolleBa Lyoea y ; >
eùam niveo fundere laiïeparent.
O S T
Paß hecc (prbafeis kumoeem tollere ventte»
Atque in mnrmorea ponere ficca domo,
Illiç qttas mhtit dives panchaïa mçiçes ,
Eoique arabes, dives & ajjfyria.
. Et nofiri memores lacryms fundantur eodem t
Sic ego componi verf its in ojfa velim,
OS S IP ANGA Voyê* ossiz^ao,
Q S S F A pour ossÀ,
? .Ön lit à Rame dans la villa Albanie l’inferiptiaa
fuiyante :
F R % M Ag
P Ö M P E I AE
p ,5 S , y A . U E I . C,
F O R T 'y p 'iÀ - tB Q l I 'n .È f . ': A
M'YiT.iS, ERAEST4T, S M . Î N J - E .
? ET. H ÔRÀ? i. NA.M, PR’Ô PÎtlVM. ÇSf, NIHIL,
§ A I, V ( f S-;. & T , . £ R o j s , p . A N; T,
Lé favant. ^VincltelmanH l’a publiée avec fçs
fautes (iEag. 11$ ,de fes lettres fur Ilerculanuip *
4 Paris, chey, ßarrois.. ) vmK,
ossjiAmima, \ d WÊÊèÊm
- QSSARIUM i" urne «ans laquelle on ren-
fermoir les cendres 8e les relies des offémêns que
le feu du bûcher avoit épargnés, Les grecs l’appel-
ioient 8c IftfoxCv. On-' connoit deuf ink
çriptions dahslefquelleSonJlft les rnots ojfuarium 8c
ajfarium.. :i: f i firv^sAiipnSciIMiiJt.- laksdrUntirMf,
■ rvru; • sàntpfxç it & v «ssu^^car. * , m a xn z i,
'fxojftsn
O S T IA , ce mot dans les cartes géographiques
dreffées en latin, défignç les embouchures d’un
fleuve, qui entre dans la mer par plufieurs ouvertures.
Ofiium,, au*fiugtóier,'’ la
■ portrtd’un pays, d’un.lieu; 8c àiPégarddes détroits
& des riviçres, il déligne Yxmàauckut&i Les anciei^s
ont noipmé le befphore de Thrace ofiium cya,-
ineumpà éaiffe des îles Cyanéesiqui font voifînes
de l’entrée de cé détroit.
OSTIA in circa. Voyez Carceres in circo,
OSTIARIUM'-J impôt quë’Tori avoit, mis ù
'éh^qdq^jcftiç,- 'dqpt Ciçërôn fàit men^
’iibn QFdmil. fôfy.'Capîtuiiz âtque 'dfii'atiçrutn infiiiv
: iétpitur fUtriptus nfinitn\ neqemrifif ‘
■r OSTIË; (pprte & yoiç d ’ ) . Voyez
d’ rjrçj
b $ t
OSTRACISME loi par. daquelle le; peuple
athénien cohdaninoit, fans flltriffure ni déshon-j
neur, à dix ans d’exil les ,cjfoyens dont lie ra i-
gnoit la trop grande .puiffance , 8c qu’il foup^on-i
Boit de vouloir afpirèr à la tyrannie.
Cette loi fût appellée ofiraciffiè,, du mot grec
trrfaxùi, qui flgh lie piopremeut une écaille ,ou
une oô’quille i mais qui, dans cette occaflon , ,éfts
pris pour le bulletin, s’il m’ eft permis de me fervir
de ce terme, fur lequel les.athéniens'écrii’oienr
le nom du citoyen qu’ils vou'ôienrbannir. Peut-,
être que ,cç rnot-'dêlîgnoit un morceau de terre
cuite , faitjéèfli F^rrn.d :.^’éçajilje. d.e. ' e^iq'üdlp. ,
du moins les latins ont traduit le mot grec par
tefidla.
Le ban- de VofîrÙM/hie'n’ était d’ufage qaè ’4®^
les occalioBS où la liberté :étbit èh* dâiigéf f s’il <
ai fi v o it , par exemple; <, que" la jâloulîe ôu l'ambition
mit. lâdifcorde p’arrdilles chefs de la ré-
publique , &...qu'il fe formât diffiérens partis qui
filfent craindre quelque ‘révolution dans i'éta&ÿ
le, peuplé alors s'affembloit 8c' déhbéroît "fur leb
moyens qu'if y avoir à prendre pour prévenir des
fuites d’une divHson ‘qiuf,pouvoir devènir ftmeftei
à la; liberté. iL'ofirfcffihe éroit’ le,' remède!; or^
dinaire. auquel* eri‘ayoit .recours dans ces fortes
d’occafions, & fiés dél Hérations du peuple1 fe
ter'minoient le ■ plias fouvehù pat un 'tiécidt. qut
indiquait àiçeitain .jous^upe. aftembffie patmicu*-’
hère ,* pour -procéder au b an de X ofiracrfme. -Alors
ceux qaiéfeiént,v;meiiaeësi du banniffement nemé-*
gligeoient éien de Le .qui .pouvoir leur concilier
lâ-faveuf dupeuplé.^f&Ié perfuader de i'injuttice
qu'il’y àuï’oit’a<4 es banfîir^i ’d
^Quelque .tempsavant l’aflqmblée , on formoit,
au ;nàtIteûv qeîîa .placé publique', un eiicfos dé-’
planches, dans lequel,,on pratiquoit;dix p p rt^ d ||
çc eCtà-'dtrei» j autant dé porter qu’j^ y,- avoit de
tribus dgns la république , & lorfquejejpur mar-.
que-étpi|jvenu ,d,es, citoyen^ >4® chaque , tribu ‘
e-ntféient pàr leurporteparuciihère, & jqttqieqt
airmîliett de cet enclos la petite coqü’ilfe de terre ;i
fur.-kquelja. étpit écrit le nom du. c,itoyén’ qu’ils s
youloiept bander. Les archontes & le fénat pr^y
fido-ent à tce.tte qffen^Wée^ çoipipf^ient, les.
b,qllqlLUf> Çolui'qui, qtojt cond^tpP® par-T1.? - mille.
deT^potiçifey ens .étoif,obligé,d-e fprtir.de ,1a villes
dans l’efpace de dix jours ; car il fallolt au moins
fix mille, voix contre "un athénien pour qpii.fut-.
baafiipatt ri
Quoique1 nous n.’a}’ons point de lûmièrÇS,,fur
liéppjfcé:, dtéçiîtï 'de
if tft, viVifembiabl^ qu il^s’^tâblit, iîpfes la tyrannie
des, pi H lira ridés , 'temps où f Je ‘ peuplez athénien
ayiûjL-! çûf le 'de. fe b ü ^ l é pfi Jg
tyrannie ..commeirçoit' n goutér le.s,,'doi\cç'uj:s, dje
la jjmprtd. Eitt$j^ement jaloujf'de'cè^jsfiip.èftê^
O S T 479
c’eft alors fans„doute qu’ifdut redoubler fon attention
pour prévenir‘fe éloigner fout ce qui courroie
y donner la moindre atteinte. Quoique Pilîftrate
eût gouverné la république avec beaucoup de
douceur 8c d’équité, cependant, la feule idée
d’un maître criufoitî-ûné.tellehoVrëur à ce peuple ,
qu'il crut ne pouvoir prendre d'affez fortes pré-?
cautions < pour nm^ûtis retomber fous un joug qui
tb» parpitfoie infùpportablei Attaché par gojût
â‘ la démocratie J- il jugea que l’unique moyen
d’aflfermfr‘& deidcmfetvey «àÊté èfpèee de gouvernement,
étqit .d e maintenir tous les citoyens
dans ùne parfaite égalité ; & c’eft fur cetté égalité
qu'il fondoit le bonheur de l’état. ;
l..Ge fut. fur de/.igfts^mqti&.que. les athéniens
établirent'PoWacifîtà, àu fap^ort d’Androtion,
Eiré'parHatpdbiiti’<>ri.' « Hippbrchus^, dit-il 1 étoit
parent' du tÿ^air Kffift’ra ïè , 8c il fut le premiel
que l’âh coçdâhihd ' ati bah de Yaflrac^fme ; cette
loi ’venoit',d'é1reétlrblie'a caufê Su' foupçon 8c de
la crainte' .qü’drt^aVpit qi^Üÿ1 n’e' fe trouvât ‘des
gens! câpàbles; =d!'irhitèr Tiflfttate', ‘cju^ ayant été
a la tête dés âSàiréfe^ Ï4 ^ P ^ h q ü e y fe. général
d’armée , s’étbi’t fàit'-tyrandé la patrie » .' '
Les athéniehs/prévirent fans doute les incon-
ÿjéniëàs dé. cetté: \ mais ils awnèreijjt mieux ,
comme 'râ.r(emàrqué Cornélius Népos , s’éxppfef
à .pi^nir'.deSj in no cens que de vivre dans les
^krnjës^çontiBuéljlés ; cépe^dant *domine,ils feii-r
jirer.fque, rinjptttce.^jiroi^ été trôpiXriapte, s’ils
S voient.! condâmge mérite au^mêmespeines
dont on avoir cdutiifpè dë -punif 'të crime, ils
sddoucirent, , autant'qu ifs purent y fa Tigueur 'de
1 ‘oJhrycifine.f ils eaj^;tanc^èfen|t..cq que ,lft -^eutr
djadjqnx ,8é de desho-
horant pat iui-.memë,' Qh neacpnfifquôit pas les
ffbjèns dé ceux qui âcoîent.mis au.ban de Yoftra-
ïftfme j ils enjoujifoient dans le lieu où ÛS étoient
l^jqgués. .On né les mmgnoitTque.pdur'ûn temps
Rmité , au lieu' que le banniffement ordinaire étoit
toujours fuivi delà confffcation des biens des exiles,
a q u i, d’ailleurs, oq ôtoit toute efperance de
'-retour. >
l^âîgféife a^ucjffëméns 'qBe'les athéniens ap-
1 -poitèrent à la rigueur de leur* loi1», il eft aifé
d#r4Mf.f9né . f i d’un cûté .«die étoit. favorable
.g , ia‘'lmer,té,, ! de! ;Vafitre!. elle ;étoit bdiçùfe , en
cp qu’ejlë .côndamnoit des citoyens. fans entendre
'Jpifr défeoïe,, fe. qu’elle dbandonnoit le fort des
grands hommes à la délation ■ arcificieufe, & au
qapi’îoe d'un peuple in’conftant., Il eft vrai que
pté avantagéufo à l’état, fi le
’ipeme peuple qui l’avoir établi^ eût toujours eu
allez de difcernement 8e d'équité pour n'en faire
ufage duèjdans les occafions. où la liberté autoit
,' efé; jéellèment èn danger ; mais d ’hiftoire de la
république ' d’Athènes ne prouve que par trop