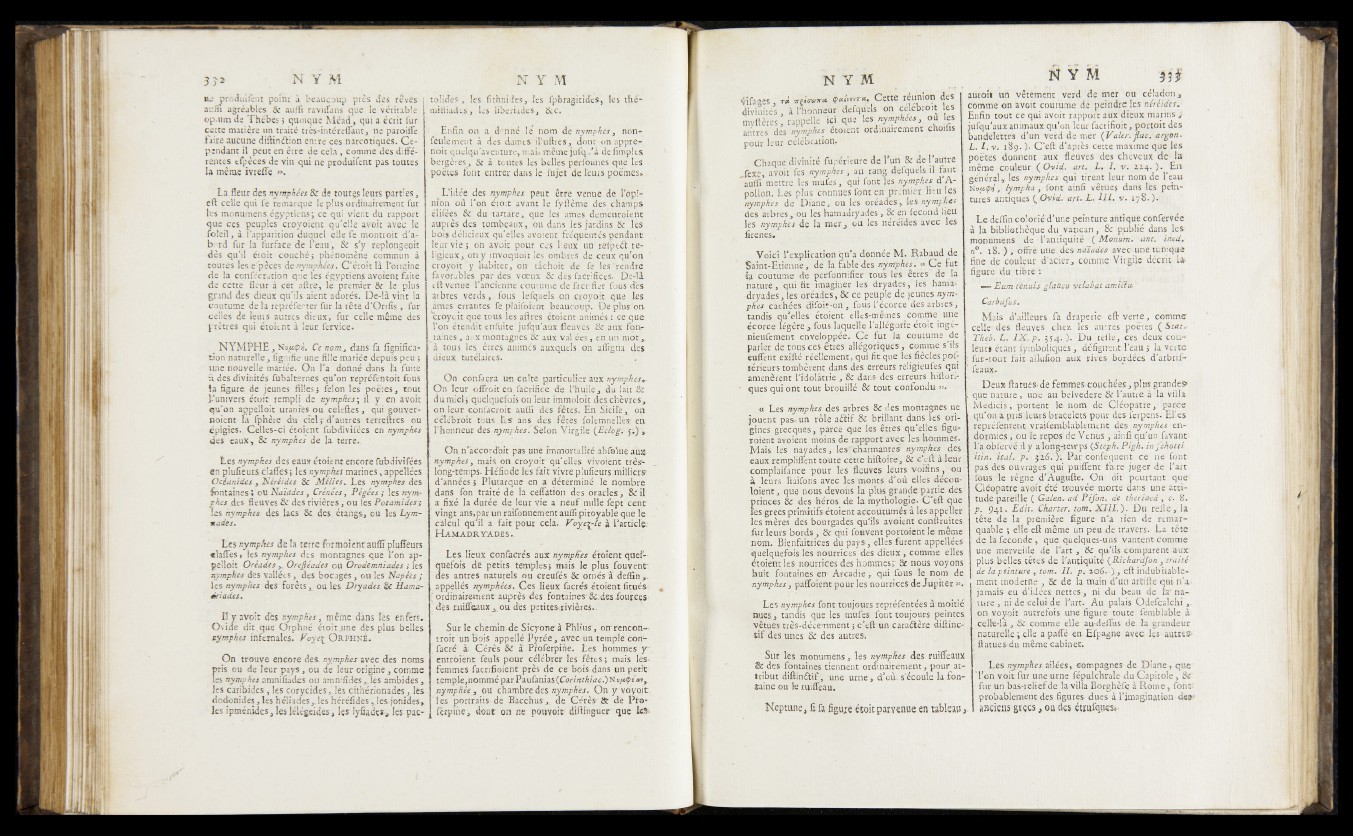
ne promurent poilu à beaucoup près des rêves
auffi agréables & auffi raviffatis que le véritable
op.nm de Thébes, quoique Méad, qui a écrit fur
cette matière un traité très-intéreffant, ne paroiffe
faire aufcune diftinélion entre ces narcotiques. C e pendant
il peut en être de cela, comme des différentes
tfpèces de vin qui ne produifent pas toutes*
la même ivreffe *>, ,
La fleur des n ym p h e e s & de toutes leurs parties,
eft celle qui fe remarque le plus ordinairement fur
les monuméns égyptiens i ce qui vient du rapport
que ces peuples croy oient qu'elle a voit avec le
foleilj à l'apparition duquel elle fe montroit d’abord
fur Ta furface de l'eau V & s'y replongeoït
dès qu’il était couché j phénomène commun à
toutes les espèces de nympkées. C'étoit là l’origine
de la confécration que les égyptiens avoient faite
de cette fleur à cet aftre, le premier& le plus j
grand des dieux qu'ils aient adorés. De-là vint la !
coutume de la repréferter fur la tête d'Orifis , fur !
celles de îeuis autres dieux, fur celle même des j
prêtres qui étoient à leur fervice-
N YM P H E , N Ci nam.i dans fa flgniêca- ,
tion naturelle, fîgnifie une fille mariée depuis peu ; ;
une. nouvelle mariée. On l'a donné dans fa fuite .
à. des divinités fübalternes qû’on repréfentoit fous
îa figure de jeunes filles ; félon les pceres, tout
l-'univers étoir rempli de nymphes-, n .y en avoir
qu'on agpelloit uranies ou celeftes, qui gouyer-
noient la fphère du eîel ;- d'autres terreftres où
épigies.. Celles-ci étoient fubdivifées en nymphes -
des eaux, & nymphes de la terre^
Les nymphes des eaus étoient encore fubdivifées
an plufieur& claffes; les nymphes marines, appéllées
Océanides , Néréides & Mélies^ Les nymphes des
fontaines ; ou Naïades , Crênées , Pégées ; les nymphes,
des fleuves & des rivières, ou les Potamides;
tes nymphes, des lacs S i des étangs, ou. les Lym-
nades.
Les nymphes d'e fa terre fbrmoienr suffi plufîeurs
•lattes, les nymphes des montagnes qufe l’on ap-
pelloit Oréades ^ Orefléades ou Orodtmniades ; les
nymphes des vallées, des bocages, ou ïes Nnpéis;
les-nymphes des Forêts,.ou les Dryades.&c Hamà-
driades.
fl y avoir dès nymphes, même dans les. enfers.
Ovide dit.que Orphné étoir .une dès plus belles
nymphes infernales. Foye^ Orehné.
On trouve encore des. nymphes7avec des noms
pris ou de leur pays, ou de leur origine, comme
les nymphes arrmiftâdes ou amnifîdes ,.Jés ambides ,
les caribides, les corycides,_Ies athérionadés, lès
dodonides , les hé]i'ades,,les héréfides,.Ies.jonides,
les ipménides, les lélégeides, Içs lyfiàdçsv les paetolicTes,
les fithnides, les fphragitides, les tlie*-
mittiades, les liberi-udes, Sec. ,
< , Enfin on a . donné. le nom de nymphes, non-
feulement à des dames d'affres, donc on appre-
noit quelqu'aveliture, mais même jufq..'à de Amples
bergères, St à toutes les belles perfounes que les
poètes foiit entrer dans le fujet dè'féms pqèfùfs^
L’idée des nymphes peut être venue dé Ippir
nîon où l’on était avant le fyfième dçs_ champs
éliféès & du tarcare, que les âmes demëiiroient
auprès des tombeaux, où dans les jardins & lçs
bois délicieux qu’elles aVoient fréquentés‘pendant
leur vie ; on avoir pour ces lieux un refpeét ier
-lîgieux, on y înVoquoit les ombrés de ceux qu’on
croyort ~y habiter, on tâchoit -de fe les "rendre
favorables par des voeux & des facrificés, 'De-la
eft venue l’ancienne coutume de façr;fier U0 $siy
arbres verds, fous lefquels on çroyoit que les.
âmes errantes fe pfeiforent beaucoup. De plus on,
croycit que tous les affres étoient animés : ce que-
l’on étendit enfuite jufqu aux fleuves 8? aux forfe-
^taines, aux montagnes & aux val ées, en un inot „
| à tous les. êtres animés auxquels oh affigna des
. dieux tutéjaires. ' '' '
j ' On confitçra un culte particuüer'aux nymphes*.
On leur offroit en facrifice de l'huile, du lait :8ç
dumielj quelquefois ori leur immoloir des,chèvres,
i on leur cqofacroit auflî dés fêtes. En' SjaTe ^ on
célébroit tous lès ans des fêtes folempellësî en
, l'honneur des nymphesfSdon Virgile (Eiïog# y.)1 »
On n’accord'pit pas une immortalité abfoliie aùx
; nymphes, mais on croyoffi qu'elles vivaient très“-
: long-temps. Piéfiode les fait vivre plufiéurs'Jriillierir
d'années ; Plutarque en a déterminé le nombre
dans fon traité de la ceffation des oracles1, & i l
a fixé la durée de leur vie a neuf millé fëpt'cenr
’ vingt ans,par un raifonnenîent auffi pitoyable que le
càlcul qu'il a fait pour cela. Voyelle à l'articlfe
; Hamadrtabes.. '
Les lieux confacrés auX nymphes étèîènt quelquefois
dè petits temples; mais fe plus fouvenf
des antres naturels ou creüfés & ornés ’â déffih
appelles nymphèes* Ces dieux faerés etoieot fitùés.'
I ordHiairetneat aupurès-dès fontaines* &:desk>üfçes-
' dès miflèaux,.ou des petites,rivières- '
Sur le chemin dè Sfèyone à Phl!ur,; onrfencoiî—.
troit un Bois appellePyrée:, aveo-hn .tetfiplë èbéC-
'fâcré i Gérés 8t à' Pîpferpîne.. Les hommes y^-
' entrbîënt- fèuîs pour célébrer les fêtes ; mais lès»
femmes facrifioiefit près de ce bois dans un petit
tempk,nommé par Paufanias (,ÇorintkïaeSS&v[*<Qimyi
nymphée, ou chambre des nÿmpfies. On y vôycyt
'le s portraits-.dè Bicchus,. dè Cérès^gt dë Pt®i
ferpihe, dont on . ne pouvoir difiinguer que f e
rhonnéürhefiïuljs 'tfn célèbrent les
«Çlfagès y
divini
ôiyftèrès , rappelle ici que l e s - o u J »
,ipc nvmfiÏÏes étaient ardmaireihefir cnqflis
'Chaque'divini té iïïp'é'r’isàre de l’un & ‘d'e l’ autre
fexe; avoir fes nymphes, au rang défquels il faut-
auflî mettre les mufes, q u f® t ‘|èsjAym^é^ d’A pollon.
Les' plus "connues font en premier lieu les
nymphes de pîàpe^’ ou lè s •Q^émè^0^ÿmfk''es
des’ arbres, où fis haimdiyaies, b^en^éccfiid^litu
les nymgk'eà àh du "mer , otffies néréides "IskC* les
firënes.
Voici l’ explicatiqfl *qtjfâ’ !dfnnép M . Rabaud^de
S airi t- fil eniref': H è liai' fa b 1 e'de's h y h r p 'h e s f “ C e fut
la coutume d'e'-'përfibnfiififer’Ypuydes^erres'*8ê‘ la
nature „’ÙÙt fit imaginer lës11 df y?oes y tés hamf-
tdryadev/ksi'oféadès, & ce peuple1’dè jeunes nym\\
ph s caohces dlfor on“,1 Dus l’ t to ite deS^lh'es j
icûn d is. pu^ll es< jé to <ènti jell t s- m ê me S une
écorce’légère , fous laquelle 1 allégorie éton mge-
Eteufement'}envel'oppee.. Ce fut Jâ^ jGou^ume dè
palier de tous ces eties allégoriques, comme s’ils
‘euffent fit qi>t ksficcles.pjsfférieurs
toÀ'bèretit d a n s 5d es |e|iié urs’ r e ifpeu fes qui
^menèrent jl.î'doUtiie & dài s des eireuis hifforfei
quês.qùî ont tdûe'Brouille & tout confondu
» « Les AyW&AdeSsb'tbfes 8c des mofitag&es ne
jouant pas- un rôlé'actft )éc brillant dans les ori-
Fgin'es gjècqùqs, ^âhcê qqe»|èS-;ê^Sgs qu’ el|es..figu- .
îoieiit àra.tntrmoms de rgfipürt av^ hommes.
Mais les nayadès ; lesTcJiarmanre?’ nymphes des
eaux>reffipliffent toute cefete^liffisite*,’ 8ë'c‘eft à-leur
cbrripluifanêe îppùr les fieuvey'Jéurs Voïfins ,'.ou
% deuu h iifoirs avec les’tfi'QÀtspa où èües déeou-
loient, que nous devoiis la plus grande part e des
prifiee's 8c‘Jdës -héros de la mythologie* C ’ëft que
les grecs.prîrhitifs»étOrent accoutumés à les appefier/
les mères déS bourgades qùfils avaient eonihuites
fur leurs bords'j 8c qui fonvent portoient le même
pom. Bièfifattricss du pays», elles.furent appelïées
quelquefois lés^nourrices des'diëdx, comuje dles
étoien't|k| nourrie« des hommes? 8e nous voyohs
huit fontaine^ .err Arcâdîè)'qui-fous‘Iè npm de.
t’nymphes ^ipaffoieqt ppurlés'nourrices de Jupiter
Lés nymphes font foujour&'tiepréfentées à; moitié
Eues, tandis que les mufes/font toujours peintes
yêtàfà'kès-décemment ; c’eft un-caraâère diftinc-*
*«f des J® es 8c des autres?
' Sûr' lés riipouraeasVles nÿmphe& des ruiffeauX
& de-s!fontaines tiennent ordinairementy'pdùr attribut
diftinétif j une urne, d’où;s’écoule k,fon-
ïaine ou k ruiffeau.
Neptune, fffafiguje étoit parvenue en tableau ,
aùroii un yëtérnçnt. verd dé nier ou céladon
a jmÈ Ê l on ‘avoir coumnié flc'peindrè.
Enfip tout ce qui avoir îàppdrt aux;aitux matins-J
jufqu’auxanimaux rafiion leur faciîfioitï portoit des
bandelettes ‘d’ iifi v e f d î f i e r ÇFuÊn jttib} ÿrfpn*
L. 1, C ’eft d’après cette maxmie que les
;|kétes-id‘onfie|it aux fteûvëoMes ëhêveùX lie* la
même '?* -
général v fes nymphes qui tirent leur nom de l’eau-
Nufüpjj, /ymÿ^rà, font ainfi vêtiies dans Ufs p«n-
tures â'Etiques (^.Ovid, yirt. L., '
-Lp peinture afi'tiqùfi da'nféf^ée
•-à Jâ bibli'aroeque du Vatican ,> Sc'pübfié daps J es
monùnrèns de^'fiandqùîcl ^MoAÙmJ ^ahd. irud.
rp°. ï 8 . ) , - o f f r ê ù i r é id e s mdïi'd'ès -a-veë- u r ie t û n 'q u e
fine,dp coukur d’ acier, comme Virgile djébrit la-
fi|ü^é-fdfii'tiere : 1 '
'■ V .— Eum t'enuzs glattco velahat amîclb i,
Carbafus.
Maif^A’^mêursjÆdraperi'eVeft-vèrt'e, comme
celle des fleuves chez les autres poëres ( Seat,
T,Ùh:- L. iX'kSpa lS .f'D ùfïè fiè , ce> defixjcôu-'
leurs étant fymboliques, défigirei.t l'eau ^^verts-
futptou& faii alkiîon aux üye^'BMâéfs d’arbrif-"
kfe.Deux ftatues de femmesïbouchéés, plus grande^
rS^'naaafei'liûne au belvédère1 St i’aüti&S'H| villa
•M éd i® ; portent 'le-5riofri* dp Oéopatfe ,i>patîêe
. cuJoft{a pri-S^eu^S'WVaqelqts pour des ferpens.' El'es
•æKiéfetiiieri^^viatfeïiablablemtpt des mmphes'tn-
dormiés, ouîfe repo? Be'Venus , ainfi qu’ un fivant»
Jt’a|ôjbfer^ë il y ®orrg^ewps {StèpklPigh. ïnfohotti
v^md-Maù p. - Æ6v7? Par cqnFëflaeifi: ce ne fôtit
pafi dés ôiiviàg.es'-qiai puiflem faire juger de d'art
tous‘de règbe d’AuguAei XDn 'djB pourtant que*
iCléôpatreiavIrftt' été'-koiiVegimorte flans' une atti-
‘ tude paiêffle ( (^lenjdld^PSïüfyi e^e thenacâ , c.f?-
p. 941. Edft., Charter. ,tom, iXIIi. Du reft-e,i.la
1 tête de da. ‘prqmigje figure- n’a fîèù de remar-
, diiablè : ÿlle eff même un pqu de tra|eîs. La tête
fte fe fccOnde, fque quelques-uns Vantent-comnie
. ùnetm.efcveiilè 'de l’art , 8c qu’ ils ebrriparen-t-ùux'
“ ( pYuàbeffes. ïëtês de fantiquité’ÇBdckardJan, traité
^ î détdpeini'ureÿ lom.HI. p\ ’eftnidllBitable-
;Lrirent moderne , 8c de la main d'un artfllq qui n'a-
> » jaqiai-s eu d’idées nettes,, ru du beau de ta* èa-
; ture , ni:de celui de l'art. Au palais Odefcalchî
on voyait autrefois une figure toute,* femblable à-
, celle-là, St comme elle au-defliis de la grandeur
’l 1 n â tu ^ lte ;^ e a paffé en Efpaghe ayefï Igs-autrèss
j ftatuesdu mêmeqabinek
Les nymphes.ailées, compagnes-de Diane, que*
' , T o n voit fur une urne fépulchrale du C apitole, 8s'
■ fur un bas-relief de la villa Borghèfç à Rome, font?
probablement des figures, dues à l'imagination des*
, anciens grecs, ou des ctxufques»-