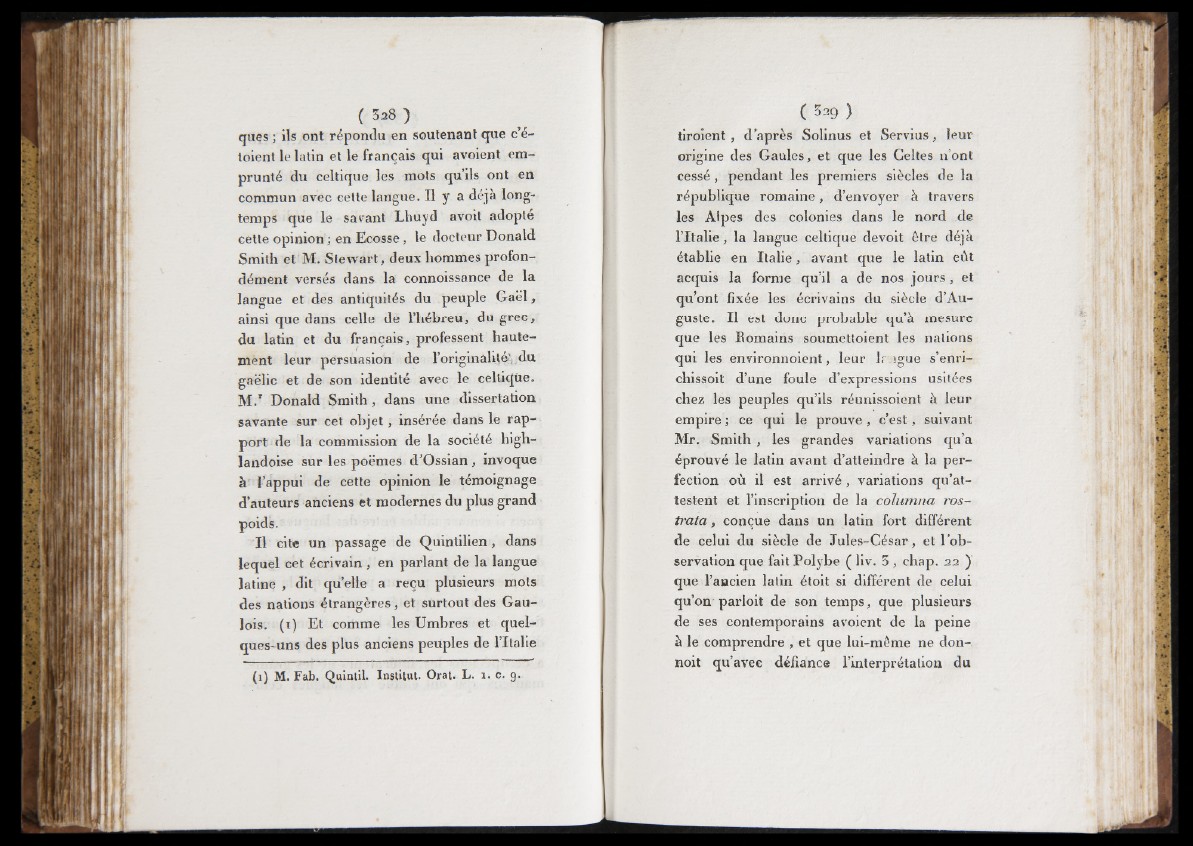
( 3a8 )
ques ; ils ont répondu en soutenant que c’é-
toient le latin et le français qui avoient emprunté
du celtique les mots qu’ils ont en
commun avec cette langue. Il y a déjà longtemps
que le savant Lhuyd avoit adopté
cette opinion ; en Ecosse, le docteur Donald
Smith et M. Slewart, deux hommes profondément
versés dans la connoissance de la
langue et des antiquités du peuple G a ë l,
ainsi que dans celle dé l’hébreu, du grec,
du latin et du français, professent hautement
leur persuasion de l'originalité?,,du
gaëhc et de son identité avec le celtique.
M.T Donald Smith, dans une dissertation
savante sur cet ob je t, insérée dans le rapport
de la commission de la société high-
landoise sur les poëmes d’Ossian, invoque
à' l’appui de cette opinion le témoignage
d’auteurs anciens et modernes du plus grand
poids.
Il cite un passage de Quintilien, dans
lequel cet écrivain , en parlant de la langue
latine , dit qu’elle a reçu plusieurs mots
des nations étrangères, et surtout des Gaulois.
(i) Et comme les Umbres et quelques
uns des plus anciens peuples de l’Italie
(1) M. Fab. Quintil. Institut. Orat. L. 1. c. 9.
C ï # )
tiroient , d ’après Solinus et Servius, leur
origine des Gaules, et que les Celtes n’ont
cessé , pendant les premiers siècles de la
république romaine, d’envoyer à travers
les Alpes des colonies dans le nord de
l'Ita lie , la langue celtique devoit être déjà
établie en Italie, avant que le latin eût
acquis la forme qu’il a de nos jou r s , et
qu’ont fixée les écrivains du siècle d’Auguste.
Il est donc probable qu’à mesure
que les Romains soumettoient les nations
qui les environnoient, leur lr.igue s’enri-
chissoit d’une foule d’expressions usitées
chez les peuples qu’ils réunissoient à leur
empire ; ce qui le prouve , c’e s t , suivant
Mr. Smith , les grandes variations qu’a
éprouvé le latin avant d’atteindre à la perfection
où il est arrivé , variations qu’attestent
et l’inscription de la columna ros-
trata, conçue dans un latin fort différent
de celui du siècle de Jules-César, et l ’observation
que fait Polybe ( liv. 3 , chap. 22 )
que l’ancien latin étoit si différent de celui
qu’on parloit de son temps, que plusieurs
de ses contemporains avoient de la peine
à le comprendre , et que lui-même ne don-
noit qu’avec défiance l’interprétation du