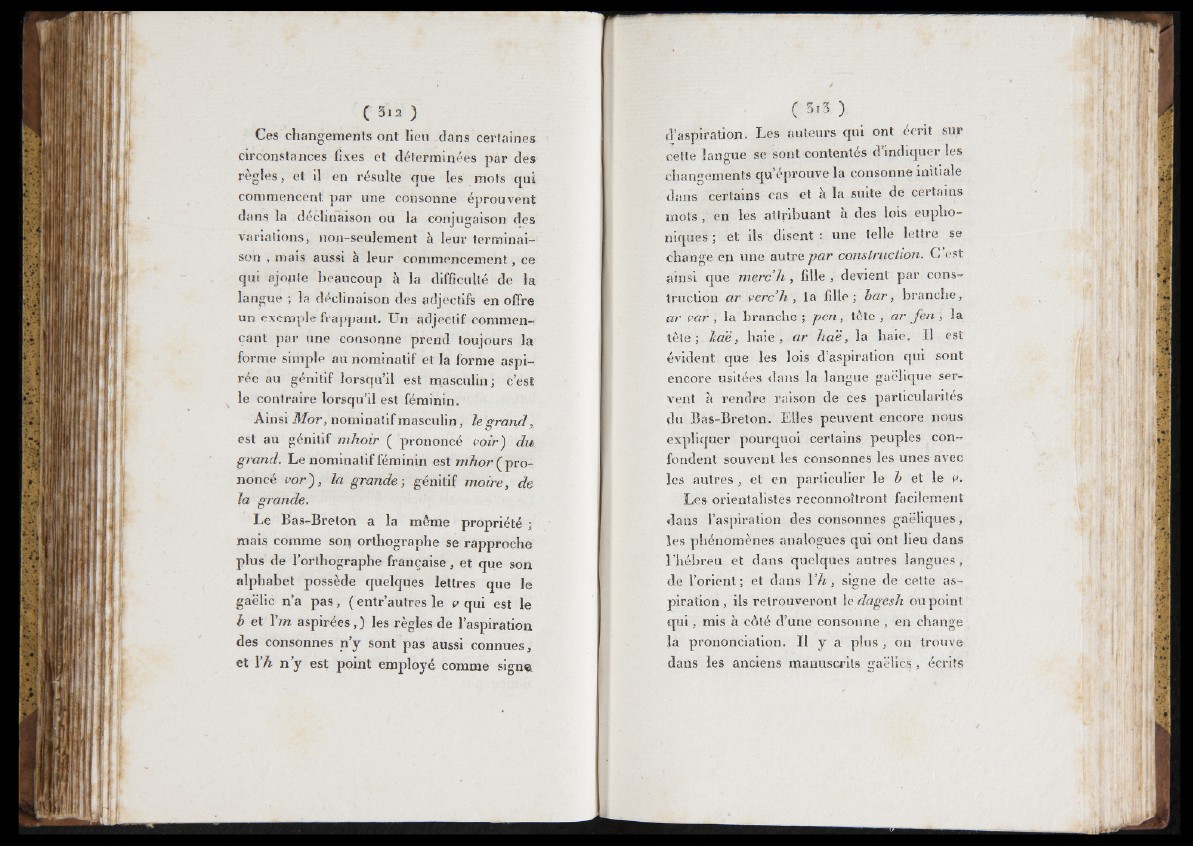
Ces changements ont lieu dans certaines
circonstances fixes et déterminées par des
réglés, et il en résulte que les mots qui
commencent par une consonne éprouvent
dans la déclinaison ou la conjugaison des
variations, non-seulement à leur terminaison
, mais aussi à leur commencement, ce
qui ajoute beaucoup à la difficulté de la
langue ; la déclinaison des adjectifs en offre
un exemple frappant. Un adjectif commençant
par une consonne prend toujours la
forme simple au nominatif et la forme aspirée
au génitif lorsqu’il est masculin; c’est
le contraire lorsqu’il est féminin.
Ainsi Mot, nominatif masculin, le grand,
est au génitif inhoir ( prononcé voir) du
grand. Le nominatif féminin est rnhor ( prononcé
vor), la grande ; génitif moire, de
la grande.
Le Bas-Breton a la même propriété ;
mais comme son orthographe se rapproche
plus de l’orthographe française , et que son
alphabet possède quelques lettres que le
gaëlic n’a pas, ( entr’autres le v qui est le
b et lin aspirées,) les règles de l’aspiration
des consonnes n’y sont pas aussi connues,
et 1 h n y est point employé comme signçt
d’aspiration. Les auteurs qui ont écrit sur
cette langue se sont contentés d’indiquer les
changements qu’éprouve la consonne initiale
dans certains cas et à la suite de certains
mots, en les attribuant a des lois euphoniques
; et ils disent : une telle lettre se
change en une autre pur construction. C est
ainsi que merc’h , fille , devient par construction
ar v e r ch , la fille; bar, branche,
ar var , la branche ; pen, tête , ar fen | la
tête; lidè, haie, ar haè , la haie. Il est
évident que les lois d’aspiration qui sont
encore usitées dans la langue gaélique servent
à rendre raison de ces particularités
du Bas-Breton. Elles peuvent encore nous
expliquer pourquoi certains peuples confondent
souvent les consonnes les unes avec
les autres , et en particulier le b et le v.
Les orientalistes reconnoîtront facilement
dans l’aspiration des consonnes gaéliques,
les phénomènes analogues qui ont lieu dans
l ’hébreu et dans quelques autres langues,
de l’orient; et dans l ’h , signe de cette aspiration,
ils retrouveront \e dagesh ou point
q u i, mis à côté d’une consonne, en change
la prononciation. Il y a plus , on trouve
dans les anciens manuscrits gaëlic^ , écrits