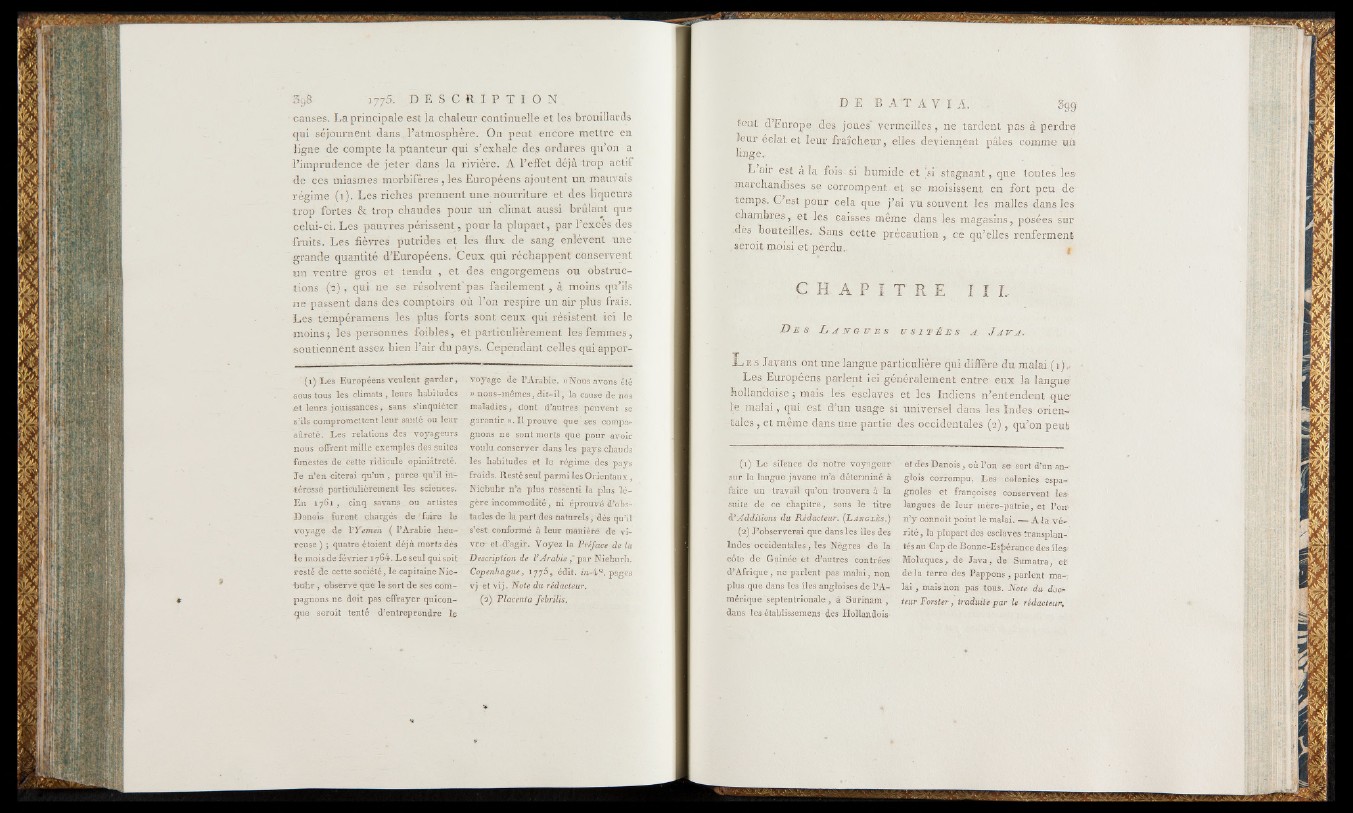
causes. La principale est la chaleur continuelle et les brouillards
qui séjournent dans... P atmosphère. On peut encore mettre en
ligne de compte la pùanteur qui s’exhale de.s ordures qu’on a
l’imprudence de jeter dans la rivière. A P effet déjà trop actif
de ces miasmes morbifères , les Européens ajoutent un mauvais
régime (1). Les riches prennent une nourriture et des liqueurs
trop fortes & trop chaudes pour un climat aussi brûlant que
celui-ci. Les pauvres périssent, pour la plupart, par l’excès des
fruits. Les fièvres putrides et les flux de sang enlèvent une
grande quantité d’Européens. Ceux qui réchappent conservent
un ventre gros et tendu , et des engorgemens ou obstructions
(*2), qui- ne se résolvent' pas facilement, à moins qu’ils
ne passent dans des comptoirs où Pon respire un air plus frais.
Les tempéramens les plus forts sont ceux qui résistent ici le
moins3 les personnes foibles, et particulièrement les femmes,
soutiennent assez bien l’air du pays- Cependant celles qui appor- 1
(1) Les Européens veulent garder,
■ sous tous les climats , leurs habitudes
e t leurs jouissances, sans s’inquiéter
s’ils compromettent leur santé ou leur
sûreté. Le s relations des voyageurs
nous offrent mille exemples des suites
funestes de cette ridicule opiniâtreté.
Je n’en citerai qu’u n , parce qu’il intéresse
particulièrement les sciences.
En 1761 , cinq savans ou artistes
Danois furent chargés de faire le
voyage de VYemen ( l’Arabie heureuse)
; quatre étaient déjà morts dès
le mois de février 1764. L e seul qui soit
resté de cette société, le capitaineNie-
h u h r , •observé que le sort de ses compagnons
ne doit pas effrayer quiconque
seroit tenté d’entreprendre le
Voyage de l ’Arabie. «Nous avons été
» nous-mêmes, d it-il, la cause de nos
maladies, dont d’autres peuvent se
garantir ». Il prouve que* ses compagnons
ne sont morts que pour avoir
voulu conserver, dans les pays chauds
les habitudes et le régime des pays
froids. Resté seul parmi les Orientaux,
Nicbuhr n’a plus ressenti la plus lé gère
incommodité, ni éprouvé d’obstacles
de la part des naturels , dès qu’il
s’est conformé à leur manière de viv
re et.d’agir. Voyez la Préface de là
Description de VArabie,' par Nieburh.
Copenhague, 1775, édit. m-4u. pages
vj et v ij. Note du rédacteur.
[2). Placenta f e b r iU s .
tent d’Europe des joues* vermeilles, ne tardent pas à perdre
leur éclat et leur fraîcheur, elles deviennent pâles comme un
liqge..
L air est a la fois si humide et ’si stagnant, que toutes les
marchandises se corrompent, et se moisissent en fort peu de
temps. C’ est pour cela que j’ai vu souvent les malles dans les
chambres,. et les caisses même dans les magasins, posées sur
.dès bouteilles. Sans cette précaution , ce qu’elles renferment*
seroit moisi et perdu..
C H A P I T R E I I I .
D e s . L a n g u e s u s i t é e s a. J a v a *
T T JL es Javans ont une langue particulière qui diffère du malai (i)>
Les Européens parlent ici généralement entre eux la langue'
hollandoise j mais le's esclaves et les Indiens n’entendent que'
le malai, qui est d’un usage si universel dans les Indes orientales
, et même dans une partie des occidentales (2) , qu’on peut 1 2
(1) Le silence de1 notre voyageur
sur la langue javane m’a déterminé à
faire un travail qu’on trouvera à la
suite de ce chapitre, sous le titre
d'Additions du Rédacteur. ÇLanglès.)
(2) J’observerai que dans les îles des
Indes occidentales, les Nègres -de la
côte de Guinée et d’autres contrées
d’Afrique, ne parlent pas malai, non
plus que dans les îles angloises de l’Amérique
septentrionale, à Surinam ,
dans les établissemens des Hollandois
et des Danois, où l’on se sert d’un an--
glois corrompu. Les colonies espagnoles
et françoises conservent les-
langues de leur mère-patrie, et l ’on'
n’y connoît point le malai. — A la v é - ;
ri té, la plupart des esclaves transplantés
au Cap de Bonne-Espérance des îles'
Moluques, de Java, de Sumatra, ef-
dela terre des Pappons, parlent malai
, mais non pas tous. Note du docteur
Forster, traduite par le rédacteur;