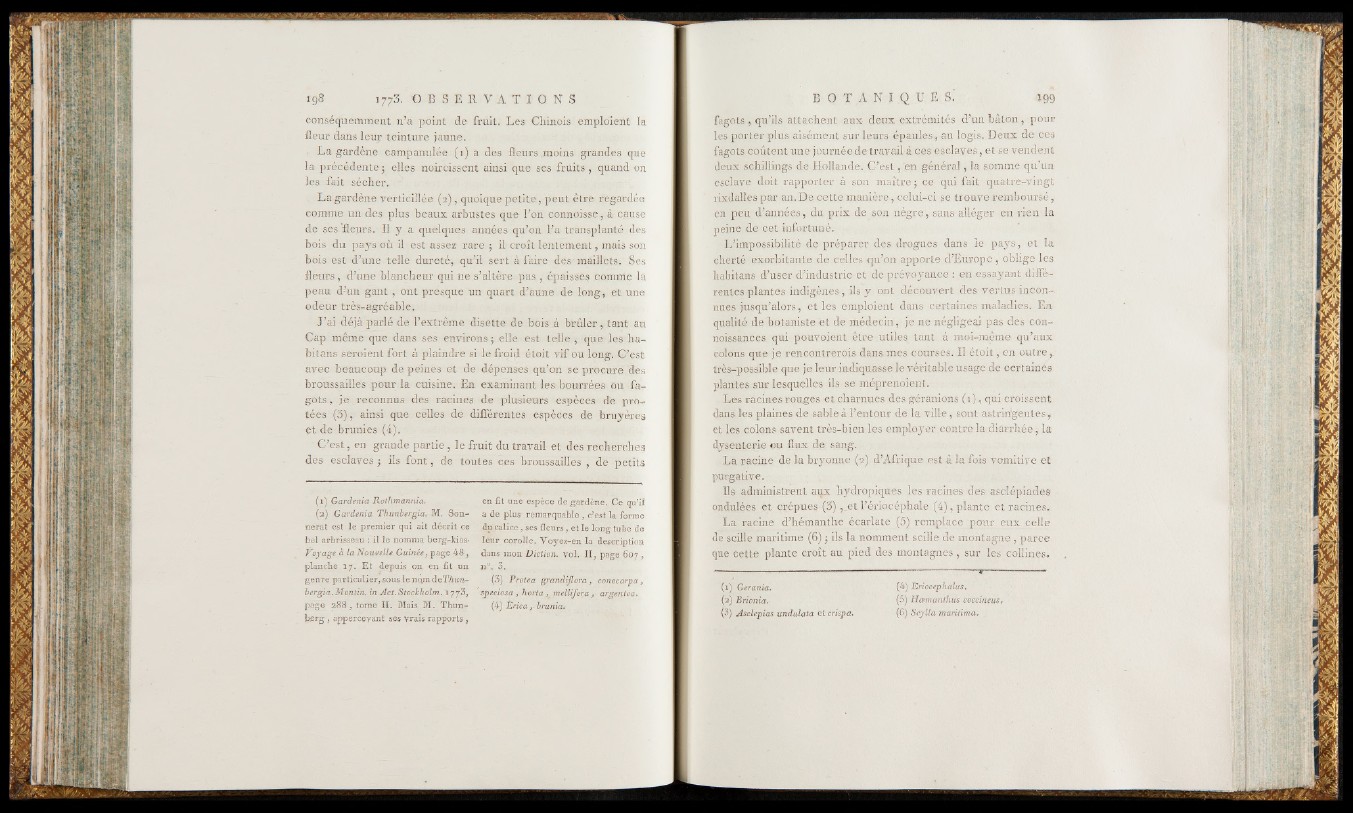
conséquemment n’a point de fruit. Les Chinois emploient la
fleur dans leur teinture jaune.
La gardène-campanulée (1) a des fleurs moins grandes que
la précédente; elles noircissent ainsi que ses fruits , quand on
les fait sécher. '
La gardène yerticillée (2), quoique petite, peut être regardée
comme un des plus beaux arbustes que l ’on connois.se, à cause
de ses fleurs. Il y a quelques années qu’on l’ a transplanté des
bois du pays où il est assez rare ; il croît lentement, mais son
bois est d’une telle dureté, qu’il sert à faire dés maillets. Ses
fleurs, d’une blancheur qui ne s’ altère pas , épaisses comme la
peau d’un g an t, ont presque un quart d’aune de long, et une
odeur très-agréable.
J’ ai déjà parlé de l’extrême disette de bois,à brûler, tant au
Cap même que dans ses environs 5 elle est telle , que les ha-
bitans seroient fort à plaindre si le froid étoit vif ou long. C’est
avec beaucoup de peinés et de dépenses qu’on se procure , des
broussailles pour la cuisine. En examinant les bourrées Ou fagots
1 je reconnus, des racines de plusieurs espèces dé prêtées
(3) , ainsi que celles de différentes espèces de bruyères
et de brunies (4).
C’est, en grande partie, le fruit du travail et des recherches
des esclaves 3 ils font, de toutes ces broussailles , de petits 1
(1) Gardénia Rothmannia.
(2) Gardénia ThunbèrgiaM. S on-
n erat est le prem ier qui ait décrit ce
bel arbrisseau ; il le nomma berg^-îdas-
Voyage à la Nouvelle Guinée, page 48 ,
planche 17. E t depuis on en fit un
gen re p articulier, sous le no.m deThun^
bergia. Mon tin, in Act. Stockholm. 1773,
page 2 8 8 , tome II. Mais M. Thun^
b firg , appercevant ses vrais rapports ,
en fit une espèce de gardène. Ce qu’il
a de plus .rem arquable , c’est la forme
du calice , ses fleurs, et le long tube de
leu r corolle, Y oyez-en la description
dans mon Diction, vol. II, page 6 0 7 ,
n °. 3 .
(3) Protea grandîflora, conocarpa,
speciosa, horta, mellifera, argentea.
(4) Ericaf'brunia<
fétgots , qu’ils attachent aux deux extrémités d’un bâton , pour
les porter plus aisément sur leurs épaules, au logis. Deux de ces
fagots coûtent une journée de travail à ces esclaves, et se vendent
deux schillings de Hollande. C’est ,'en général, la somme qu’un
esclave doit rapporter à son maître; ce qui fait quatre-vingt
rixdalles par an. Dé cette manière, celui-ci se trouve remboursé,
en peu d’années , du prix de son nègre , sans alléger en rien la
peine de cet infortuné.
L ’impossibilité de préparer des drogues dans le pays , et la
cherté exorbitante de celles qu’on apporte d’Europe, oblige les
habitans d’user d’industi'ie et de prévoyance : en essayant différentes
plantés indigènes, ils y ont découvert des vertus inconnues
jusqu’alors, et les emploient dans certaines maladies. En
qualité de botaniste et de médecin, je ne négligeai pas des con-
noissances. qui pouyoient être utiles, tant à .moi-même qu’aux
côlons que je rencontrerais dans mes courses. II étoit, en outrey
très-posSible que je leur indiquasse le véritable usage de certaines
plantes sur lesquelles ils se méprenoient.
Les racines rouges e t charnues des géranions (1), qui croissent
dans les plaines de sable à l’entour de la ville, sont astringentes,
et les colons savent très-bien les employer contre la diarrhée, la
dysenterie ou flux de sang.
La racine de la bryonne (2) d’Afrique est à la fois vomitive et
purgative.
Ils administrent aux hydropiques les racines des asclépiades
ondulées et crépues (3) ,_et l’ériocéphale (4), plante et racines.
La racine d’hémanthe écarlate (5) remplace pour eux celle
de scille maritime (6) ; ils la nomment scille de montagne, parce
que cette plante croît au pied des montagnes, sur les collines.
(1) Gerania.
(2) Brionia.-
(3) Asclepias undulata et crispa.
(4) Eriocephaius.
(5) Hcemanthus coccineus,
(6) Scylla maritima.