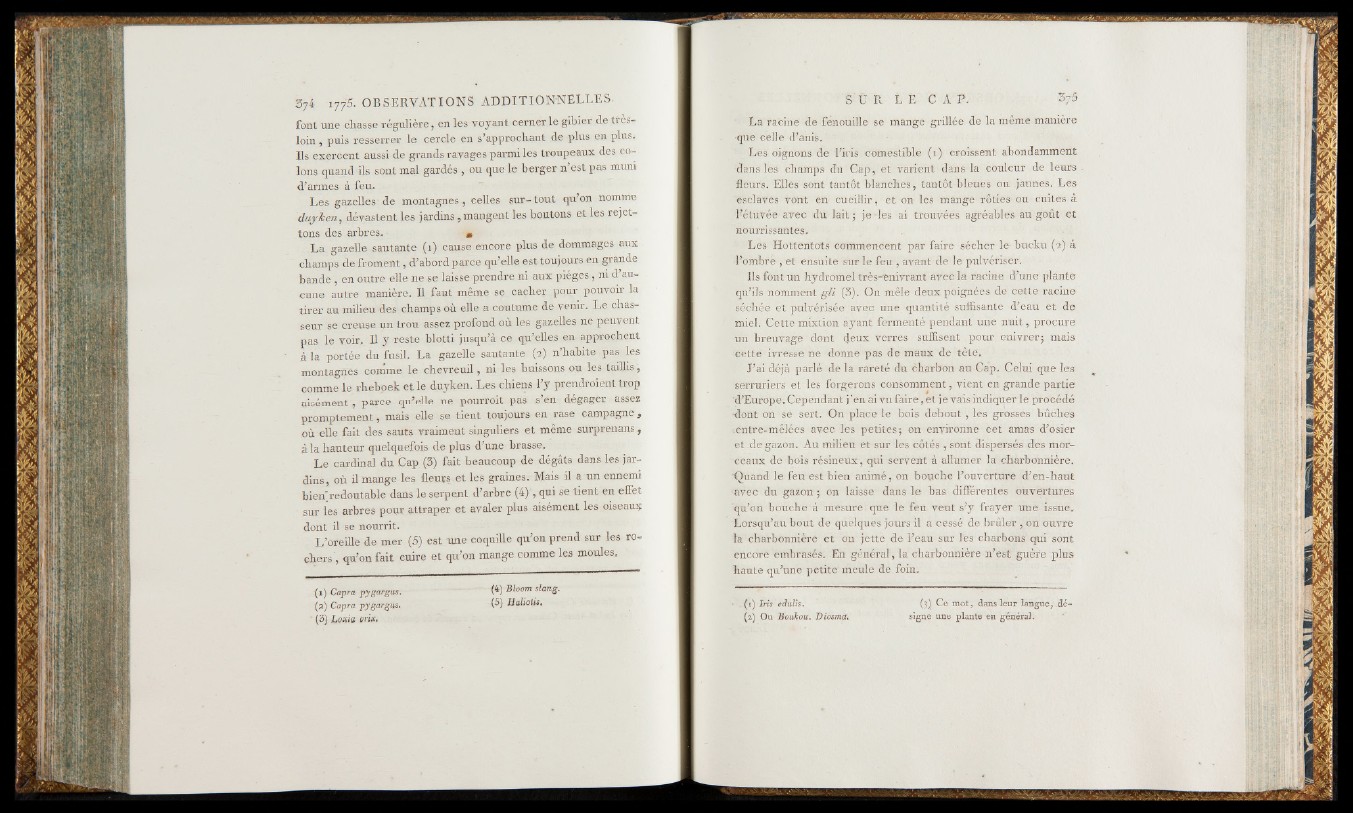
font une chasse régulière, en les voyant cerner le gibier de très-
loin , puis resserrer le cercle en s’approchant de plus en plus.
Ils exercent aussi de grands ravages parmi les troupeaux des colons
quand ils sont mal gardés , ou que le berger n’est pas muni
d’armes à feu.
Les gazelles' de montagnes, celles sur- tout qu’on nomme
duyfcen, dévastent les jardins., mangent les boutons et les rejet-
tons des arbres. ■ m
La gazelle sautante (1) cause encore plus de dommages aux
champs de froment, d’ abord parce qu’ elle est toujours en grande
bandé, en outre elle ne se laisse prendre ni aux pièges, ni d aucune
autre manière. Il faut même se cacher pour pouvoir la
tirer au milieu des-champs où elle a coutume de venir. Le chasseur
se creuse un trou assez profond où les gazelles ne peuvent
pas le voir, U y reste blotti jusqu’à ce qu’elles en approchent
à la portée du fusil, La gazelle sautante (2) n’habite pas les
montagnes comme le chevreuil, ni les buissons ou les taillis,
comme le rheboek et le duyken. Les chiens l’y prendrôient trop
aisément, parce qu’elle ne pourroit pas s en dégager assez
promptement, mais elle s.e tient toujours en rase campagne,
où elle fait des sauts vraiment singuliers et même surprenans*
à la hauteur quelquefois de plus d’une brasse.
Le cardinal du Cap (3) fait beaucoup de dégâts dans les jardins,
où il mange les fleurs et les graines. Mais il a un ennemi
bien".redoutable dans le serpent d’arbre (4)', qui se tient en effet
sur les arbres pour attraper et avaler plus aisément les oiseau^
dont il se nourrit. -
L ’oreille de mer (5) est une coquille qu’on prend sur les rochers
, qu’on fait cuire et qu’on mange comme les moules.
(1) Capra pygargus.
(2) Capra pygargus.
(3) Loxia orix.
(4) Bloom slang.
(5) Haliotis.
La racine de fenouille se mange grillée de la même manière
■ que celle d’anis.
Leà oignons de l’iris comestible (i ) croissent abondamment
dans les champs du Cap, et varient dans la couleur de leurs
fleurs. Elles sont tantôt blanches, tantôt bleues ou jaunes. Les
esclaves vont en cueillir, et on les mange rôties' ou cuites à
l’étuvée avec du lait ; je -les ai trouvées agréables au goût et
nourrissantes.
Les Hottentots commencent par faire sécher le- bucku (2) à
l’ombré , et ensuite sur le fe u , avant de le pulvériser.
Ils font un hydromel très-enivrant avec la racine d’une plante
qu’ils nomment gli (5). On mêle deux poignées de cette racine
séchée et pulvérisée avec une quantité suffisante d’ eau et de
miel. Cette mixtion ayant fermenté pendant une nuit, procure
un breuvage dont deux verres suffisent pour enivrer5 mais
çette ivresse ne donne pas de maux de tête.
J’ai déjà parlé delà rareté du charbon au Cap. Celui que les
serruriers et les forgerons consomment, vient en grande partie
'd’Europe. Cependant j ’en ai vu faire, et je vais indiquer le procédé
■ dont on se sert. On place le bois debout , les grosses bûches
.entre-mêlées avec les petites 5 on environne cet amas d’osier
et .de gazon. Au milieu et sur les côtés , sont dispersés des morceaux
de bois résineux, qui servent à allumer la charbonnière.
Quand le feu est bien animé, on bouche l’ouverture d’en-haut
avec du gazon ; on laisse dans le bas différentes ouvertures
qu’on bouche à mesure que le feu veut s’y frayer une issue.
Lorsqu’au bout de quelques jours il a cessé de brûler , on ouvre
la charbonnière et on jette de l’eau sur les charbons qui sont
encore embrasés. En général, la charbonnière n’est guère plus
haute qu’une petite meule de foin.
(3) Ce mot, dans leur langue, désigne
une plante en général.
(1 ) I r i s e d u l i s .
(2) Ou Boukou. Diosma,