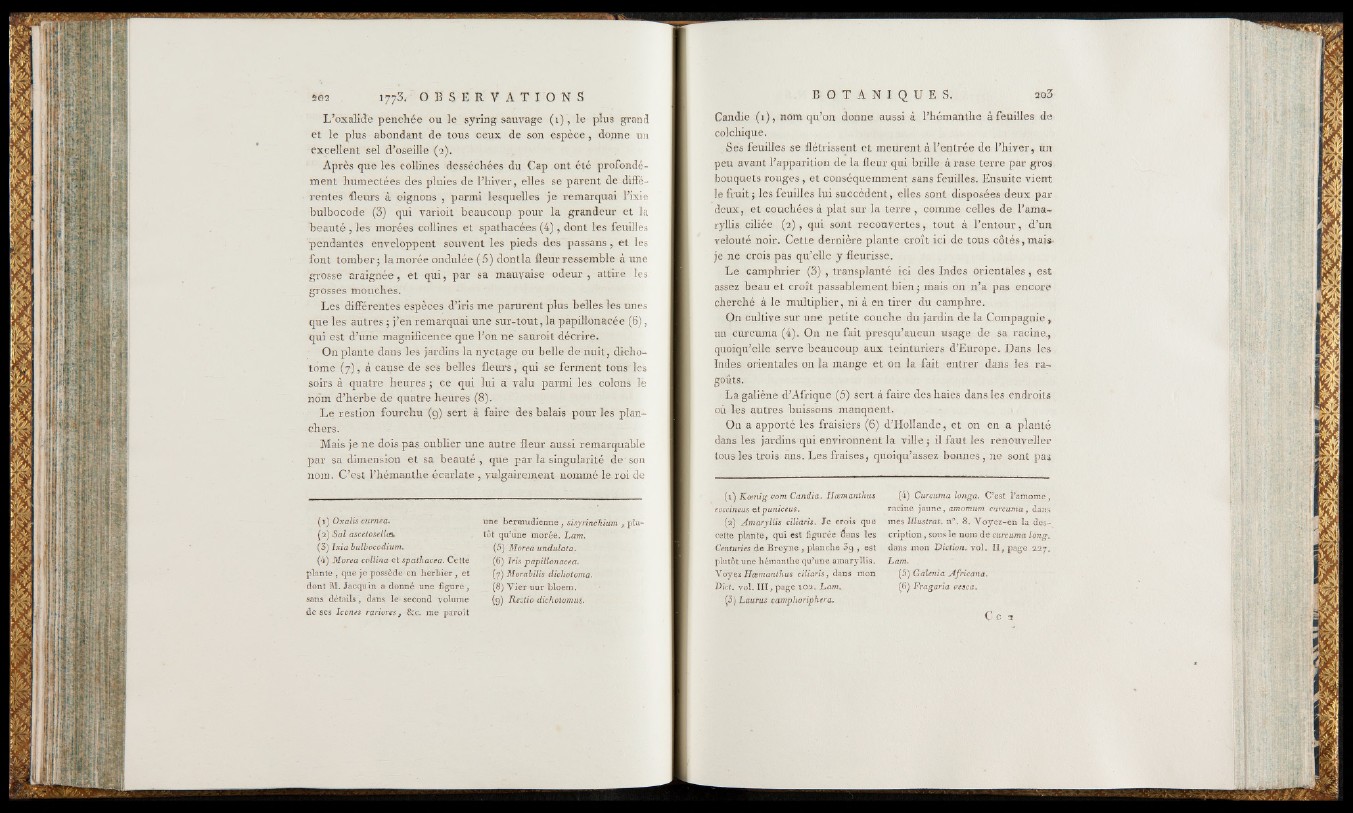
L ’oxalide penchée ou le syring sauvage ( i ) , le plus grand
et le plus abondant de tous ceux de son espèce, donne un
excellent sel d’oseille (2}.
Après que les collines desséchées du Cap ont été profondément
humectées des pluies de l’hiver, elles se parent de différentes
fleurs à oignons , parmi lesquelles je remarquai l’ixie
bulbocode (3) qui varioit beaucoup pour la grandeur et la
beauté , les marées collines et spatbacées (4) , dont les feuilles
pendantes enveloppent souvent les pieds des passans, et les
font tomber; lamorée ondulée(5) dontla fleur ressemble à une
grosse araignée, et qui, par sa mauvaise odeur , attire les
grosses mouches.
Les différentes espèces d’iris me parurent plus belles les unes
que les autres ; j’en remarquai une sur-tout, la papillonacée (6),
qui est d’une magnificence que l’on ne sauroit décrire.
On plante dans les jardins la nyctage ou belle de nuit, dicho-
tome H , à cause de ses belles fleurs, qui se ferment tous "les
soirs à quatre heures ; ce qui lui a valu parmi les colons le
nom d’herbe de quatre heures (8).
Le restion fourchu (g) sert à faire des balais pour les planchers.
Mais je ne dois pas oublier une autre fleur aussi remarquable
par sa dimension et sa beauté ,. que par la singularité de' son
nom. C’est l’hémanthe écarlate , vulgairement nommé le roi de
(1) Oxalis curnedi
£2) S al ascetosellca.
(3) Ixia bulbocodium.
(4) Morea coliina et spathaceâ. Celte
plante , que je possède en h e rb ie r, et
dont M. Jacquin a donné une fig u re,
sans d étails, dans le second volume
de ses le oms rariores f &c. me paroît
une berm udienne, sisyrinchium } plutôt
qu’une m orée. Lam'.
(5) Morea undulata.
(6) Iris papillonacea.
(7) Morabilis dichotoma.
(8) V ier uur bloem .
(9) R e s t i o dichotomus.
Candie (1), nom qu’on donne aussi à l’hémanthe à feuilles de
colchique.
Ses feuilles se flétrissent et meurent à l’entrée de l’hiver, un
peu avant l’apparition de la fleur qui brille à rase terre par gros
bouquets rouges, et conséquemment sans feuilles. Ensuite vient
le fruit; les feuilles lui succèdent, elles sont disposées deux par
deux, et couchées à plat sur la terre , comme celles de l’amaryllis
ciliée (2), qui sont recouvertes, tout à l’entour, d’un
velouté noir. Cette dernière plante croît ici de tous côtés,mais-
je ne crois pas qu’ elle y fleurisse.
Le camphrier (3) , transplanté ici des Indes orientales , est
assez beau et croît passablement bien; mais on n’a pas encore
cherché à le multiplier, ni à en tirer du camphre.
On cultive sur une petite couche du jardin de la Compagnie,
un curcuma (4). On ne fait presqu’aucun usage de sa racine.,
quoiqu’elle serve beaucoup aux teinturiers d’Europe. Dans les
Indes orientales on la mange et on la fait entrer dans les ragoûts.
La galiène d’Afrique (5) sert à faire des haies dans les endroits
où les autres buissons manquent.
On a apporté les fraisiers (6) d’Hollande, et on en a planté
dans les jardins qui environnent la ville; il faut les renouveller
tous les trois ans. Les fraises, quoiqu’assez bonnes , ne sont pas 1
(1) Koenig vont Candia. Hoemanthus (4) Curcuma longa. C’est l ’amomc ,
coccineus etpuniceus. racine jaune, amomum curcuma , dans
(2) Amaryllis ciliaris. Je crois que mes Illustrai. n°. S. V o y ez-en la des-
cette p lan te, qui est figurée dans les crip tio n , sous le nom de curcuma Long.
Centuries de B re y n e , planclie 3q , est dans mon Diction, vol. I I , page 227,
plutôt une Iiémanilie qu’une am aryllis. Lam.
Voyez UoemarUhus ciliaris, dans mon (5) Galenia Africana.
Dkt. vol. I I I , page to n . Lam. (fij Fragaria vesca.
Laurus camphoriphera.
C e ï