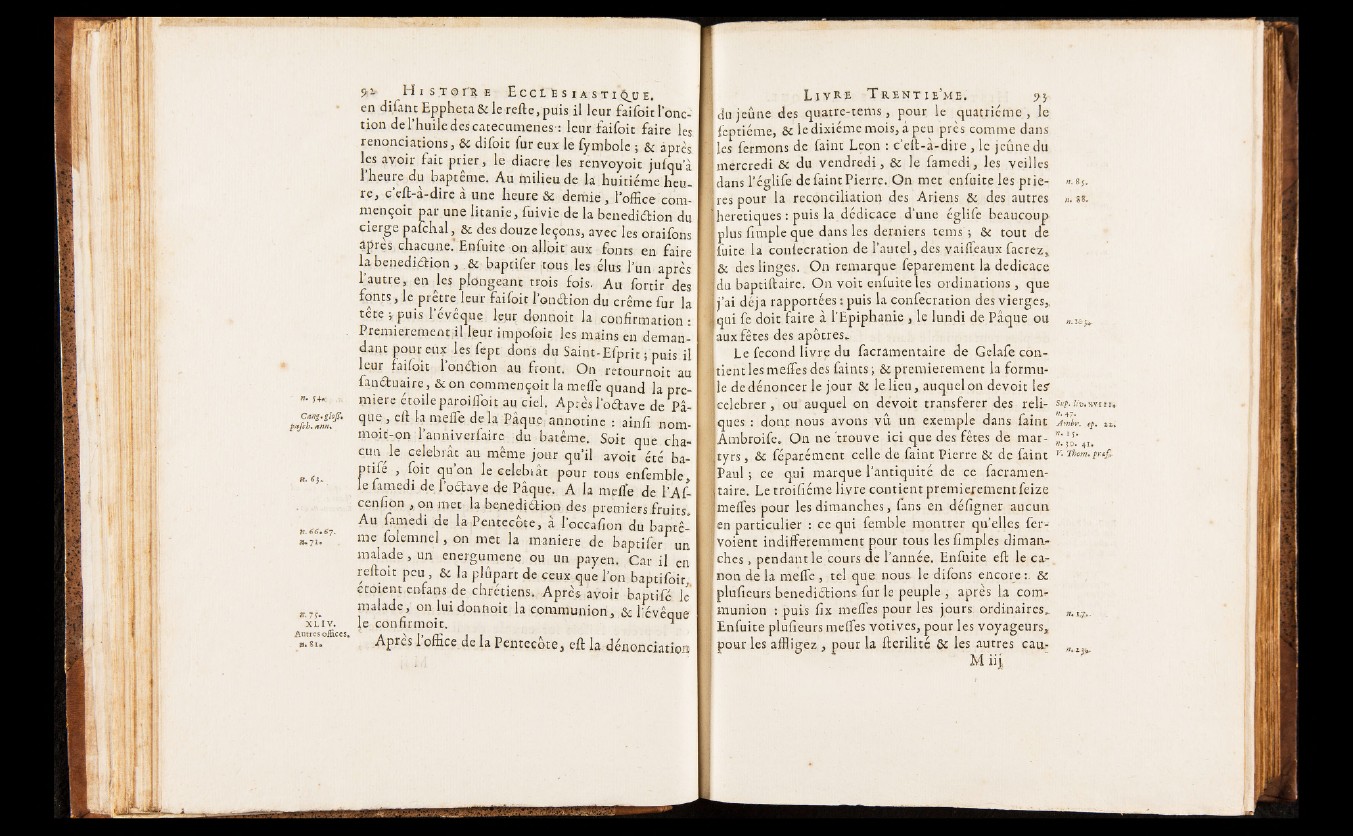
' rt* ï4k: ,s
Cang.glofi.
pafch. ann.
H. 63.
ti. 66* 67.
su 71*
». 7 5.
X L IV .
Autres offices,,
a» 8 !•
9,2*- H l S . T S I ^ ! EcCÎ . fe S IA S T IQ j j e .
en difaht Eppheta 8c le refte, puis il leur faifoit l’onction
de l’huile des catecumenes : leur faifoit faire les
renonciations, 8c difoit fur eux le fymbole ; 8c après,
les avoir fait p rie r, le diacre les renvoyoit jufqu’â
l ’heur.e,du baptême. Au milieu de la .huitième heure
, c’eft-à-dire à une heure 8c demie , l’office com-
mençoit par une litanie, fuivie de la benedidion du
cierge pafchal, 8c des douze leçons, avec les oraifons
âpres, chacune.' Enfuite on al.lpit; aux fonts en faire
la benedidion , 8c baptifer tous les élus l’un après
E autre, en des plongeant trois fois. Au fortir des
fon ts, le prêtre leur faifoit l’ondion du crème fur la
tête ; puis l’évêque, leur dpnnoit la confirmation :
Premièrement,àl leur impoioit les mains eu demandant
pour eux les fept dons du Saint-Efprit ; puis il
leur faifoit l’on dion au front. On retournoit au
fan d u a ire , Scon eommençoic la mefle quand la première
étoileparoifloit au ciel. Après i ’o d a v e de Pâque
, eft hunefle de b r P â q u ^ : ainfi nom-
moi t-on l’anniverlaire du hateme. Soit que. chacun
le célébrât au même jour qu'il avoit été ba-
ptifé , foie qu’on le celebiât pour tous enfemble,
le famedi d e l ’o d a v e de Pâque. A la meife de l ’Af-
ceiifion , on mec la benedidion: des premiers fruits
Au famedi de la,Pentecôte, à l ’oçcafion du baptême
iolemnel, on met la maniéré de baptifer un
m alad e , un energumene. ou un payen. Car il en
reftoit peu , 8c la plupart de ceux que l’on baptifoit
croient enfans de chrétiens. Après avoir baptifé le*
malade, 011 lui donnoit la communion, 8c l'évêque
|e confirmoit. *
Après l’office de la Pentecôte, eft la. dénonciation
». 85.
L i v r e T r e n t i e ’me . p y
du jeûne des quatre-tems, pour le quatrième, le
I feptiéme, 8c le dixième mois, à peu près comme dans
l i e s fermons de faint Léon : c’eft-à-dire , le jeûne du
1 mercredi 8c du v en dredi, 8c le famedi, les veilles
Id a n s l ’églife de faint Pierre. On met enfuite les prie-
Ire sp o u r la réconciliation des Ariens & des autres «. ss.
■hereciques : puis la dédicace d’une églife beaucoup
I plus .fimple que dans les derniers teins'; 8c tout de
■ fuite la confecration de l’autel, des vaifleaux facrez,
& des linges. On remarque feparement la dédicacé
■du baptiftaire. On voit enfuite les ordinations, que
■ j ’ai déjà rapportées : puis la confecration des vierges,,
■qui fe doit faire à l’Epiphanie ,..le lundi de Pâque ou
■ aux fêtes des apôtres.
Le fécond livre du facramentaire de Gelafe con-
It ien t les mefles des faints; 8c premièrement la formu-
le de dénoncer le jour 8c le lieu,. auquel on devoit les"
■ c e leb re r, ou auquel on devoir transférer des reli- Svp. liv. x v i i r*
Iq u e s : dont nous avons vû un exemple dans faint Âmir. ,p.
■Ambroife. On ne trouve ici que des fêtes de mar-
■ t y r s , 8c féparément celle de faint Pierre 8c de faint v- thnn' ï ri&
■Paul ; ce qui marque l’antiquité de ce facramen-
■ taire. Le troifiéme liyre contient premièrement feize
■mefles pour les dimanches, fans en défigner aucun
■ en particulier : ce qui femble montrer quelles fer-
■ voienc indifféremment pour tous lesfimples dimaa-
I c h e s , pendant le cours de l’année. Enfuite eft le ca-,
■ non de la mefle , tel que, nous, ledifons encore 8c I plufieurs benedidtions fur le peuple-, après la corn- I munion : puis fix mefles pour les jours, ordinaires. ,.7..
I Enfuite plufieurs mefles votives, pour les voyageurs,
! pour les a fflig e z , pour la fterilité 8c les autres caa-
M iij,