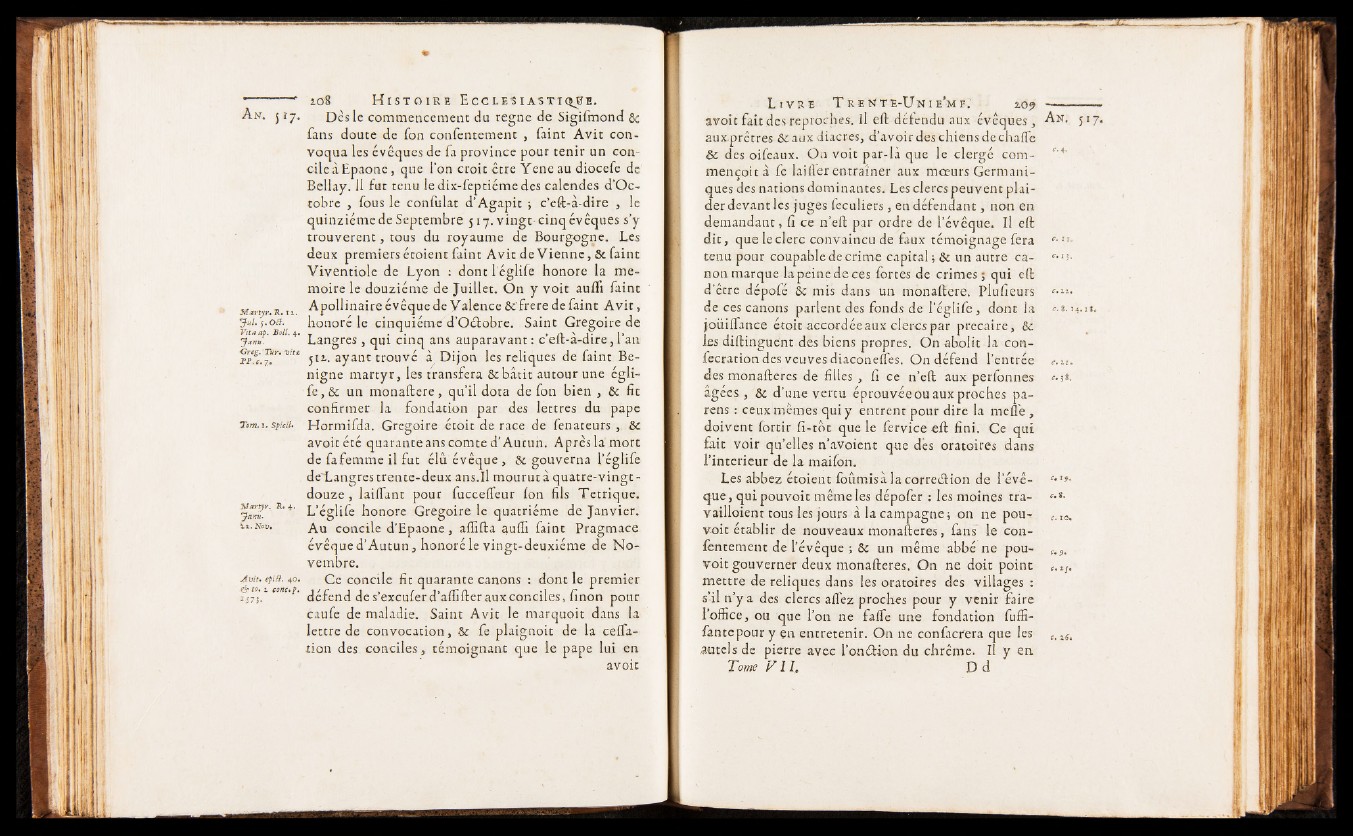
An. j i 7.
Martyr.» R. iz .
Jul. 5. Oft.
Vita ap. Boll. 4.
Jan u .
Greg.Tur. v it a ÏP^c.2»
Tom. 1 , SpieiU
Martyr. R. 4.
Janu.
i i . Nov»
¿ v i t . epifi. 40.
.& to. 2 eonc. p.
* 67}.
108 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
Dès le commencement du regne de Sigifmond 8c
fans doute de fon confentement , faint Avit convoqua
les évêques de fa province pour tenir un concile
à Epaone, que l’on croit être Yene au diocefe de
Bellay. 11 fut tenu ledix-feptiémedes calendes d’Oc-
tobre , fous le confulat d’Agapit ; c’eft-à-dire , le
quinzième de Septembre j 17. vingt cinq évêques s’y
tro u v è r en t , tous du royaume de Bourgogne. Les
deux premiers étoient faint Avit de Vienne , 8c faint
Viventiole de Lyon : donc 1 églife honore la mémoire
le douzième de Juillet. On y voit auffi faint
Apollinaire évêque de Valence 8e'frere de faint A v i t ,
honoré le cinquième d’Oêlobre. Saint Grégoire de
Langres , qui cinq ans auparavant: c’eft-à-dire,l’an
j n . ayant trouvé à Dijon les reliques de faint Bénigne
ma r tyr , les transfera 8c bâtit autour une égli-
fe,8c un monaftere, qu’il dota de fon bien , 8c fie
confirmer la fondation par des lettres du pape
Hormifda. Grégoire étoit de race de fenateurs ,, 8c
avoit été quarante ans comte d’Aucun. Après la mort
de fafemme il fut élu évêque , 8c gouverna I’églife
de'Langres trente-deux ans.il mourut à quatre-vingt-
douze , laiflant pour fuccefleur ion fils Tetrique.
L’églife honore Grégoire le quatrième de Janvier.
Au concile d’Epaone, affifta auffi faint Pragmace
évêque d’Au tu n , honoré le vingt-deuxième de N o vembre.
Ce concile fit quarante canons : dont le premier
défend de s’exeuferd’affifter aux conciles , finon pour
caufe de maladie. Saint Avit le marquoic dans la
lettre de convocation, 8c fe plaignoit de la cefla-
iion des conciles , témoignant que le pape lui en
avoit
L i v r e T r e n t ï -U n i e ’m e .' 2.09 — ■ . .
avoit fait des reproches. Il eft défendu aux évêques, An. 517.
aux.prêcres 8c aux diacres, d’avoir des chiens dechafte
8c des oifeaux. On voit par-là que le clergé com- <r'4'
mençoità fe laifler entraîner aux moeurs Germaniques
des nations dominantes. Les clercs peuvent plaider
devant les juges feculiers, en défendant, non en
demandant, fi ce n ’eft par ordre de l’évêque, Il eft
die, que le clerc convaincu de faux témoignage fera 1
tenu pour coupablede crime capital ; 8c un autre ca- c,Iinon
marque la peine de ces fortes de crimes j qui eft
d’êcre dépofé 8c mis dans un monaftere. Plufieurs
de ces canons parlent des fonds de I’églife, dont la
joixiflance étoit accordée aux clercs par precaire, 8c
les diftinguent des biens propres. On abolit la con-
fecration des veuves diaconeffes. On défend l’entrée r.n.
des monafteres de filles , fi ce n’eft aux perionnes
agees , 8c d’une vertu éprouvéeou aux proches pa-
rens : ceux mêmes qui y entrent pour dire la mefl'e ,
doivent fortir fi-tôt que le fervice eft fini. Ce qui
fait voir qu’elles n’avoient que des oratoires dans
l’intérieur de la maifon.
Les abbez étoient fournis à la correction de l’évê- c' 19-
que, qui pouvoir même les dépofer : les moines tra-
vailloient tous les jours à la campagne; on ne pou- <•. I0.
voit établir de nouveaux monafteres, fans le contentement
de l’évêque ; 8c un même abbé ne pou- c. 9.
voit gouverner deux monafteres. On ne doit point e. ij.
mettre de reliques dans les oratoires des villages :
s’il n’y a des clercs aflez proches pour y venir faire
l’office, ou que l’on ne faiTe une fondation fuffi-
fantepour y en entretenir. On ne confacrera que les c, lS,
autels de pierre avec l’onéfion du chrême. Il y en.
Tome T 11, D d