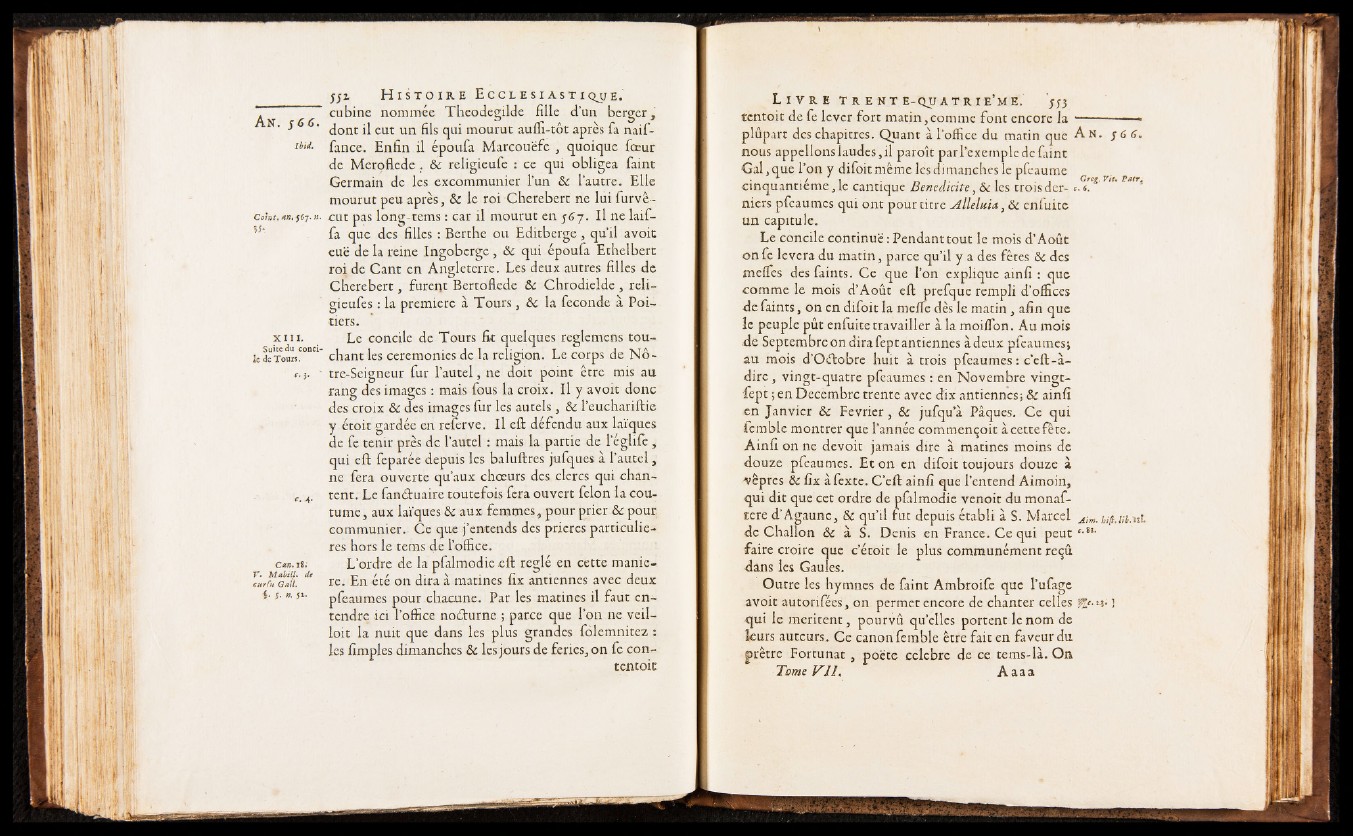
A n . ; 66.
lb id.
Coint. an, 567. ».
ÎÛ
X I I I .
Suite du concile
de Tours.
c. 3.
r. 4*
C#». 1$:
I*. M abili, de
curPu Gall.
f . .5. »> j t .
5 j i H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
cubine nommée Theodegilde fille d’un berger,
dont il eut un fils qui mourut auffi-tôt après fa naif-
fance. Enfin il époufa Marcouëfe , quoique foeur
de Meroflede , & religieufe : ce qui obligea faint
Germain de les excommunier l’un &c l’autre. Elle
mourut peu après, & le roi Cherebert ne lui furvê-
cut pas long-tems : car il mourut en j é 7. Il ne laif-
fa que des filles : Berthe ou Editberge, qu’il avoit
eue de la reine Ingobcrge, & qui époufa Ethelbert
roi de Cant en Angleterre. Les deux autres filles de
Cherebert, furent Bertoflede &c Chrodielde , reli-
gieufes : la première à T o u r s , & la féconde à Poitiers.
Le concile de Tours fit quelques reglemens touchant
les cérémonies de la religion. Le corps de N ô -
tre-Seigneur fur l’aute l, ne doit point être mis au
rang des images : mais fous la croix. Il y avoit donc
des croix & des images fur les autels , & l’euchariftie
y étoit gardée en reierve. Il eft défendu aux laïques
de fe tenir près de l’autel : mais la partie de l’églife ,
qui eft feparée depuis les baluftres jufques à l’aute l,
ne fera ouverte qu’aux choeurs des clercs qui chantent.
Le fan&uaire toutefois fera ouvert félon la coutume
, aux laïques & aux femmes, pour prier & pour,
communier. Ce que j’entends des prières particulières
hors le tems de l’office.
L ’ordre de la pfalmodieeft réglé en cette maniéré.
En été on dira à matines fix antiennes avec deux
pfeaumes pour chacune. Par les matines il faut entendre
ici l’office noéturne ; parce que l’on ne veil-
loit la nuit que dans les plus grandes fôlemnitez :
les fimples dimanches & les jours de feries, on fe contencoit
L i v r e t r e n t e -q u a t r i e ’ m e . 373
tentoit de fe lever fort matin,comme font encore la *-----------—«
plupart des chapitres. Quant à l’office du matin que A n . 6.
nous appelions laudes, il paroît par l’exemple de faint
G a i, que l’on y difoit même les dimanches le pfeaume
t 1 „ . . . „ 1 1 Greg.Vit.PlUT. cinquantième,ie cantique Benedicite, & les troisder- c.t.
niers pfeaumes qui ont pour titre Alléluia, & enfuite
un capitule.
Le concile continue : Pendant tout le mois d’Août
on fe lèvera du matin, parce qu’il y a des fêtes & des
meffies des faints. Ce que l’on explique ainfi : que
comme le mois d’Août eft prefque rempli d’offices
de faints, on en difoit la meife dès le matin, afin que
le peuple pût enfuite travailler à la moifl'on. Au mois
de Septembre on dira fept antiennes à deux pfeaumes;
au mois d’Oétobre huit à trois pfeaumes : c’e ft-à -
d ire , vingt-quatre pfeaumes : en Novembre vingt-
fiept ; en Décembre trente avec dix antiennes; & ainfi
en Janvier & Février, & ju fq u a Pâques. Ce qui
femble montrer que l’année commençoit à cette fête.
Ain fi on ne devoit jamais dire à matines moins de
douze pfeaumes. E t on en difoit toujours douze à
vêpres & fix àfexte. C ’eft ainfi que l ’entend Aimoin,
qui dit que cet ordre de pfalmodie venoit du monaf-
tere d’Agaune, & qu’il fut depuis établi à S. Marcel
de Challon & à S. D enis en France. Ce qui peut t-81,
faire croire que c’'étoit le plus communément reçu
dans les Gaules.
Outre les hymnes de faint Ambroife que l’ufage
avoit autorifées, on permet encore de chanter celles ]
qui le méritent, pourvû qu’elles portent le nom de
leurs auteurs. Ce canon femble être fait en faveur du
prêtre Fortuna t, poete célébré de ce tems-là. On
Tome V i l . A a a a