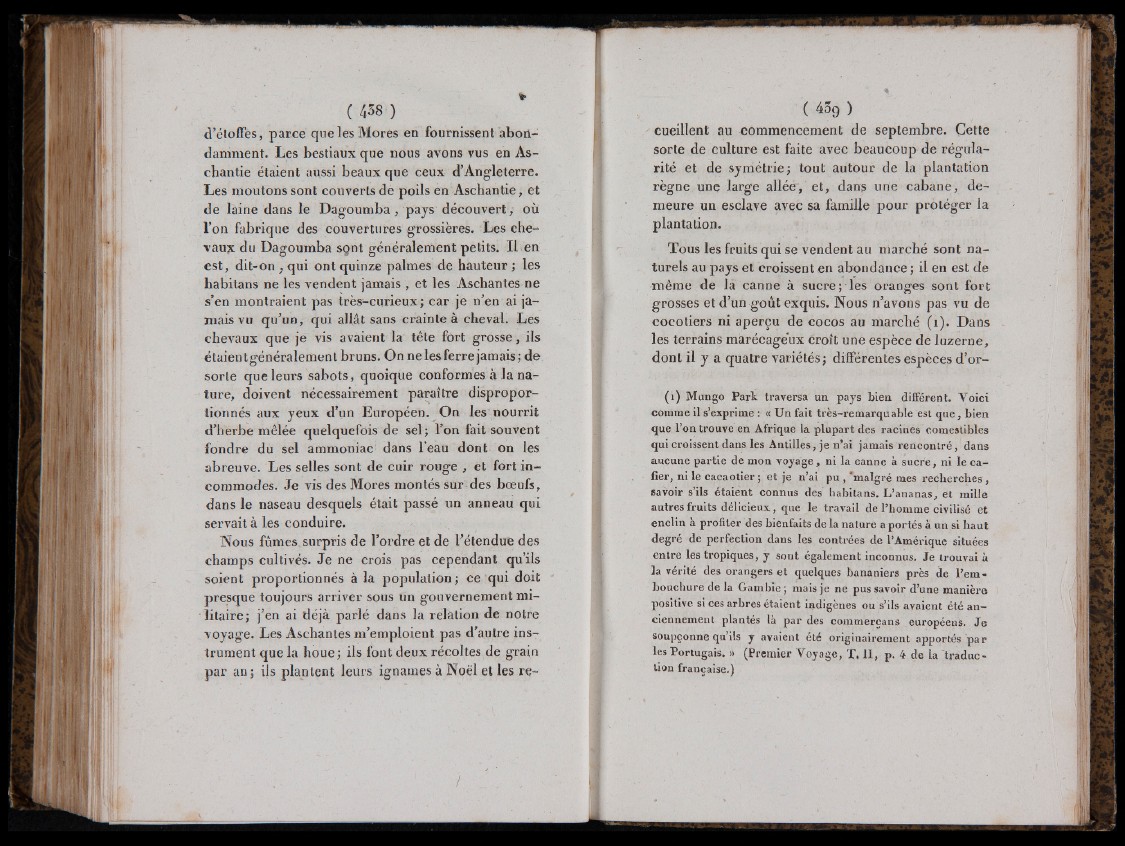
d’étoffes, parce que les Mores en fournissent abondamment.
Les bestiaux que nous avons vus en As-
chantie étaient aussi beaux que ceux d’Angleterre.
Les moutons sont couverts de poils en Aschantie, et
de laine dans le Dâgoumba, pays découvert, où
l ’on fabrique des couvertures grossières. Les chevaux
du Dagoumba sçnt généralement petits. I l en
e st, dit-on , qui ont quinze palmes de hauteur ; les
habitans ne les vendent jamais , et les Aschantes ne
s’en montraient pas très-curieux; car je n’en ai jamais
vu qu’un, qui allât sans crainte à cheval. Les
chevaux que je vis avaient la tête fort grosse , ils
étaientgénéralement bruns. On ne les ferre jamais; de
sorte que leurs sabots, quoique conformes à la nature,
doivent nécessairement paraître disproportionnés
aux yeux d’un Européen. On les nourrit
d’berbe mêlée quelquefois de sel; l’on fait souvent
fondre du sel ammoniac dans l ’eaü dont on les
abreuve. Les selles sont de cuir rouge , et fort incommodes.
Je vis des Mores montés sur des boeufs,
dans le naseau desquels était passé un anneau qui
servait à les conduire.
Nous fûmes, surpris de l’ordre et de l’étendue des
champs cultivés. Je ne crois pas cependant qu’ils
soient proportionnés à la population ; ce qui doit
presque toujours arriver sous un gouvernement militaire;
j’en ai déjà parlé dans la relation de notre
voyage. Les Aschantes m’emploient pas d’autre instrument
que la houe; ils font deux récoltes de grain
par an ; ils plantent leurs ignames à Nqël et les re~
( 439 )
cueillent au commencement de septembre. Cette
sorte de culture est faite avec beaucoup de régularité
et de symétrie; tout autour de la plantation
règne une large allée, et, dans une cabane, demeure
un esclave avec sa famille pour protéger la
plantation.
Tous les fruits qui se vendent au marché sont naturels
au pays et croissent en abondance ; il en est de
même de la canne à sucre; les oranges sont fort
grosses et d’un-goût exquis. Nous n’avons pas vu de
cocotiers ni aperçu de cocos au marché (1). Dans
les terrains marécageux croît une espèce de luzerne,
dont il y a quatre variétés ; différentes espèces d’or-
(1) Mango Park traversa un pays bien différent. Voici
comme il s’exprime : « Un fait très-remarquable est que, bien
que l’on trouve en Afrique la plupart des racines comestibles
qui croissent dans les Antilles, je n’ai jamais rencontré, dans
aucune partie de mon voyage, ni la canne à sucre, ni le ca-
fier, ni le cacaotier ; et je n’ai pu , *malgré mes recherches,
savoir s’ils étaient connus des habitans. L ’ananas, et mille
autres fruits délicieux, que le travail de l’homme civilisé et
enclin à profiler des bienfaits de la nature a portés à un si haut
degré de perfection dans les contrées de l’Amérique situées
entre les tropiques, y sont également inconnus. Je trouvai à
la vérité des orangers et quelques bananiers près de l ’em-
bouchure de la Gambie ; mais je ne pus savoir d’une manière
positive si ces arbres étaient indigènes ou s’ ils avaient été anciennement
plantés là par des coqimerçans européens. Je
soupçonne qu ils y avaient été originairement apportés par
les Portugais. » (Premier Voyage, X. II, p. 4 de la traduction
française.)