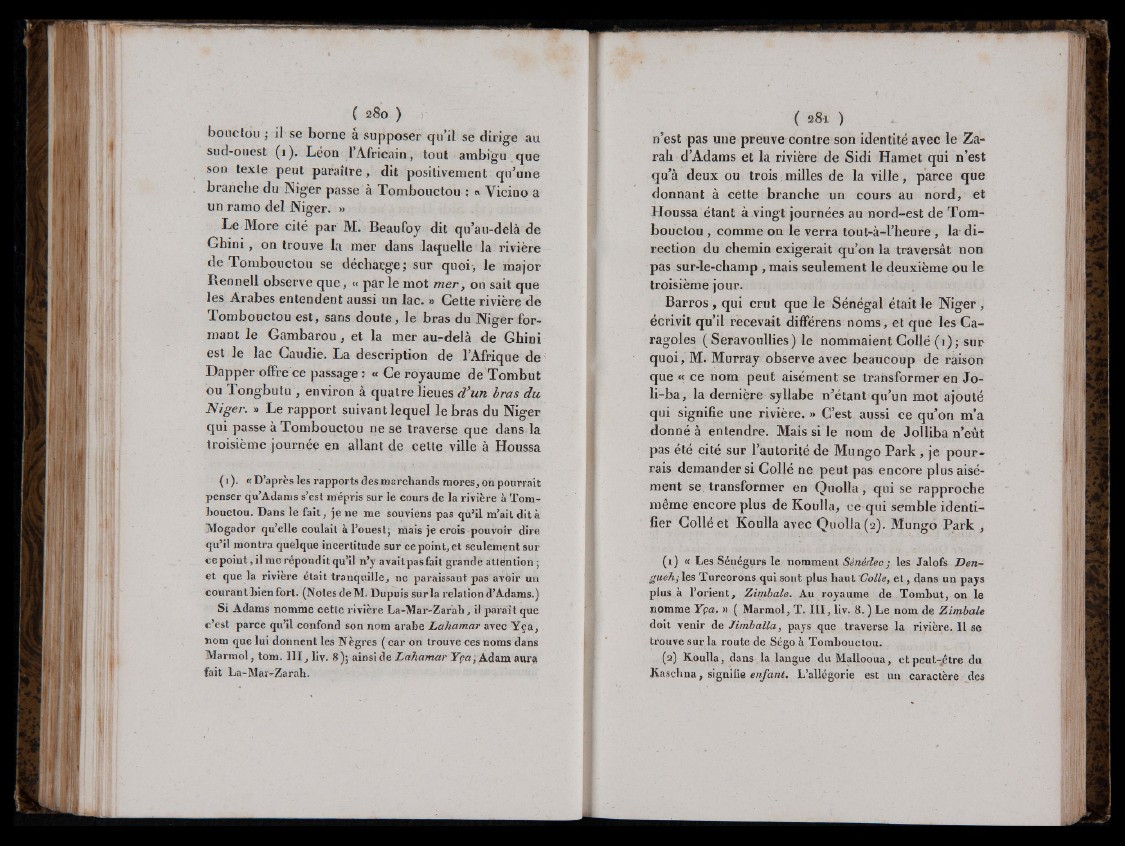
bonctou ; il se borne à supposer qu’il se dirige au
sud-ouest (1). Léon 1 Africain , tout ambigu que
son texte peut paraître, dit positivement qu’une
branche du Niger passe à Tombouctou ; « Yicino a
un ramo del Niger. »
L e More cité par M. Beaufoy dit qu’au-delà de
G b in i, on trouve la mer dans laquelle la rivière
de Tombouctou se décharge; sur quoi, le major
Rennell observe q u e , « par le mot mer, on sait que
les Arabes entendent aussi un lac. » Cette rivière de
Tombouctou est, sans doute, le bras du Niger formant
le Gambarou, et la mer aurdelà de Ghini
est le lac Caudie. La description de l ’Afrique de
Dapper offre ce passage ; « C e royaume de Tombut
ou Tongbutu ', environ à quatre lieues d’un bras du
Niger. » Le rapport suivant lequel le bras du Niger
qui passe à Tombouctou ne se traverse que dans la
troisième journée e.n allant de cette ville à Houssa
( i ). « D’après les rapports des marchands mores, on pourrait
penser qu’Adams s’est mépris sur le cours de la rivière à Tombouctou.
Dans le fait, je ne me souviens pas qu’il m’ait dit à
Mogador qu’elle coulait à l’ouest; mais je crois pouvoir dire
qu’ il montra quelque incertitude sur ce point, et seulement sur
ce point, il me répondit qu’il n-’y avait pas fait grande attention;
et que la rivière était tranquille, ne paraissant pas avèir un
courant bien fort. (Notes de M. Dupuis sur la relation d’Adams.)
Si Adams nomme cette rivière La-Mar-Zarah, il paraît que
ç ’est parce qu’il confond son nom arabe Lahamar avec Y ç a ,
nom que lui donnent les Nègres ( car ôn trouve ces noms dans
Marmol, tom. 111, liv, 8); ainsi de Lahamar Yça, Adam aura
fait La-Mer-Zarab.
n’est pas une preuve contre son identité avec le Za-
r ah d’Adam s et la rivière de Sidi Hamet qui n’est
qu’à deux ou trois milles de la ville , parce que
donnant à cette branche un cours au nord, et
Houssa étant à vingt journées au nord-est de Tombouctou
, comme on le verra tout-à-l’heure, la- direction
du chemin exigerait qu’on la traversât non
pas sur-le-champ , mais seulement le deuxième ou le
troisième jour.
Barros, qui crut que le Sénégal était le N ig e r ,
écrivit qu’il recevait différens noms, et que les Ca-
ragoles ( Seravoullies ) le nommaient Collé (1 ) ; sur
quoi , M-Murray observe avec beaucoup de raison
que « ce nom peut aisément se transformer en Jo-
li-ba, la dernière syllabe n’ étant qu’un mot ajouté
qui signifie une rivière. » C’est aussi ce qu’on m’a
donné à entendre. Mais si le nom de Jolliba n’eût
pas été cité sur l’autorité de Mungo Parle, je pourrais
demander $i Collé ne peut pas encore plus aisément
se. transformer en Quolla , qui se rapproche
même encore plus de Koulla, ce qui semble identifier
Collé et Koulla avec Quolla(2). Mungo Park ,
(1) « Les Sénégurs le nomment Sênédec ; les Jalofs Den-
gueh; les Turcorons qui sont plus haut Colle, e t , «fans un pays
plus à l’orient, Zimbale. Au royaume de Tombut, on le
nomme Yça. » ( Marmol, T. I I I , liv. 8. ) Le nom de Zimbale
doit venir de Jimballa, pays que traverse la rivière. Il se
trouve sur la route de Ségo à Tombouctou.
(2) Koulla, dans .la langue du Mallooua, et peut-être du
Raschna, signifie enfant. L ’allégorie est un caractère des