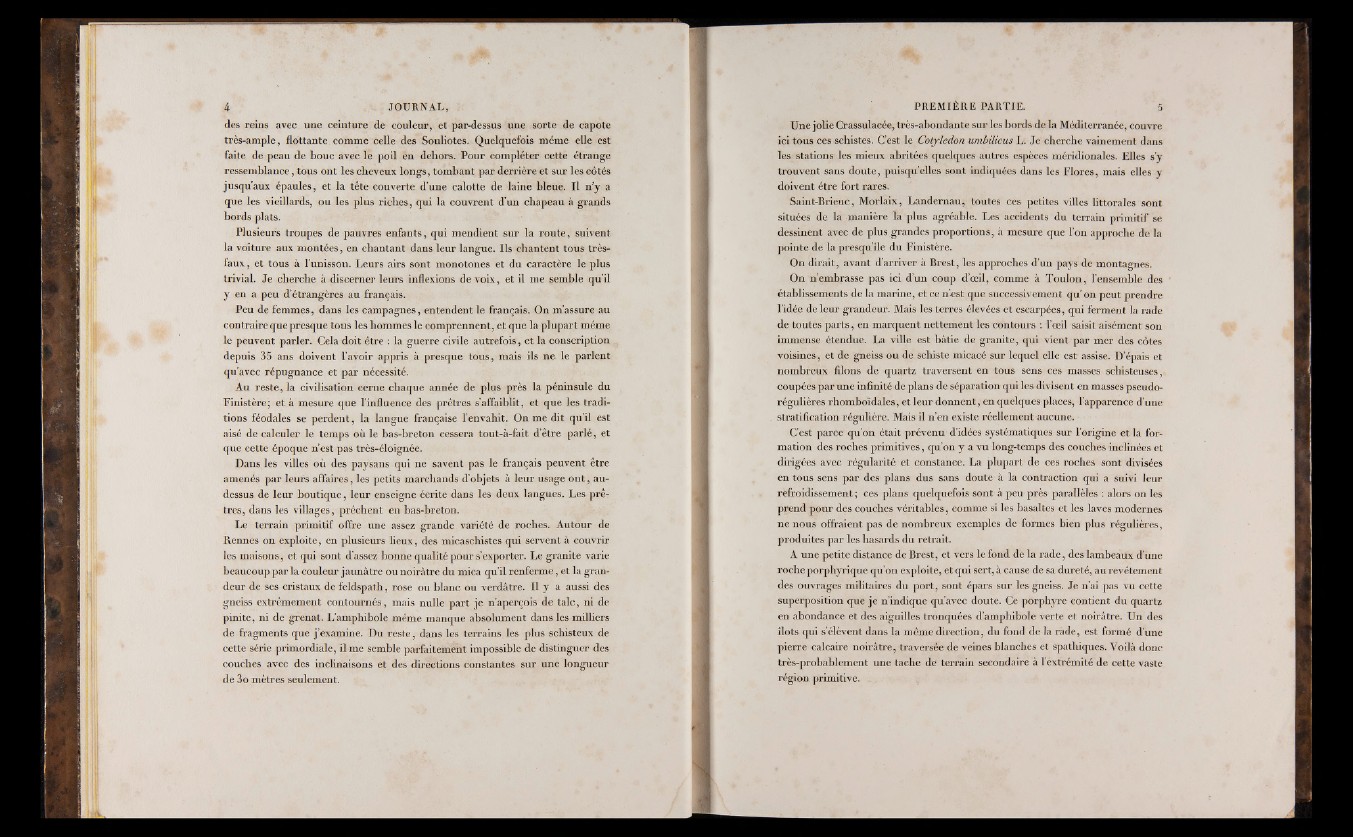
des reins avec une ceinture de couleur, et par-dessus une sorte de capote
très-ample, flottante comme celle des Souliotes, Quelquefois même elle est
faite de peau de bouc avec le poil en dehors. Pour compléter cette étrange
ressemblance, tous ont les cheveux longs, tombant par derrière et sur les côtés
jusqu’aux épaules, et la tête couverte d’une calotte de laine bleue. Il n'y a
que les vieillards, ou les plus riches, qui la couvrent d’un chapeau à grands
bords plats.
Plusieurs troupes de pauvres enfants, qui mendient sur la route, suivent
la voiture aux montées, en chantant dans leur langue. Ils chantent tous très-
faux , et tous à l’unisson. Leurs airs sont monotones et du caractère le plus
trivial. Je cherche à discerner leurs inflexions de voix, et il me semble qu’il
y en a peu d’étrangères au français.
Peu de femmes, dans les campagnes, entendent le français. On m’assure au
contraire que presque tous les hommes le comprennent, et que la plupart même
le peuvent parler. Cela doit être : la guerre civile autrefois, et la conscription
depuis 35 ans doivent l’avoir appris à presque tous, mais ils ne le parlent
qu’avec répugnance et par nécessité.
Au reste, la civilisation cerne chaque année de plus près la péninsule du
Finistère; et à mesure que l’influence des prêtres s’affaiblit, et que les traditions
féodales se perdent, la langue française l’envahit. On me dit qu’il est
aisé de calculer le temps où le bas-breton cessera tout-à-fait d’être parlé, et
que cette époque n’est pas très-éloignée.
Dans les villes où des paysans qui ne savent pas le français peuvent être
amenés par leurs affaires, les petits marchands d’objets à leur usage ont, au-
dessus de leur boutique, leur enseigne écrite dans les deux langues. Les prêtres,
dans les villages, prêchent en bas-breton.
Le terrain primitif offre une assez grande variété de roches. Autour de
Rennes on exploite, en plusieurs lieux, des micaschistes qui servent à couvrir
les maisons, et qui sont d’assez bonne qualité pour s’exporter. Le granité varie
beaucoup par la couleur jaunâtre ou noirâtre du mica qu’il renferme, et la grandeur
de ses cristaux de feldspath, rose ou blanc ou verdâtre. Il y a aussi des
gneiss extrêmement contournés, mais nulle part je n’aperçois de talc, ni de
pinite, ni de grenat. L’amphibole même manque absolument dans les milliers
de fragments que j’examine. Du reste, dans les terrains les plus schisteux de
cette série primordiale, il me semble parfaitement impossible de distinguer des
couches avec des inclinaisons et des directions constantes sur une longueur
de 3o mètres seulement.
Une jolie Crassulacée, très-abondante sur les bords de la Méditerranée, couvre
ici tous ces schistes. C’est le Cotylédon umbilicus L. Je cherche vainement dans
les stations les mieux abritées quelques autres espèces méridionales. Elles s’y
trouvent sans doute, puisqu’elles sont indiquées dans les Flores, mais elles y
doivent être fort rares.
Saint-Brieuc, Morlaix, Landernau, toutes ces petites villes littorales sont
situées de la manière la plus agréable. Les accidents du terrain primitif se
dessinent avec de plus grandes proportions, à mesure que l’on approche de la
pointe de la presqu’île du Finistère.
On dirait, avant d’arriver à Brest, les approches d’un pays de montagnes.
On n’embrasse pas ici d’un coup d’oeil, comme à Toulon, l’ensemble des
établissements de la marine, et ce n’-est que successivement qu’on peut prendre
l’idée de leur grandeur. Mais les terres élevées et escarpées, qui ferment la rade
de toutes parts, en marquent nettement les contours : l’oeil saisit aisément son
immense étendue. La ville est bâtie de granité, qui vient par mer des côtes
voisines, et de gneiss ou de schiste micacé sur lequel elle est assise. D’épais et
nombreux filons de quartz traversent en tous sens ces masses schisteuses,
coupées par une infinité de plans de séparation qui les divisent en masses pseudorégulières
rhomboïdales, et leur donnent, en quelques places, l’apparence d’une
stratification régulière. Mais il n’en existe réellement aucune.
C’est parce qu’on était prévenu d’idées systématiques sur l’origine et la formation
des roches primitives, qu’on y a vu long-temps des couches inclinées et
dirigées avec régularité et constance. La plupart de ces roches sont divisées
en tous sens par des plans dus sans doute à la contraction qui a suivi leur
refroidissement ; ces plans quelquefois sont à peu près parallèles : alors on les
prend pour des couches véritables, comme si les basaltes et les laves modernes
ne nous offraient pas de nombreux exemples de formes bien plus régulières,
produites par les hasards du retrait.
A une petite distance de Brest, et vèrs le fond de la rade, des lambeaux d’une
roche porphyrique qu’on exploite, et qui sert, à cause de sa dureté, au revêtement
des ouvrages militaires du port, sont épars sur les gneiss. Je n’ai pas vu cette
superposition que je n’indique qu’avec doute. Ce porphyre contient du quartz
en abondance et des aiguilles tronquées d’amphibole verte et noirâtre. Un des
ilôts qui s’élèvent dans la même direction, du fond de la rade, est formé d’une
pierre calcaire noirâtre, traversée de veines blanches et spathiques. Voilà donc
très-probablement une tache de terrain secondaire à l’éxtrémité de cette vaste
région primitive.