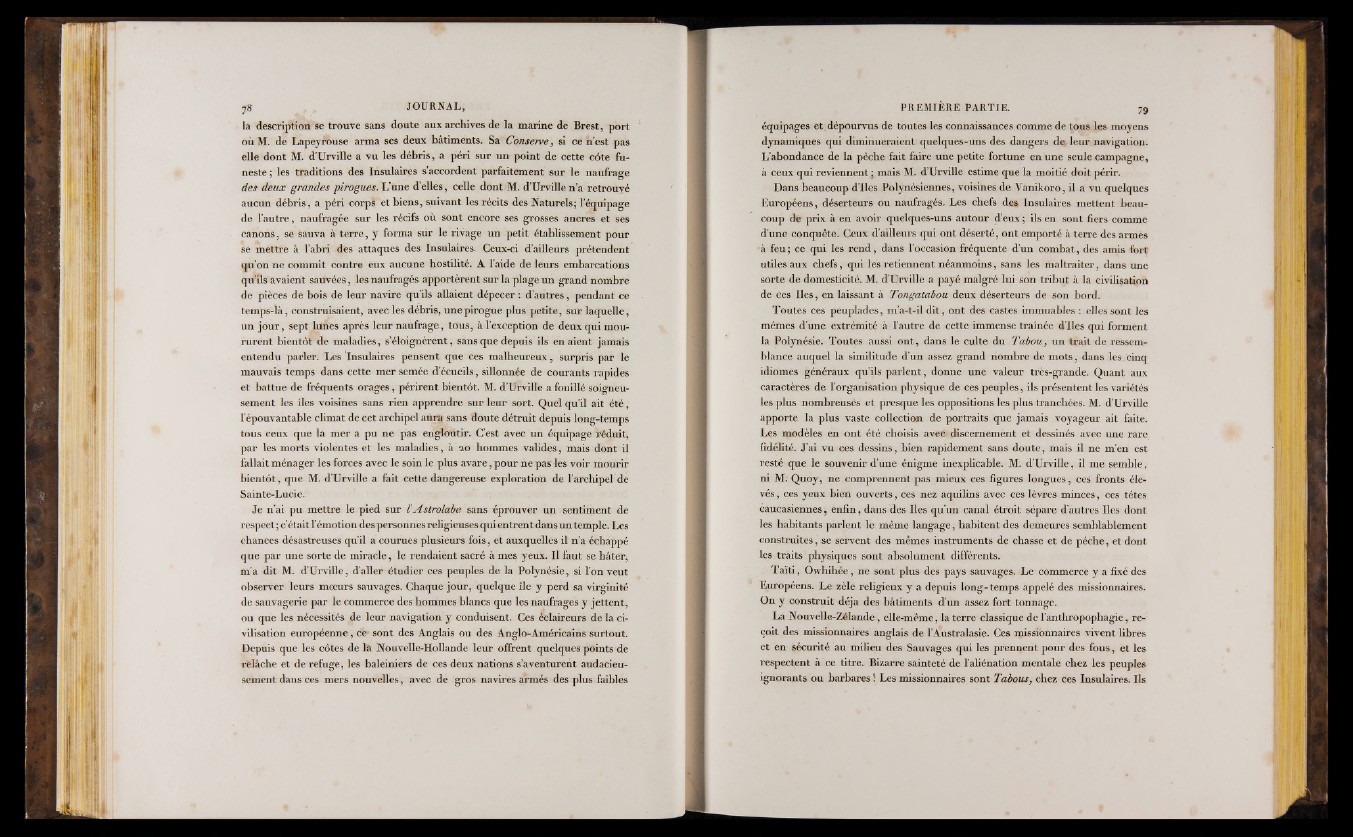
la description se trouve sans doute aux archives de la marine de Brest, port
où M. de Lapeyrouse arma ses deux bâtiments. Sa Conserve, si ce n’est pas
elle dont M. d’Urville a vu les débris, a péri sur un point de cette côte funeste
; les traditions des Insulaires s’accordent parfaitement sur le naufrage
des deux grandes pirogues. L’une d’elles, celle dont M. d’Urville n’a retrouyé
aucun débris, a péri corps et biens, suivant les récits des Naturels; l’équipage
de l’autre, naufragée sur les récifs où sont encore ses grosses ancres et ses
canons, se sauva à terre, y forma sur le rivage un petit établissement pour
se mettre à l’abri des attaques des Insulaires. Ceux-ci d’ailleurs prétendent
qu’on ne commit contre eux aucune hostilité. A l’aide de leurs embarcations
qu’ils avaient sauvées, les naufragés apportèrent sur la plage un grand nombre
de pièces de bois de leur navire qu’ils allaient dépecer : d’autres, pendant ce
temps-là, construisaient, avec les débris, une pirogue plus petite, sur laquelle,
un jour, sept lunes après leur naufrage, tous, à l’exception de deux qui moururent
bientôt de maladies, s’éloignèrent, sans que depuis ils en aient jamais
entendu parler. Les Insulaires pensent que ces malheureux, surpris par le
mauvais temps dans cette mer semée d’écueils, sillonnée de courants rapides
et battue de fréquents orages, périrent bientôt. M. d’Urville a fouillé soigneusement
les îles voisines sans rien apprendre sur leur sort. Quel qu’il ait été,
l’épouvantable climat de cet archipel aura sans doute détruit depuis long-temps
tous ceux que la mer a pu ne pas engloutir. C’est avec un équipage réduit,
par les morts violentes et les maladies, à 20 hommes valides, mais dont il
fallait ménager les forces avec le soin le plus avare, pour ne pas les voir mourir
bientôt, que M. d’Urville a fait cette dangereuse exploration de farchipel de
Sainte-Lucie.
Je n’ai pu mettre le pied sur l Astrolabe sans éprouver un sentiment de
respect ; c’était l’émotion des personnes religieuses qui entrent dans un temple. Les
chances désastreuses qu’il a courues plusieurs fois, et auxquelles il n’a échappé
que par une sorte de miracle, le rendaient sacré à mes yeux. Il faut se hâter,
m’a dit M. d’Urville, d’aller étudier ces peuples de la Polynésie, si l’on veut
observer leurs moeurs sauvages. Chaque jour, quelque île y perd sa virginité
de sauvagerie par le commerce des hommes blancs que les naufrages y jettent,
ou que les nécessités de leur navigation y conduisent. Ces éclaireurs de la civilisation
européenne, ce* sont des Anglais ou des Anglo-Américains surtout.
Depuis que les côtes de la Nouvelle-Hollande leur offrent quelques points de
relâche et de refuge, les baleiniers de ces deux nations s’aventurent audacieusement
dans ces mers nouvelles, avec de gros navires armés des plus faibles
équipages et dépourvus de toutes les connaissances comme de tous les moyens
dynamiques qui diminueraient quelques-uns des dangers de leur navigation.
L’abondance de la pêche fait faire une petite fortuné en une seule campagne,
à ceux qui reviennent ; mais M. d’Urville estime que la moitié doit périr.
Dans beaucoup d’îles Polynésiennes, voisines de Yanikoro, il a vu quelques
Européens, déserteurs ou naufragés. Les chefs des Insulaires mettent beaucoup
de prix à en avoir quelques-uns autour d’eux ; ils en sont fiers comme
d’une conquête. Ceux d’ailleurs qui ont déserté, ont emporté à terre des armes
jà feu; ce qui les rend, dans l’occasion fréquente d’un combat, des amis fort
utiles aux chefs, qui les retiennent néanmoins, sans les maltraiter, dans une
sorte de domesticité. M. d’Urville a payé malgré lui son tribut à la civilisation
de ces Iles, en laissant à Tongatabou deux déserteurs de son bord.
Toutes ces peuplades, m’a-t-il dit, ont des castes immuables : elles sont les
mêmes d’une extrémité à l’autre de cette immense traînée d’îles qui forment
la Polynésie. Toutes aussi ont, dans le culte du Tabou, un trait de ressemblance
auquel la similitude d’un assez grand nombre de mots, dans les.cinq
idiomes généraux qu’ils parlent, donne une valeur très-grande. Quant aux
caractères de l’organisation physique de ces peuples, ils présentent les variétés
les plus nombreusês et presque les oppositions les plus tranchées. M. d’Urville
apporte la plus vaste collection de portraits que jamais voyageur ait faite.
Les modèles en ont été choisis avec discernement et dessinés avec une rare
fidélité. J’ai vu ces dessins, bien rapidement sans doute, mais il ne m’en est
resté que le souvenir d’une énigme inexplicable. M. d’Urville, il me semble,
ni M. Quoy, ne comprennent pas mieux ces figures longues, ces fronts élevés
, ces yeux bien ouverts, ces nez aquilins avec ces lèvres minces, ces têtes
caucasiennes, enfin, dans des Iles qu’un canal étroit sépare d’autres Iles dont
les habitants parlent le même langage, habitent des demeures semblablement
construites, se servent des mêmes instruments de chasse et de pêche, et dont
les traits physiques sont absolument différents.
Taïti, Owhihée, ne sont plus des pays sauvages. Le commerce y a fixé des
Européens. Le zèle religieux y a depuis long-temps appelé des missionnaires.
On y construit déjà des bâtiments d’un assez fort tonnage.
La Nouvelle-Zélande, elle-même, la terre classique de l’anthropophagie, reçoit
des missionnaires anglais de l’Australasie. Ces missionnaires vivent libres
et en sécurité au milieu des Sauvages qui les prennent pour des fous, et les
respectent à ce titre. Bizarre sainteté de l’aliénation mentale chez les peuples
ignorants ou barbares ! Les missionnaires sont Tabous, chez ces Insulaires. Ils