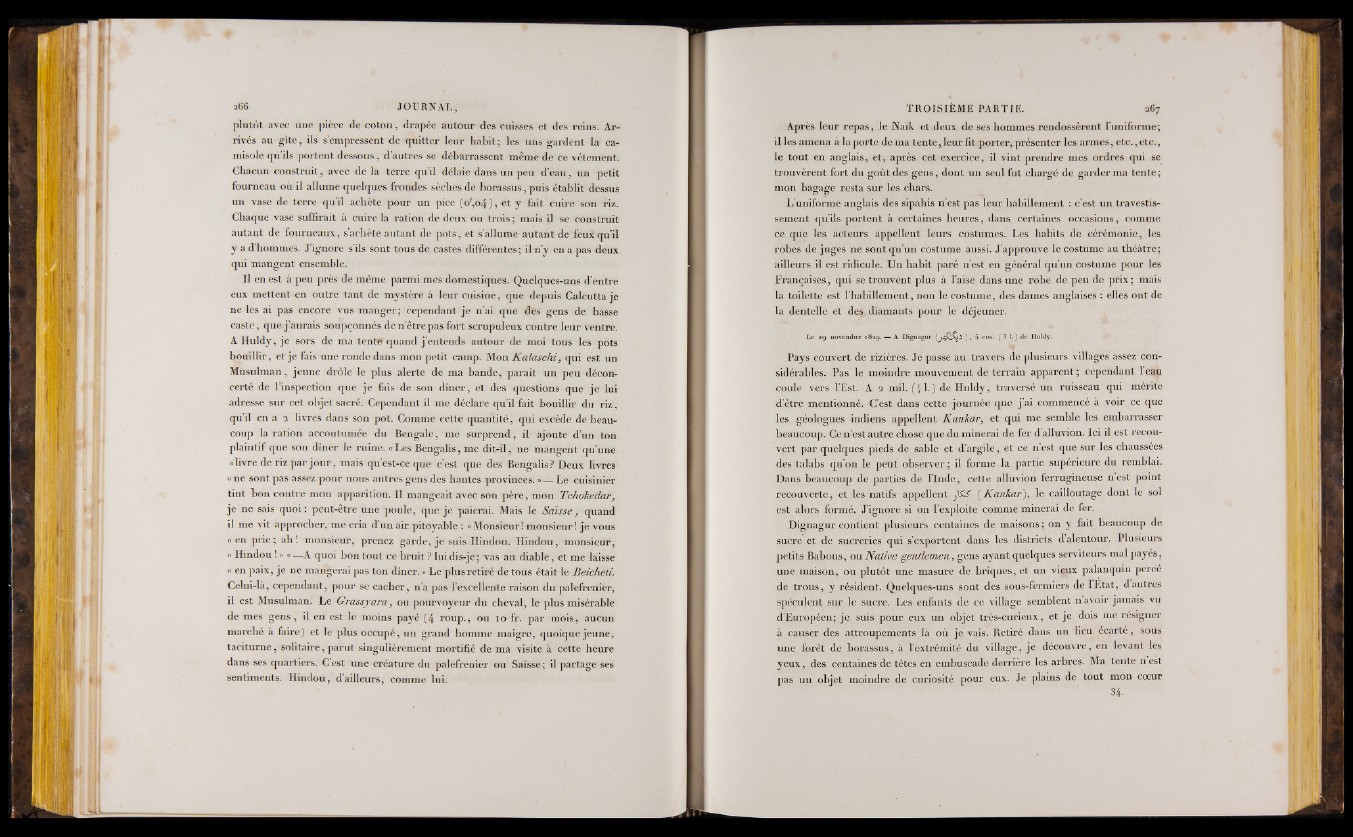
plutôt avec une pièce de coton, drapée autour des cuisses et des reins. Arrivés
au gîte, ils s’empressent de quitter leur habit; les uns gardent la camisole
qu’ils portent dessous, d’autres se débarrassent même de ce vêtement.
Chacun construit, avec de la terre qu’il délaie dans un peu d'eau, un petit
fourneau où il allume quelques frondes sèches de borassus, puis établit dessus
un vase de terre qu’il achète pour un pice (o',o4), et y fait cuire son riz.
Chaque vase suffirait à cuire la ration de deux ou trois ; mais il se construit
autant de fourneaux, s’achète autant de pots, et s’allume autant de feux qu’il
y a d’hommes. J’ignore s’ils sont tous de castes différentes; il n’y en a pas deux
qui mangent ensemble.
Il en est à peu près de même parmi mes domestiques. Quelques-uns d’entre
eux mettent en outre tant de mystère à leur cuisine, que depuis Calcutta je
ne les ai pas encore vus manger; cependant je n’ai que des gens de basse
caste, que j ’aurais soupçonnés de n’être pas fort scrupuleux contre leur ventre.
A Huldy, je sors de ma tent® quand j ’entends autour de moi tous les: pots
bouillir, et je fais une ronde dans mon petit camp. Mon Kalaschi, qui est un
Musulman, jeune drôle le plus alerte de ma bande, paraît un peu déconcerté
de l ’inspection que je fais de son dîner, et des questions que je lui
adresse sur cet objet sacré. Cependant il me déclare qu’il fait bouillir du riz ,
qu’il en a 2 livres dans son pot. Comme cette quantité, qui excède de beaucoup
la ration accoutumée du Bengale, me surprend, il ajoute d’un ton
plaintif que son dîner le ruine. «Les Bengalis, me dit-il, ne mangent qu’une
«livre de riz par jou r , mais qu’est-ce que c’est que des Bengalis? Deux livres
« ne sont pas assez pour nous autres gens des hautes provinces. » — Le cuisinier
tint bon contre mon apparition. Il mangeait avec son père, mon Tchokedar,
je ne sais quoi: peut-etre une poule, que je paierai. Mais le Saïsse, quand
il me vit approcher, me cria d’un air. pitoyable : « Monsieur ! monsieur ! je vous
«en prie; ah! monsieur, prenez garde, je suis Hindou. Hindou, monsieur,
« Hindou ! » « —A quoi bon tout ce bruit ? lui dis-je ; vas au diable, et me laisse
« en paix, je ne mangerai pas ton dîner. » Le plus retiré de tous était le Beicheti.
Celui-là, cependant, pour se cacher, n’a pas l’excellente raison du palefrenier,
il est Musulman. Le Grassy'ara, ou pourvoyeur du cheval, le plus misérable
de mes g en s , il en est le moins payé (4 roup., ou io fr. par mois, aucun
marché à faire) et le plus occupé, un grand homme maigre, quoique jeune,
taciturne, solitaire, parut singulièrement mortifié de ma visite à cette heure
dans ses quartiers. C est une créature du palefrenier ou Saïsse ; il partage ses
sentiments. Hindou, d’ailleurs, comme lui.
Après leur repas, le iNaik et deux de ses hommes rendossèrent l’uniforme;
il les amena à la porte de ma tente, leur fit porter, présenter les armes, etc., etc.,
le tout en anglais, et, après cet exercice, il vint prendre mes ordres qui se
trouvèrent fort du goût des gens, dont un seul fut chargé de garder ma tente ;
mon bagage resta sur lès chars.
L’uniforme anglais des sipahis n’est pas leur habillement : c’est un travestissement
qu’ils portent à certaines heures, dans certaines occasions, comme
ce que les acteurs appellent leurs costumes. Les habits de cérémonie, les
robes de juges ne sont qu’un costume aussi. J’approuve le costume au théâtre;
ailleurs il est ridicule. Un habit paré n’est en général qu’un costume pour les
Françaises, qui se trouvent plus à l’aise dans une rohe de peu de prix; mais
la toilette est l’habillement, non le costume, des dames anglaises : elles ont de
la dentelle et des diamants pour le déjeuner.
Le 39 novembre 1839. — A Dignagur [ j & S ), 5 cos. ( 3:1.) de Huldy.
Pays couvert de rizières. Je passe au travers de plusieurs villages assez considérables.
Pas le moindre mouvement de terrain apparent ; cependant l’eau
coule vers l’Est. A 2 mil. (4 I.) de Huldy, traversé un ruisseau qui mérite
detre mentionné. C’est dans cette journée que j ’ai commencé à voir ce que
les géologues indiens appellent Kankar, et qui me semble les embarrasser
beaucoup. Ce n’est autre chose que du minerai de fer d’alluvion. Ici il est recouvert
par quelques pieds de sable et d’argile, et ce n’est que sur les chaussées
des talabs qu’on le peut observer ; il forme la partie supérieure du remblai.
Dans beaucoup de parties de l’Inde, cette alluvion ferrugineuse n’est point
recouverte, et les natifs appellent jVX (Kankar), le cailloutage dont le sol
est alors formé. J’ignore si on l’exploite comme minerai de fer.
Dignagur contient plusieurs centaines de maisons ; on y fait beaucoup de
sucre et de sucreries qui s’exportent dans les districts d’alentour. Plusieurs
petits Babous, ou Native gentlemen, gens ayant quelques serviteurs mal payés,
une maison, ou plutôt une masure de briques, et un vieux palanquin percé
de trous, y résident. Quelques-uns sont des sous-fermiers de lE tat, dautres
spéculent sur le sucre. Les enfants de ce village semblent n’avoir jamais vu
d’Européen; je, suis pour eux un objet très-curieux, et je dois me résigner
à causer des attroupements là où je vais. Retiré dans un lieu écarté, sous
une forêt de borassus, à l ’extrémité du village, je découvre, en levant les
yeux, des centaines de têtes en embuscade derrière les arbres. Ma tente n est
pas uu objet moindre de curiosité pour eux. Je plains de tout mon coeur
3 4 -