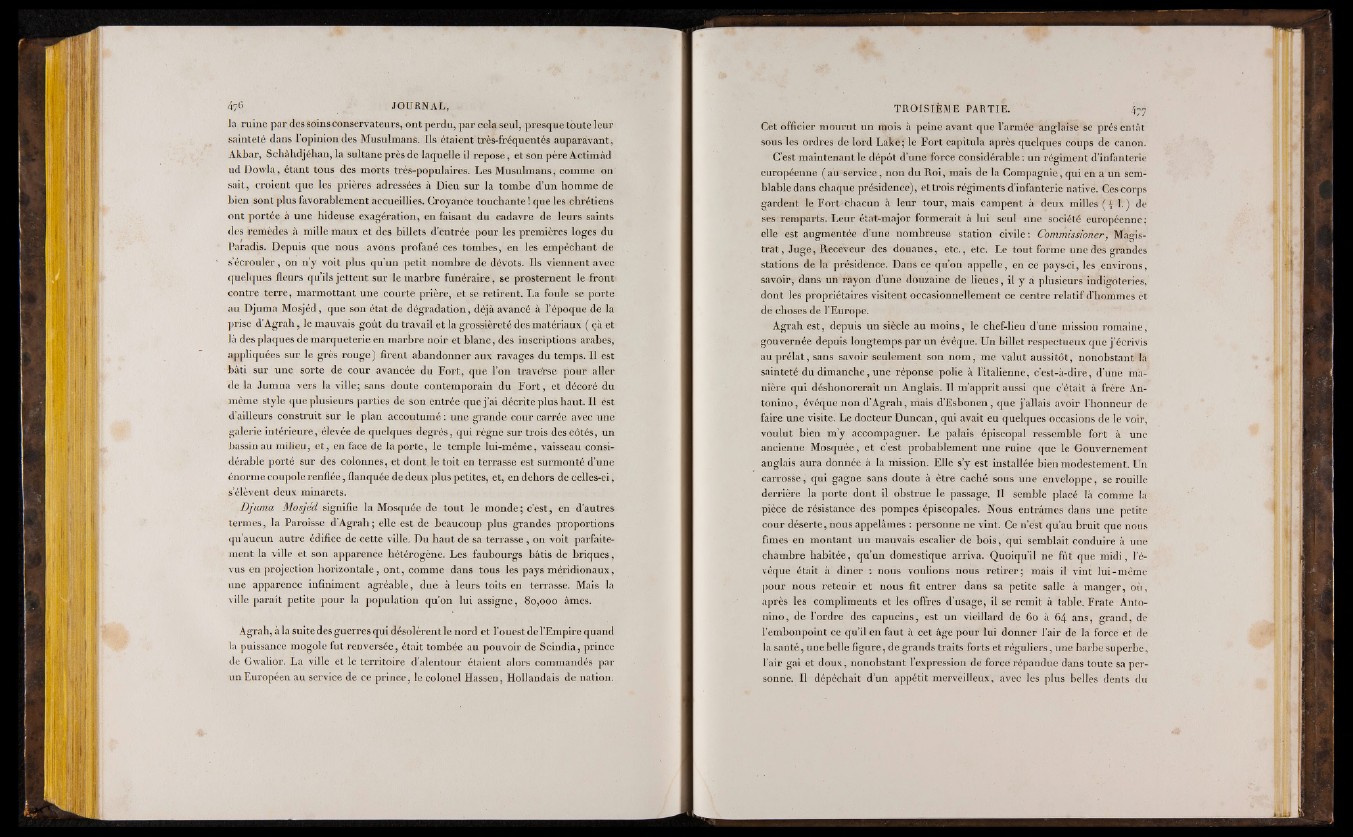
la ruine par des soins conservateurs, ont perdu, par cela seul, presque toute leur
sainteté dans l'opinion des Musulmans. Ils étaient très-fréquentés auparavant,
Akbar, Schahdjéhan, la sultane près de laquelle il reposé, et son père Actimad
ud Dowla, étant tous des morts très-populaires. Les Musulmans, comme on
sait, croient que les prières adressées à Dieu sur la tombe d’un homme de
bien sont plus favorablement accueillies. Croyance touchante! que les chrétiens
ont portée à une hideuse exagération, en faisant du cadavre de leurs saints
des remèdes à mille maux et des billets d’entrée pour les premières loges du
Paradis. Depuis que nous avons profané ces tombes, en les empêchant de
s’écrouler, on n’y voit plus qu'un petit nombre de dévots. Ils viennent avec
quelques fleurs qu’ils jettent sur le marbre funéraire, se prosternent le front’
contre terre, marmottant une courte prière, et se retirent. La foule se porte
au Djuma Mosjéd, que son état de dégradation, déjà avancé à l’époque de la
prise d’Agrah, le mauvais goût du travail et la grossièreté des matériaux ( çà et
là des plaques de marqueterie en marbre noir et blanc, des inscriptions arabes,
appliquées sur le grès rouge) firent abandonner aux ravages du temps. Il est
bâti sur une sorte de cour avancée du Fort, que l’on traverse pour aller
de la Jumna vers la ville; sans doute contemporain du F o r t, et décoré du
même style que plusieurs parties de son entrée que j ’ai décrite plus haut. Il est
d’ailleurs construit sur le plan accoutumé : une grande cour carrée avec une
galerie intérieure, élevée de quelques degrés, qui règne sur trois des côtés, un
bassin au milieu, e t, en face de la porte, le temple lui-même, vaisseau considérable
porté sur des colonnes, et dont le toit en terrasse est surmonté d’une
énorme coupole renflée, flanquée de deux plus petites, et, en dehors de celles-ci,
s’élèvent deux minarets.
Djuma Mosjéd signifie là Mosquée de tout le monde; c’est, en d’autres
termes, la Paroisse d’Agrah; elle est de beaucoup plus grandes proportions
qu’aucun autre édifice de cette ville. Du haut de sa terrasse , on voit parfaitement
la ville et son apparence hétérogène. Les faubourgs bâtis de briques,
vus en projection horizontale, ont, comme dans tous les pays méridionaux,
une apparence infiniment agréable, due à leurs toits en terrasse. Mais la
ville parait petite pour la population qu’on lui assigne, 80,000 âmes.
Agrab, à la suite des guerres qui désolèrent le nord et l’ouest de l’Empire quand
la puissance mogole fut renversée, était tombée au pouvoir de Scindia, prince
de Gwalior. La ville et le territoire d’alentour étaient alors commandés par
un Européen au service de ce prince, le colonel Hassen, Hollandais de nation.
Cet officier mourut un mois à peine avant que l’armée anglaise se prés entât
sous les ordres de lord Lake; le Fort capitula après quelques coups de canon.
C’est maintenant le dépôt d’une force considérable : un régiment d’infanterie
européenne (au service, non du Roi, mais de la Compagnie, qui en a un semblable
dans chaque présidence):,'et trois régiments d’infanterie native. Ces corps
gardent le Fort Chacun à leur tour, mais campent à deux milles ( f b ) de
ses remparts. Leur état-major formerait à lui seul une société européenne;
elle est augmentée d’une nombreuse station civile : Commissïoner, Magistrat,
Juge, Receveur des douanes, etc., etc. Le tout forme une dès grandes
stations de la présidence. Dans ce qu’on appelle, en ce pays-ci, les environs,
savoir, dans un rayon d’une douzaine de lieues, il y a plusieurs indigoteries,
dont les propriétaires visitent occasionnellement ce centre relatif d’hommes et
de choses de l’Europe.
Agrah est, depuis un siècle au moins, le chef-lieu d’une mission romaine,
gouvernée depuis longtemps par un évêque. Un billet respectueux que j ’écrivis
au prélat, sans savoir seulement son nom, me valut aussitôt, nonobstant la
sainteté du dimanche, une réponse polie à l’italienne, c’est-à-dire, d’une manière
qui déshonorerait un Anglais. Il m’apprit aussi que c’était à frère An-
tonino, évêque non d’Agrah, mais d’Esbonen, que j ’allais avoir l’honneur de
faire une visite. Le docteur Duncan, qui avait eu quelques occasions de le voir,
voulut bien m’y accompagner. Le palais épiscopal ressemble fort à une
ancienne Mosquée, et c’est probablement une ruine que le Gouvernement
anglais aura donnée à la mission. Elle s’y est installée bien modestement. Un
carrosse, qui gagne sans doute à être caché sous une enveloppe, se rouille
derrière la porte dont il obstrue le passage. Il semble placé là comme la
pièce de résistance des pompes épiscopales. Nous entrâmes dans une petite
cour déserte, nous appelâmes : personne ne vint. Ce n’est qu’au bruit, que nous
fimes en montant un mauvais escalier de bois, qui semblait conduire à une
chambre habitée, qu’un domestique arriva. Quoiqu’il ne fût que midi, l’é-
vêque était à dîner : nous voulions nous retirer; mais il vint lui-même
pour nous retenir et nous fit entrer dans sa petite salle à manger, où,
après les compliments et les offres d’usage, il se remit à table. Frate Anto-
nino, de l’ordre des capucins, est un vieillard de 60 à 64 ans, grand, de
l’embonpoint ce qu’il en faut à cet âge pour lui donner l’air de la force et de
la santé, une belle figure, de grands traits forts et réguliers, une barbe superbe,
l’air gai et doux, nonobstant l’expression de forcé répandue dans toute sa personne.
Il dépêchait d’un appétit merveilleux, avec les plus belles dents du