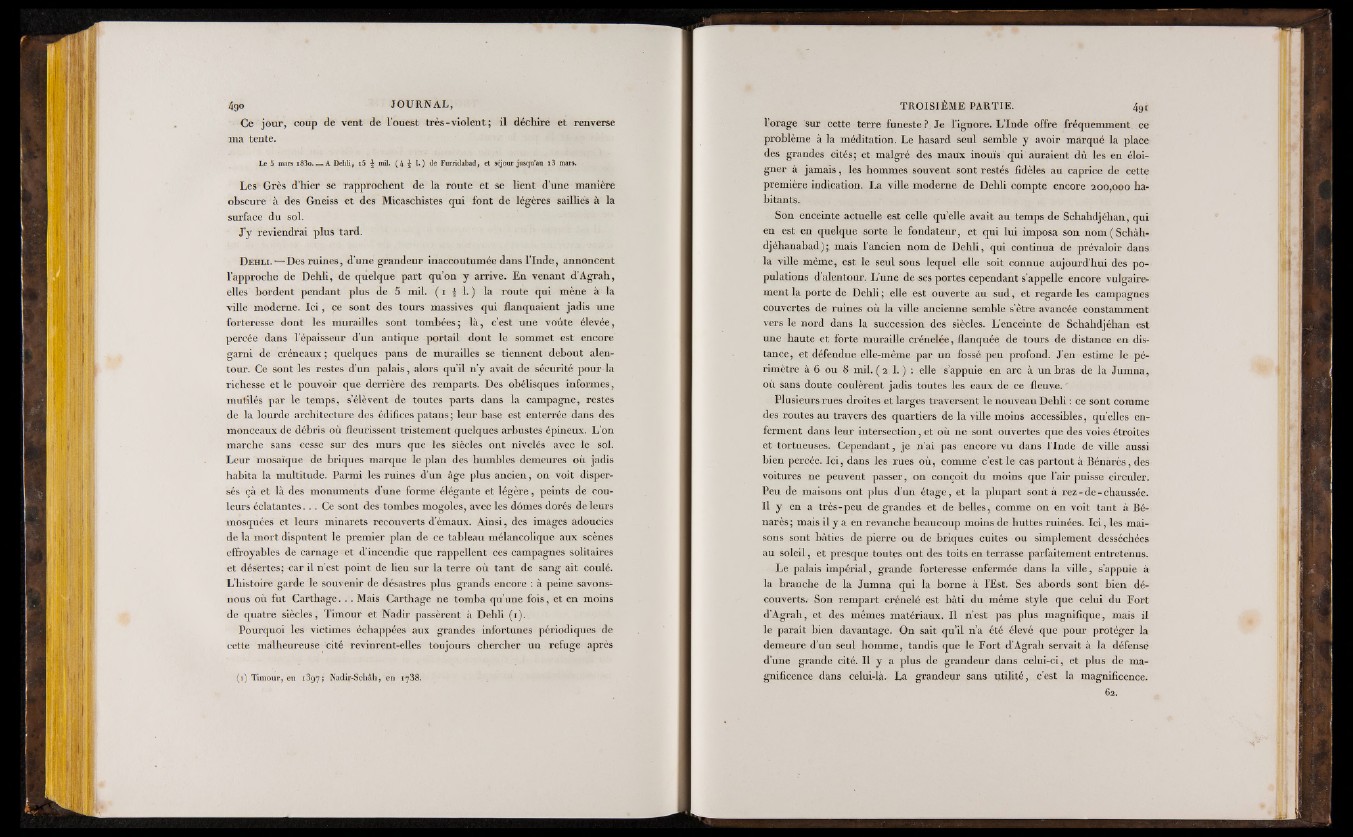
Ce jour, coup de vent de l’ouest très-violent; il déchire et renverse
ma tente.
Le 5 mars i 83o A Dehli, x5 ^ mil. (4 I !•) de Furridabad, et séjour jusqu’au x3 mars.
Les Grès d’hier se rapprochent de la route et se lient d’une manière
obscure à des Gneiss et des Micaschistes qui font de légères saillies à la
surface du sol.
J’y reviendrai plus tard.
D e h l i . — Des ruines, d’une grandeur inaccoutumée dans l’Inde, annoncent
l ’approche de Dehli, de quelque part qu’on y arrive. En venant d’Agrah,
elles bordent pendant plus de 5 mil. ( i { 1.) la route qui mène à la
ville moderne. I c i , ce sont des tours massives qui flanquaient jadis une
forteresse dont les murailles sont tombées; là , c’est une voûte élevée,
percée dans l’épaisseur d’un antique portail dont le sommet est encore
garni de créneaux ; quelques pans de murailles se tiennent debout alentour.
Ce sont les restes d’un palais, alors qu’il n’y avait de sécurité pour la
richesse et le pouvoir que derrière des remparts. Des obélisques informes,
mutilés par le temps, s’élèvent de toutes parts dans la campagne, restes
de la lourde architecture des édifices patans; leur base est enterrée dans des
monceaux de débris où fleurissent tristement quelques arbustes épineux. L ’on
marche sans cesse sur des murs que les siècles ont nivelés avec le sol.
Leur mosaïque de briques marque le plan des humbles demeures où jadis
habita la multitude. Parmi.les ruines d’un âge plus ancien, on voit dispersés
çà et là des monuments d’une forme élégante et légè re , peints de couleurs
éclatantes. . . Ce sont des tombes mogoles, avec les dômes dorés de leurs
mosquées et leurs minarets recouverts d’émaux. Ainsi, des images adoucies
de la mort disputent le premier plan de ce tableau mélancolique aux scènes
effroyables de carnage et d’incendie que rappellent ces campagnes solitaires
et désertes; car il n’est point de lieu sur la terre où tant de sang ait coulé.
L’histoire garde le souvenir de désastres plus grands encore : à peine savons-
nous où fut Carthage. . . Mais Carthage ne tomba qu’une fois, et en moins
de quatre siècles, Timour et Nadir passèrent à Dehli (i).
Pourquoi les victimes échappées aux grandes infortunes périodiques de
cette malheureuse cité revinrent-elles toujours chercher un refuge après
(i) Timour, en 1397; Nadir-Scliâh, en 1738.
l’orage sur cette terre funeste ?, Je l’ignore. L ’Inde offre fréquemment ce
problème à la méditation. Le hasard seul semble y avoir marqué la place
des grandes cités; et malgré des maux inouïs qui auraient dû les en éloigner
à jamais, les hommes souvent sont restés fidèles au caprice de cette
première indication. La ville moderne de Dehli compte encore 200,000 habitants.
Son enceinte actuelle est celle qu’elle avait au temps de Schahdjéhan, qui
en est en quelque sorte le fondateur, et qui lui imposa son nom(Schâh-
djéhanabad); mais l’ancien nom de Dehli, qui continua de prévaloir dans
la ville même, est le seul sous lequel elle soit connue aujourd’hui des populations
d’alentour. L ’une de ses portes cependant s’appelle encore vulgairement
la porte de Dehli ; elle est ouverte au sud, et regarde les campagnes
couvertes de ruines où la ville ancienne semble s’être avancée constamment
vers le nord dans la succession des siècles. L’enceinte de Schahdjéhan est
une haute et forte muraille crénelée, flanquée de tours de distance en distance,
et défendue elle-même par un fossé peu profond. J’en estime le périmètre
à 6 ou 8 mil. (2 1. ) : elle s’appuie en arc à un bras de la Jumna,
où sans doute coulèrent jadis toutes les eaux de ce fleuve. '
Plusieurs rues droites et larges traversent le nouveau Dehli : ce sont comme
des routes au travers des quartiers de la ville moins accessibles, qu’elles enferment
dans leur intersection, et où ne sont ouvertes que des voies étroites
et tortueuses. Cependant, je n’ai pas encore vu dans l’Inde de ville aussi
bien percée. Ici, dans les rues où, comme c’est le cas partout à Bénarès, des
voitures ne peuvent passer, on conçoit du moins que l’air puisse circuler.
Peu de maisons ont plus d’un étage, et la plupart sont à rez - de - chaussée.
Il y en a très-peu de grandes et de belles, comme on en voit tant à Bénarès
; mais il y a en revanche beaucoup moins de huttes ruinées. I c i, les maisons
sont bâties de pierre ou de briques cuites ou simplement desséchées
au soleil, et presque toutes ont des toits en terrasse parfaitement entretenus.
Le palais impérial, grande forteresse enfermée dans la ville, s’appuie à
la branche de la Jumna qui la borne à l’Est. Ses abords sont bien découverts.
Son rempart crénelé est bâti du même style que celui du Fort
d’Agrah, et des mêmes matériaux. Il n’est pas plus magnifique, mais il
le paraît bien davantage. On sait qu’il n’a été éleyé que pour protéger la
demeure d’un seul homme, tandis que le Fort d’Agrah servait à la défense
d’une grande cité. Il y a plus de grandeur dans celui-ci, et plus de magnificence
dans celui-là* La grandeur sans utilité, c’est la magnificence.
62.