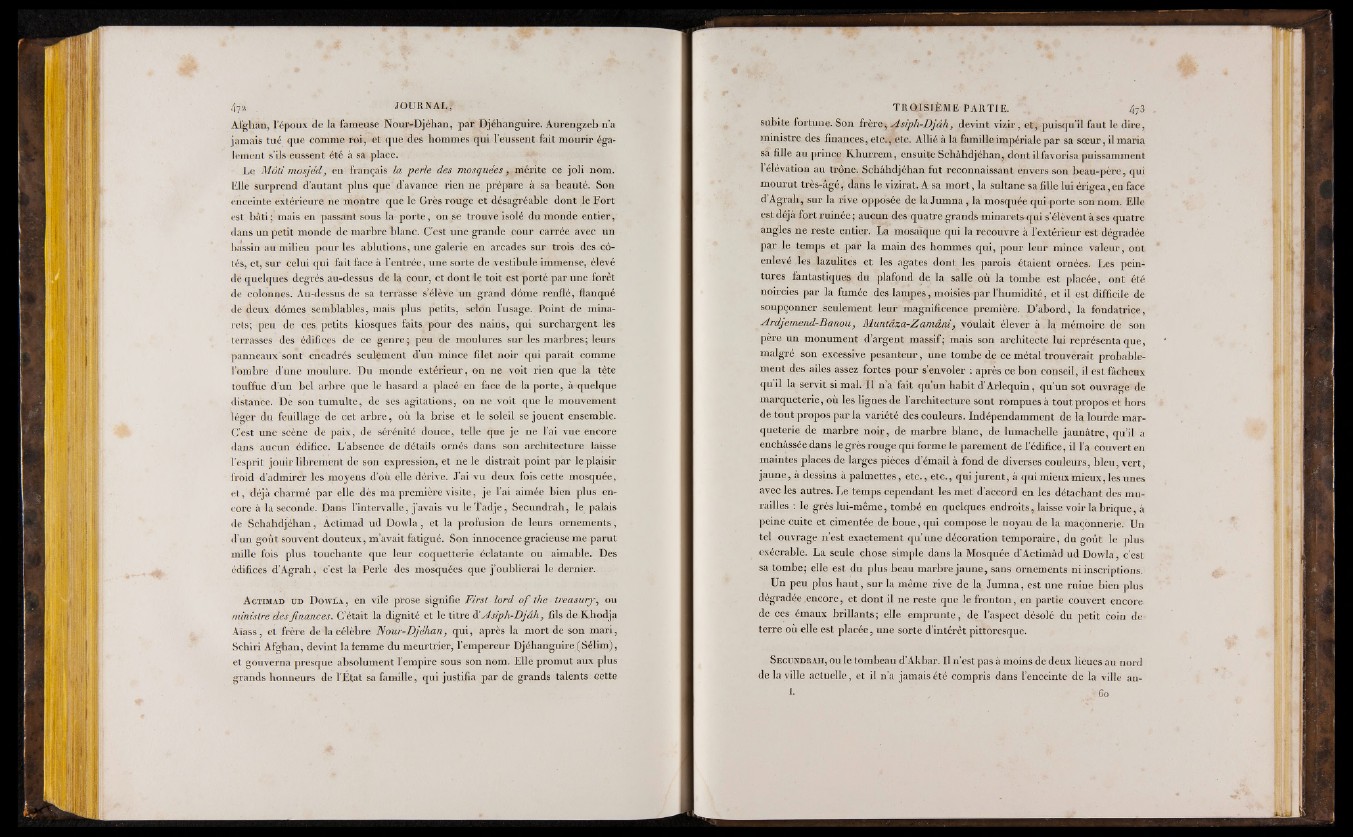
Afghan, l’époux de la fameuse Nour-Djéhan, par Djéhanguire. Aurengzeb n’a
jamais tué que comme roi, et que des hommes qui l’eussent fait mourir également
s'ils eussent été à sa place.
Le Môti mosjéd, en français la perle des mosquées, mérite ce joli nom.
Elle surprend d’autant plus que d’avance rien ne prépare à sa beauté. Son
enceinte extérieure ne montre que le Grès rouge et désagréable dont le Fort
est bâti ; mais en passant sous la porte, on se trouve isolé du monde entier,
dans un petit monde de marbre blanc. C’est une grande cour carrée avec un
bassin au milieu pour les ablutions, une galerie en arcades sur trois des côtés,
et, sur celui qui fait face à l’entrée , une sorte de vestibule immense, élevé
de quelques degrés,au-dessus de la cour, et dont le toit est porté par une forêt
de colonnes. Au-dessus de sa terrasse s'élève un grand dôme renflé, flanqué
de deux dômes semblables, mais plus petits, selon l’usage. Point de minarets;
peu de ces petits kiosques faits pour des nains, qui surchargent lès
terrasses des édifices de ce genre; peu de moulures sur les marbres; leurs
panneaux sont encadrés seulement d'un mince filet noir qui paraît comme
l’ombre d’une moulure. Du monde extérieur, ou ne voit rien que la tête
touffue d’un bel arbre que le hasard a placé en face de la porte, à quelque
distance. De son tumulte, de ses agitations, on ne voit que le mouvement
léger du feuillage de cet arbre, où la brise et le soleil se jouent ensemble.
C’est une scène de paix, de sérénité douce, telle que je ne l’ai vue encore
dans aucun édifice. L’absence de détails ornés dans son architecture laisse
l’esprit jouir librement de son expression, et ne le distrait point par le plaisir
froid d’admirer les moyens d’où elle dérive. J’ai vu deux fois cette mosquée,
e t , déjà charmé par elle dès ma première visite, je l’ai aimée bien plus encore
à la seconde. Dans l’intervalle, j'avais vu leT ad je , Secundrah, le palais
de Schahdjéhan, Actimad ud Dow la, et la profusion de leurs ornements,,
d'un goût souvent douteux, m’avait fatigué. Son innocence gracieuse me parut
mille fois plus touchante que leur coquetterie éclatante ou aimable. Des
édifices d’Agrah, c’est la Perle des mosquées que j ’oublierai le dernier.
A c t im a d ü d D o w l a , en vile prose signifie First lord o f the treasury, ou
ministre des finances. C’était la dignité et le titre d’Asiph-Djâh, fils de Khodja
Aïass, et frère delaeélèbre Nour-Djéhan, qui, après la mort de son mari,
Schiri Afghan, devint la femme du meurtrier, l’empereur Djéhanguire (Sélim),
et gouverna presque absolument l'empire sous son nom. Elle promut aux plus
grands honneurs de l’État sa famille, qui justifia par de grands talents cette
subite fortune. Son frèr&j Asiph-Djâh, devint vizir, et, puisqu’il faut le dire,
ministre des finances, e!<v. : etc. Allié à la famille impériale par sa soeur, il maria
sâ fille au princg Khurrem, ensuite Schahdjéhan, dont il favorisa puissamment
l’élévation au trône. Schahdjéhan fut reconnaissant envers son beau-père, qui
mourut très-âgé, dans le vizirat. A sa mort, la sultane sa fille lui érigea, en face
d’Agrah, sur la rive opposée de la Jumna, la mosquée qui porte son nom. Elle
est déjà fort ruinée; aucun des quatre grands minarets qui s’élèvent à ses quatre
angles ne reste entier. La mosaïque qui la recouvre à l’extérieur est dégradée
par le temps et par la main des hommes qui, pour leur mince valeur, ont
enlevé les lazulites et les agates dont les parois étaient ornées. Les peintures
fantastiques du plafond de la salle où la tombe est placée, ont été
noircies par la fumée des lampes, moisiës par l’humidité, et il est difficile de
soupçonner seulement leur magnificence première. D’abord, la fondatrice,
Ardjemend-Banou, Muntâza-Zamâni, voulait élever à la mémoire de son
père un monument d’argent massif; mais son architecte lui représenta que,
malgré son excessive pesanteur, une tombe de ce métal trouvérait probablement
des ailes assez fortes pour s’envoler : après ce bon conseil, il est fâcheux
q u il la servit si mal. Il n a fait qu’un habit d’Arlequin, qu’un sot ouvrage de
marqueterie, où les figues de l’architecture sont rompues à tout propos et hors
de tout propos par la variété des couleurs. Indépendamment de la lourde marqueterie
de marbre noir, de marbre blanc, de lumachelle jaunâtre, qu’il a
enchâssée dans le grès rouge qui forme le parement de l’édifice, il l’a couvert en
maintes places de larges pièces d’émail à fond de diverses couleurs, bleu, vert,
jaune, à dessins à palmettes, etc., etc., qui jurent, à qui mieux mieux, les unes
avec les autres. Le temps cependant les met d’accord en les détachant des murailles
: le grès lui-même, tombé en quelques endroits, laisse voir la b rique, à
peine cuite et cimentée de boue, qui compose le noyau de la maçonnerie. Un
tel ouvrage n’est exactement qu’une décoration temporaire, du goût le plus
exécrable. La seule chose simple dans la Mosquée d’Actimâd ud Dowla1; c’est
sa tombe; elle est du plus beau marbre jaune, sans ornements ni inscriptions.
Un peu plus hau t, sur la même rive de la Jumna, est une ruine bien plus
dégradée .encore, et dont il ne reste que le fronton, en partie couvert encore
de ces émaux brillants; elle emprunte, de l ’aspect désolé du petit coin de
terre où elle est placée, une sorte d’intérêt pittoresque.
S e c u n d r a h , o u le tombeau d’Akbar. Il n’est pas à moins de deux lieues au nord
de la ville actuelle, et il n’a jamais été compris dans l’enceinte de la ville an-
| , ' f i 60