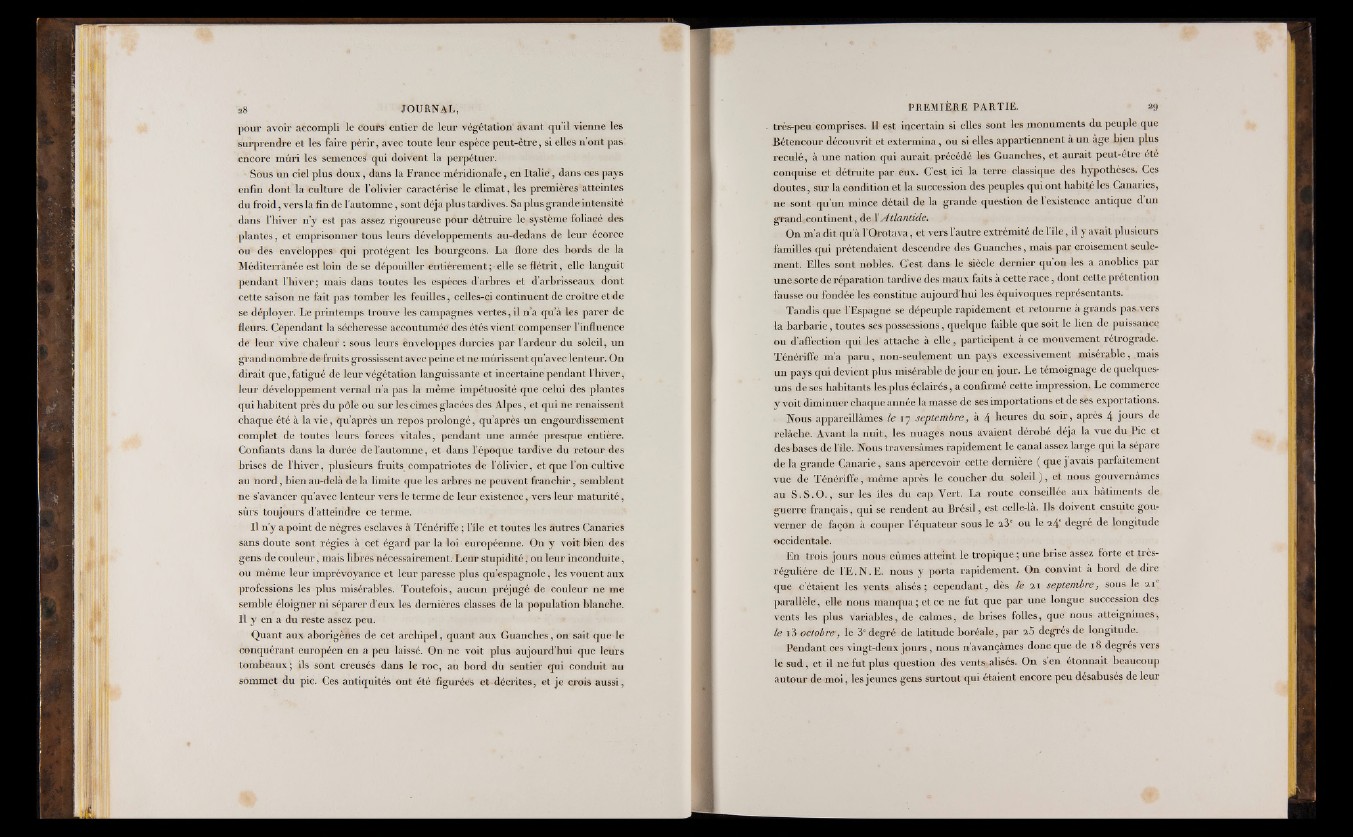
pour avoir accompli le cours entier de leur végétation avant qu’il vienne les
surprendre et les faire périr, avec toute leur espèce peut-être, si elles n’ont pas
encore mûri les semences qui doivent la perpétuer.
Sous un ciel plus doux, dans la France méridionale, en Italie, dans ces pays
enfin dont la culture de l’olivier caractérise le climat, les premières atteintes
du froid, vers la fin de l’automne, sont déjà plus tardives. Sa plus grande intensité
dans l’hiver n’y est pas assez rigoureuse pour détruire le système foliacé des
plantes, et emprisonner tous leurs développements au-dedans de leur écorce
ou des enveloppes qui protègent les bourgeons. La flore des bords de la
Méditerranée est loin de se dépouiller entièrement ; elle se flétrit, elle languit
pendant l’biver; mais dans toutes les espèces d’arbres et d’arbrisseaux dont
cette saison ne fait pas tomber les feuilles, celles-ci continuent de croître et de
se déployer. Le printemps trouve les campagnes vertes, il n’a qu’à les parer de
fleurs. Cependant la sécheresse accoutumée des étés vient compenser l’influence
de leur vive chaleur : sous leurs enveloppes durcies par l’ardeur du soleil, un
grand nombre de fruits grossissent avec peine et ne mûrissent qu’avec lenteur. On
dirait que, fatigué de leur végétation languissante et incertaine pendant l’hiver,
leur développement vernal n’a pas la même impétuosité que celui des plantes
qui habitent près du pôle ou sur les cimes glacées des Alpes, et qui ne renaissent
chaque été à la v ie, qu’après un repos prolongé, qu’après un engourdissement
complet de toutes leurs forces vitales, pendant une année presque entière.
Confiants dans la durée de l’automne, et dans l’époque tardive du retour des
brises de l’hiver, plusieurs fruits^ compatriotes de l’ôlivier, et que l’on cultive
au nord, bien au-delà de la limite que les arbres ne peuvent franchir, semblent
ne s’avancer qu’avec lenteur vers le terme de leur existence, vers leur maturité,
sûrs toujours d’atteindre ce terme.
Il n’y a point de nègres esclaves à Ténériffe ; l’île et toutes les autres Canaries
sans doute sont régies à cet égard par la loi européenne. On y voit bien des
gens de couleur, mais libres nécessairement. Leur stupidité, ou leur inconduite,
ou même leur imprévoyance et leur paresse plus qu’espagnole, les vouent aux
professions les plus misérables. Toutefois, aucun préjugé de couleur ne me
semble éloigner ni séparer d’eux les dernières classes de la population blanche.
Il y en a du reste assez peu.
Quant aux aborigènes de cet archipel, quant aux Guanches, on sait que le
conquérant européen en a peu laissé. On ne voit plus aujourd’hui que leurs
tombeaux; ils sont creusés dans le roc, au bord du sentier qui conduit au
sommet du pic. Ces antiquités ont été figurées et décrites, et je crois aussi,
très-peu comprises. Il est incertain si elles sont les monuments du peuple que
Bétencour découvrit et extermina, ou si elles appartiennent à un âge bien plus
reculé, à une nation qui aurait,précédé les Guanches, et aurait peut-être été
conquise et détruite par eux. C’est ici la terre classique des hypothèses, Ces
doutes, sur la condition et la succession des peuples qui ont habité les Canaries,
ne sont qu’un mince détail de la grande question de l’existence antique d’un
grand?continent, de l'Atlantide.
On m’a dit qu’à l’Orotava, et vers l’autre extrémité de l’île, il y avait plusieurs
familles qui prétendaient descendre des Guanches, mais par croisement seulement.
Elles sont nobles. C’est dans le siècle dernier qu’on les a anoblies par
une sorte de réparation tardive des maux faits à cette race, dont cette prétention
fausse ou fondée les constitue aujourd’hui les équivoques représentants.
Tandis que l’Espagne se dépeuple rapidement et retourne à grands pas .vers
la barbarie, toutes ses possèssions, quelque faible que soit le lien de puissance
ou d’affection qui les attache à elle , participent à ce mouvement rétrograde.
Ténériffe m’a paru, non-seulement un pays excessivement misérable, mais
un pays qui devient plus misérable de jour en jour. Le témoignage de quelques-
uns de ses habitants les,plus éclairés, a confirmé cette impression. Le commerce
y voit diminuer chaque année la masse de ses importations et de ses exportations.
Nous appareillâmes le 17 septembre, à 4 heures du soir, après 4 jours de
relâche. Avant la nuit, les nuages nous avaient dérobé déjà la vue du Pic et
des bases de l’île. Nous traversâmes rapidement le canal assez large qui la sépare
de la grande Canarie, sans apercevoir cette dernière ( que j avais parfaitement
vue de Ténériffe, même après le coucher du soleil ), et nous gouvernâmes
au S .S .O . , sur les îles du cap Vert. La route conseillée aux bâtiments de
guerre français, qui se rendent au Brésil, est celle-là. Us doivent ensuite gouverner
de façon à couper l’équateur sous le 23e ou le 24e degre de longitude
occidentale.
En trois jours nous eûmes atteint le tropique ; une brise assez forte et très-
régulière de l’E . N . E. nous y porta rapidement. On convint à bord de dire
que c’étaient les vents alisés ; cependant, dès le 21 septembre, sous le 21e
parallèle, elle nous manqua; et ce ne fut que par une longue succession des
vents les plus variables, de calmes, de brises folles, que nous atteignîmes,
le i3 octobre', le 3e degré de latitude boréale, par 25 degrés de longitude.
Pendant ces vingt-deux jours , nous n’avançâmes donc que de 18 degrés vers
le sud, et il ne fut plus question des vents; alisés. On s en étonnait beaucoup
autour de moi, les jeunes gens surtout qui étaient encore peu désabusés de leur