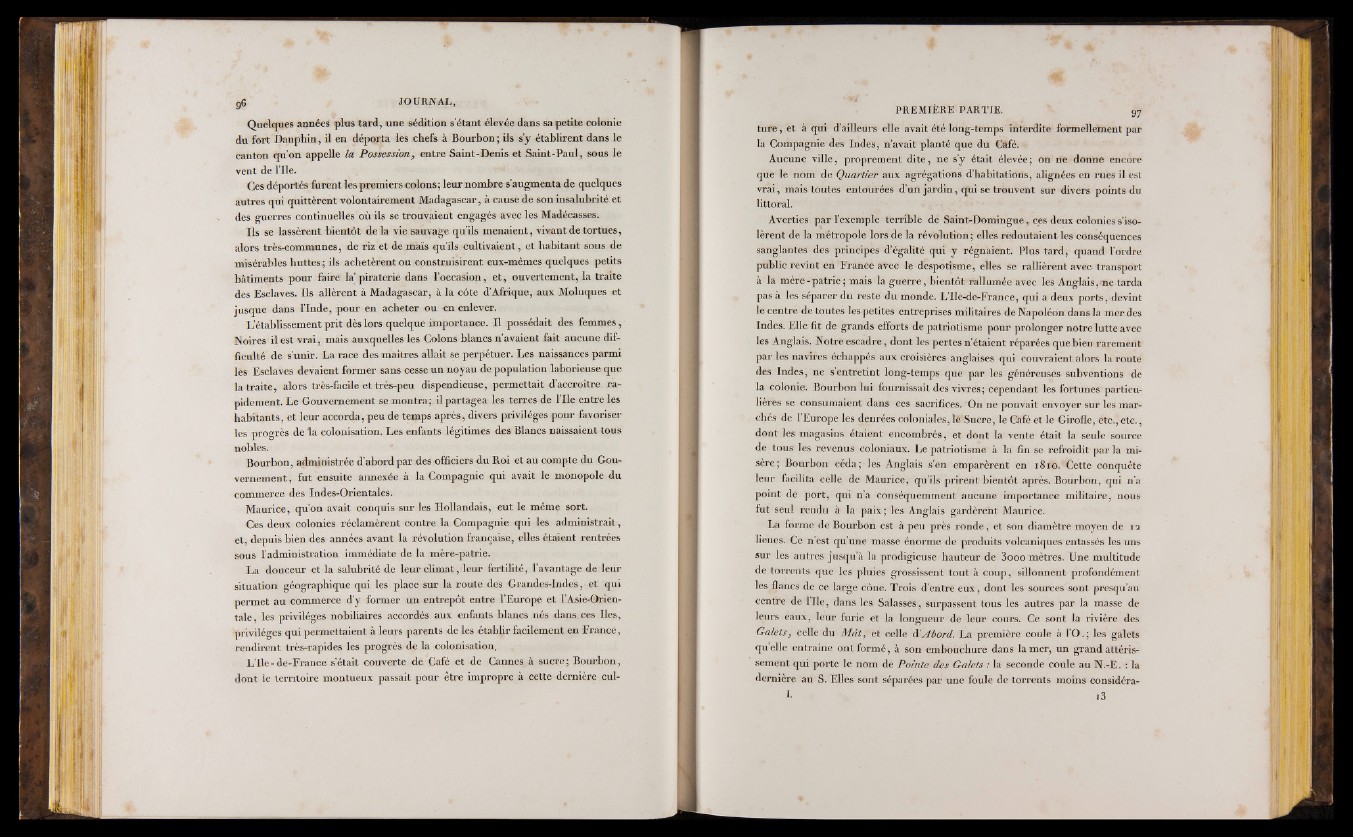
Quelques années plus tard, une sédition s'étant élevée dans sa petite colonie
du fort Dauphin, il en déporta les chefs à Bourbon ; ils s’y établirent dans le
canton qu’on appelle la Possession, entre Saint-Denis et Saint-Paul, sous le
vent de l’Ile.
Ces déportés furent les premiers colons; leur nombre s’augmenta de quelques
autres qui quittèrent volontairement Madagascar, à cause de son insalubrité et
des guerres continuelles où ils se trouvaient engagés avec les Madécasses.
Ils se lassèrent bientôt delà vie sauvage qu’ils menaient, vivant de tortues,
alors très-communes, de riz et de maïs qu’ils cultivaient, et habitant sous de
misérables huttes; ils achetèrent ou construisirent eux-mêmes quelques petits
bâtiments pour fane la'piraterie dans l’occasion, et, ouvertement, la traite
des Esclaves. Ils allèrent à Madagascar, à la côte d’Afrique, aux Moluques et
jusque dans l'Inde, pour en acheter ou en enlever.
L’établissement prit dès lors quelque importance. Il possédait des femmes,
Noires il est vrai, mais auxquelles les Colons blancs n’avaient fait aucune difficulté
de s’unir. La race des martres allait se perpétuer. Les naissances parmi
les Esclaves devaient former sans cesse un noyau de population laborieuse que
la traite, alors très-facile et très-peu dispendieuse, permettait d’accroître rapidement.
Le Gouvernement se montra; il partagea les terres de 1 Ile entre les
habitants, et leur accorda, peu de temps après, divers privilèges pour favoriser
les progrès de 'la colonisation. Les enfants légitimes des Blancs naissaient tous
nobles.
Bourbon, administrée d’abord par des officiers du Roi et au compte du Gouvernement,
fut ensuite annexée à la Compagnie qui avait le monopole du
commerce des Indes-Orientales.
Maurice, qu’on avait conquis sur les Hollandais, eut le même sort.
Ces deux colonies réclamèrent contre la Compagnie qui les administrait,
et, depuis bien des années avant la révolution française, elles étaient rentrées
sous l’administration immédiate de la mère-patrie.
La douceur et la salubrité de leur climat, leur fertilité, l’avantage de leur
situation géographique qui les place sur la route des Grandes-Indes, et qui
permet au commerce d’y former un entrepôt entre l'Europe et l’Asie-Qrien-
tale, les privilèges nobiliaires accordés aux enfants blancs nés dans ces Iles,
privilèges qui permettaient à leurs parents de les établir facilement en France,
rendirent très-rapides les progrès de la colonisation.
L’Ile-de-France s’était couverte de Café et de Cannes à sucre; Bourbon,
dont le territoire montueux passait pour être impropre à cette dernière culture,
et à qui d’ailleurs elle avait été long-temps interdite formellement par
la Compagnie des Indes, n’avait planté que du Câfé.
Aucune ville, proprement dite, ne s’y était élevée; on ne donne encore
que le nom de Quartier aux agrégations d’habitations, alignées en rués il est
vrai, mais toutes entourées d’un jardin, qui se trouvent sur divers points du
littoral.
Averties par l’exemple terrible de Saint-Domingue, ces deux colonies s’isolèrent
de la métropole lors de la révolution; elles redoutaient les conséquences
sanglantes des principes d’égalité qui y régnaient. Plus tard, quand l’ordre
public revint en France avec le despotisme, elles se rallièrent avec transport
à la mère - patrie ; mais la guerre, bientôt, rallumée avec les Anglais, ne tarda
pas à les séparer du resté du monde. L’Ile-de-France, qui a deux ports, devint
le centre de toutes les petites entreprises militaires de Napoléon dans la mer des
Indes. Elle fit de grands efforts de patriotisme pour prolonger notre lutte avec
les Anglais. Notre escadre, dont les pertes n’étaient réparées que bien rarement
par les navires échappés aux croisières anglaises qui couvraient alors la route
des Indes, ne s entretint long-temps que par les généreuses subventions de
la colonie. Bourbon lui fournissait des vivres; cependant les fortunes particulières
se consumaient dans ces sacrifices. On ne pouvait envoyer sur les marchés
de l’Europe les denrées coloniales, lé Sucre, le Café et le Girofle, etc., etc.,
dont les magasins étaient encombrés, et dont la vente était la seule source
de tous les revenus coloniaux. Le patriotisme à la fin se refroidit par la misère;
Bourbon céda; les Anglais s’en emparèrent en 18 io. "Cette conquête
leur facilita celle de Maurice, qu’ils prirent bientôt après. Bourbon, qui n’a
point de port, qui n’a conséquemment aucune importance militaire, nous
fut seul rendu à la paix; lés Anglais gardèrent Maurice.
La forme de Bourbon est à peu près ronde, et son diamètre moyen de i a
lieues. Ce n’est qu’une masse énorme de produits volcaniques entassés les uns
sur les autres jusqu’à la prodigieuse hauteur de 3ooo mètres. Une multitude
de torrents que les pluies grossissent tout à coup, sillonnent profondément
les fjancs de ce large cône. Trois d’entre eux, dont les sources sont presqu’au
centre de 1 Ile, dans les Salasses, surpassent tous les autres par la masse de
leurs eaux, leur furie et la longueur de leur cours. Ce sont la rivière des
Galets, celle An Mât, et celle d’Abord. La première coule à l’O . ; les galets
qu’elle entraîne ont formé, à son embouchure dans la mer, un grand attéris-
sement qui porte le nom de Pointe des Galets : la seconde coule au N.-È. : la
dernière au S. Elles sont séparées par une foule de torrents moins considéra-
I- i3