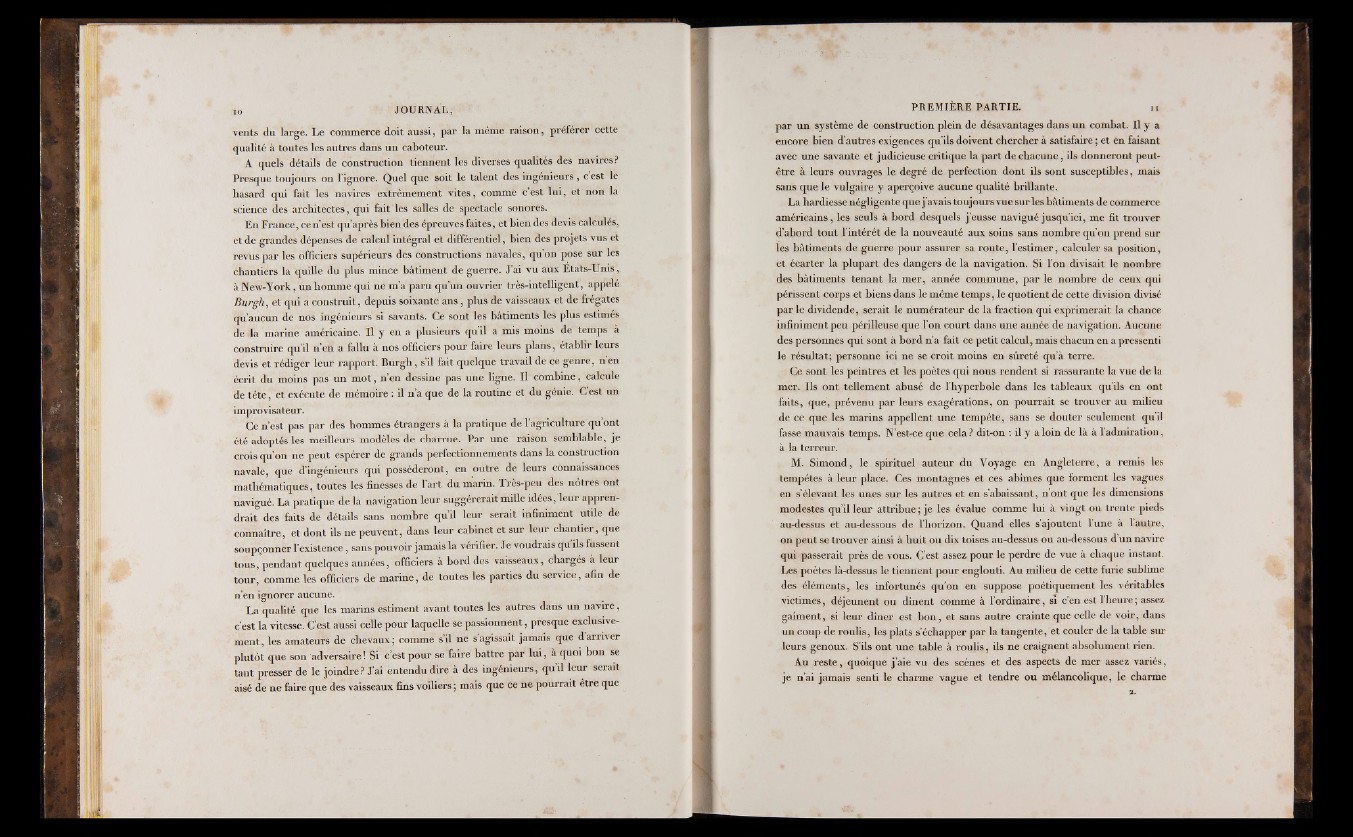
vents du large. Le commerce doit aussi, par la même raison, préférer cette
qualité à toutes les autres dans un caboteur.
A quels détails de construction tiennent les diverses qualités des navires?
Presque toujours on l’ignore. Quel que soit le talent des ingénieurs, c est le
hasard qui fait les navires extrêmement vites, comme Cest lui, et non la
science des architectes, qui fait les salles de spectacle sonores.
En France, ce n’est qu’après bien des épreuves faites, et bien des devis calculés,
et de grandes dépenses de calcul intégral et différentiel, bien des projets vus et
revus par les officiers supérieurs des constructions navales, qu’on pose sur les
chantiers la quille du plus mince bâtiment de guerre. J’ai vu aux Etats-Unis,
à New-York, un homme qui ne m’a paru qu’un ouvrier très-intelligent, appelé
Burghj et qui a construit, depuis soixante ans, plus de vaisseaux et de frégates
qu’aucun de nos ingénieurs si savants. Ce sont les bâtiments les plus estimés
de la marine américaine. Il y en a plusieurs quil a mis moins de temps à
construire qu’il n’en a fallu à nos officiers pour faire leurs plans, établir leurs
devis et rédiger leur rapport. Burgh, s’il fait quelque travail de ce genre, n’en
écrit du moins pas un mot, n’en dessine pas une ligne. Il combine, calcule
de tête, et exécute de mémoire : il n’a que de la routine et du génie. Cest un
improvisateur.
Ce n’est pas par des hommes étrangers à la pratique de l’agriculture qu’ont
été adoptés les meilleurs modèles de charrue. Par une raison semblable, je
crois qu’on ne peut espérer de grands perfectionnements dans la construction
navale, que d’ingénieurs qui posséderont, en outre de leurs connaissances
mathématiques, toutes les finesses de l’art du marin. Très-peu des nôtres ont
navigué. La pratique de la navigation leur suggérerait mille idées, leur apprendrait
des faits de détails sans nombre qu’il leur serait infiniment utile de
connaître, et dont ils ne peuvent, dans leur cabinet et sur leur chantier, que
soupçonner l’existence, sans pouvoir jamais la vérifier. Je voudrais qu ils fussent
tous, pendant, quelques années, officiers à bord des vaisseaux, chargés à leur
tour, comme les officiers de marine, de toutes les parties du service, afin de
n’en ignorer aucune.
La qualité que les marins estiment avant toutes les autres dans un navire,
c’est la vitesse. C’est aussi celle pour laquelle se passionnent, presque exclusivement,
les amateurs de chevaux; comme s’il ne s’agissait jamais que darriver
plutôt que son adversaire ! Si c’est pour se faire battre par lui, à quoi bon se
tant presser de le joindre? J’ai entendu dire à des ingénieurs, qu’il leur serait
aisé de ne faire que des vaisseaux fins voiliers ; mais que ce ne pourrait être que
par un système de construction plein de désavantages dans un combat. Il y a
encore bien d’autres exigences qu’ils doivent chercher à satisfaire ; et én faisant
avec une savante et judicieuse critique la part de chacune, ils donneront peut-
être à leurs ouvrages le degré de perfection dont ils sont susceptibles, mais
sans que le vulgaire y aperçoive aucune qualité brillante.
La hardiesse négligente que j’avais toujours vue sur les bâtiments de commerce
américains, les seuls à bord desquels j’eusse navigué jusqu’ici, me fit trouver
d’abord tout l’intérêt de la nouveauté aux soins sans nombre qu’on prend sur
les bâtiments de guerre pour assurer sa route, l’estimer, calculer sa position,
et écarter la plupart des dangers de la navigation. Si l’on divisait le nombre
des bâtiments tenant la mer, année commune, par le nombre de ceux qui
périssent corps et biens dans le même temps, le quotient de cette division divisé
par le dividende, serait le numérateur de la fraction qui exprimerait la chance
infiniment peu périlleuse que l’on court dans une année de navigation. Aucune
des personnes qui sont à bord n’a fait ce petit calcul, mais chacun en a pressenti
le résultat; personne ici ne se croit moins en sûreté qu’à terre.
Ce sont les peintres et les poètes qui nous rendent si rassurante la vue de la
mer. Us ont tellement abusé de l’hyperbole dans les tableaux qu’ils en ont
faits, que, prévenu par leurs exagérations, on pourrait se trouver au milieu
de ce que les marins appellent une tempête, sans se douter seulement qu’il
fasse mauvais temps. N’est-ce que cela ? dit-on : il y a loin de là à l’admiration,
à la terreur.
M. Simond, le spirituel auteur du Voyage en Angleterre, a remis les
tempêtes à leur place. Ces montagnes et ces abîmes que forment les vagues
en s’élevant les unes sur les autres et en s’abaissant, n’ont que les dimensions
modestes qu’il leur attribue; je les évalue comme lui à vingt ou trente pieds
au-dessus et au-dessous de l’horizon. Quand elles s’ajoutent l’une à l’autre,
on peut se trouver ainsi à huit ou dix toises au-dessus ou au-dessous d’un navire
qui passerait près de vous. C’est assez pour le perdre de vue à chaque instant.
Les poètes là-dessus le tiennent pour englouti. Au milieu de cette furie sublime
des éléments, les infortunés qu’on en suppose poétiquement les véritables
victimes, déjeunent ou dînent comme à l’ordinaire, si c’en est l’heure ; assez
gaîment, si leur dîner est bon, et sans autre crainte que celle de voir, dans
un coup de roulis, les plats s’échapper par la tangente, et couler de la table sur
leurs genoux. S’ils ont une table à roulis, ils ne craignent absolument rien.
Au reste, quoique j’aie vu des scènes et des aspects de mer assez variés,
je n’ai jamais senti le charme vague et tendre ou mélancolique, le charme