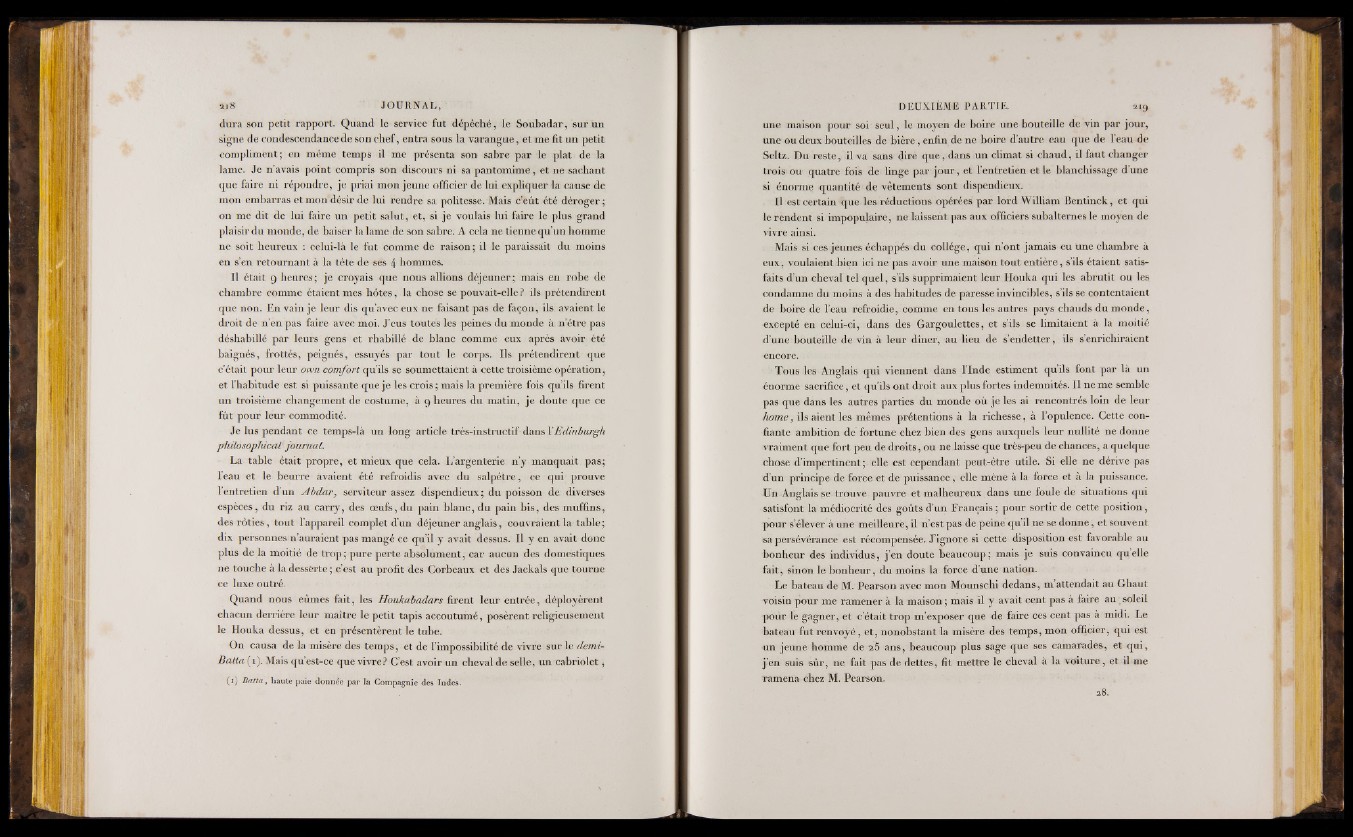
dura son petit rapport. Quand le service fut dépêché, le Soubadar, sur un
signe de condescendance de son chef, entra sous la varangue, et me fit un petit
compliment; en même temps il me présenta son sabre par le plat de la
lame. Je n’avais point compris son discours ni sa pantomime, et ne sachant
que faire ni répondre, je priai mon jeune officier de lui expliquer la cause de
mon embarras et mon désir de lui rendre sa politesse. Mais c’eût été déroger;
on me dit de lui faire un petit salut, et, si je voulais lui faire le plus grand
plaisir du monde, de baiser la lame de son sabre. A cela ne tienne qu’un homme
ne soit heureux : celui-là le fut comme de raison; il le paraissait du moins
en s’en retournant à la tête de ses 4 hommes.
Il était 9 heures; je croyais que nous allions déjeuner; mais en robe de
chambre comme étaient mes hôtes, la chose se pouvait-elle ? ils prétendirent
que non. En vain je leur dis qu’avec eux ne faisant pas de façon, ils avaient le
droit de n’en pas faire avec moi. J’eus toutes les peines du monde à n’être pas
déshabillé par leurs gens et rhabillé de blanc comme eux après avoir été
baignés, frottés, peignés, essuyés par tout le corps. Ils prétendirent que
c’était pour leur own comfort qu’ils se soumettaient à cette troisième opération,
et l’habitude est si puissante que je les crois; mais la première fois qu’ils firent
un troisième changement de costume, à 9 heures du matin, je doute que ce
fût pour leur commodité.
Je lus pendant ce temps-là un long article très-instructif dans XEdinburgh
philosophical journal.
La table était propre, et mieux que cela. L ’argenterie n’y manquait pas;
l’eau et le beurre avaient été refroidis avec du salpêtre, ce qui prouve
l’entretien d’un Abdar, serviteur assez dispendieux; du poisson de diverses
espèces, du riz au carry, des oeufs, du pain blanc, du pain bis, des muffins,
des rôties, tout l’appareil complet d’un déjeuner anglais, couvraient la table ;
dix personnes n’auraient pas mangé ce qu’il y avait dessus. Il y en avait donc
plus de la moitié de trop; pure perte absolument, car aucun des domestiques
ne touche à la desserte ; c’est au profit des Corbeaux et des Jackals que tourne
ce luxe outré.
Quand nous eûmes fait, les Houkabadars firent leur entrée, déployèrent
chacun derrière leur maître le petit tapis accoutumé, posèrent religieusement
le Houka dessus, et en présentèrent le tube.
On causa de la misère des temps, et de l’impossibilité de vivre sur le demi-
Batta (1). Mais qu’est-ce que vivre? C’est avoir un cheval de selle, un cabriolet,
(1) Batta, haute paie donnée par la Compagnie des Indes.
une maison pour soi seul, le moyen de boire une bouteille de vin par jour,
une ou deux bouteilles de bière, enfin de ne boire d’autre eau que de l’eau de
Seltz. Du reste, il va sans dire que, dans un climat si chaud, il faut changer
trois ou quatre fois de linge par jo u r , et l’entretien et le blanchissage d’une
si énorme quantité de vêtements sont dispendieux.
Il est certain que les réductions opérées par lord William Bentinck, et qui
le rendent si impopulaire, ne laissent pas aux officiers subalternes le moyen de
vivre ainsi.
Mais si ces jeunes échappés du collège, qui n’ont jamais eu une chambre à
eux, voulaient bien ici ne pas avoir une maison tout entière, s’ils étaient satisfaits
d’un cheval tel quel, s’ils supprimaient leur Houka qui les abrutit ou les
condamne du moins à des habitudes de paresse invincibles, s’ils se contentaient
de boire de l’eau refroidie, comme en tous les autres pays chauds du monde,
excepté en celui-ci, dans des Gargoulettes, et s’ils se limitaient à la moitié
d’une bouteille de vin à leur dîner, au lieu de s’endetter, ils s’enrichiraient
encore.
Tous les Anglais qui viennent dans l’Inde estiment qu’ils font par là un
énorme sacrifice, et qu’ils ont droit aux plus fortes indemnités. Il ne me semble
pas que dans les autres parties du monde où je les ai rencontrés loin de leur
home y ils aient les mêmes prétentions à la richesse, à l’opulence. Cette confiante
ambition de fortune chez bien des gens auxquels leur nulbté ne donne
vraiment que fort peu de droits, ou ne laisse que très-peu de chances, a quelque
chose d’impertinent ; elle est cependant peut-être utile. Si elle ne dérive pa6
d’un principe de force et de puissance, elle mène à la force et à la puissance.
Un Anglais se trouve pauvre et malheureux dans une foule de situations qui
satisfont la médiocrité des goûts d’un Français ; pour sortir de cette position,
pour s’élever à une meilleure, il n’est pas de peine qu’il ne se donne, et souvent
sa persévérance est récompensée. J’ignore si cette disposition est favorable au
bonheur des individus, j ’en doute beaucoup; mais je suis convaincu quelle
fait, sinon le bonheur, du moins la force d’une nation.
Le bateau de M. Pearson avec mon Mounschi dedans, m’attendait au Ghaut
voisin pour me ramener à la maison ; mais il y avait cent pas à faire au soleil
pour le gagner, et c’était trop m’exposer que de faire ces cent pas à midi. Le
bateau fut renvoyé, et, nonobstant la misère des temps, mon officier, qui est
un jeune homme de 2.5 ans, beaucoup plus sage que ses camarades, et qui,
j ’en suis sûr, ne fait pas de dettes, fit mettre le cheval à la voiture, et il me
Tamena chez M. Pearson.