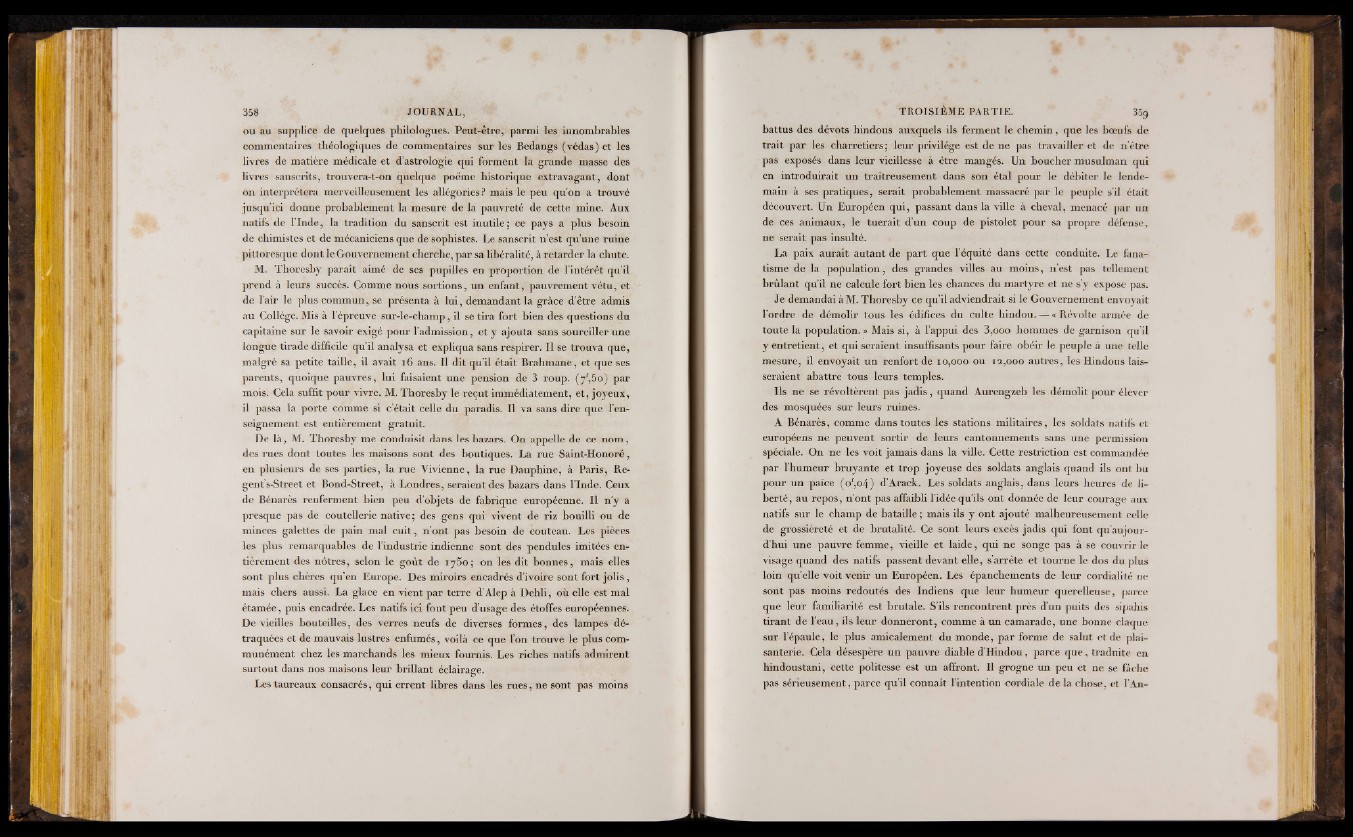
ou au supplice de quelques philologues. Peut-être, parmi les iunombrables
commentaires théologiques de commentaires sur les Bedangs (védas) et les
livres de matière médicale et d’astrologie qui forment la grande masse des
livres sanscrits, trouvera-t-on quelque poème historique extravagant, dont
on interprétera merveilleusement les allégories? mais le peu qu’on a trouvé
jusqu’ici donne probablement la mesure de la pauvreté de cette mine. Aux
natifs de l’Inde, la tradition du sanscrit est inutile; ce pays a plus besoin
de chimistes et de mécaniciens que de sophistes. Le sanscrit n’est qu’une ruine
pittoresque dont le Gouvernement cherche, par sa libéralité, à retarder la chute.
M. Thoresby paraît aimé de ses pupilles en proportion de l’intérêt qu’il
prend à leurs succès. Comme nous sortions, un enfant, pauvrement vêtu, et
de l ’air le plus commun, se présenta à lu i, demandant la grâce d’être admis
au Collège. Mis à l’épreuve sur-le-champ, il se tira fort bien des questions du
capitaine sur le savoir exigé pour l’admission, et y ajouta sans sourciller une
longue tirade difficile qu’il analysa et expliqua sans respirer. Il se trouva que,
malgré sa petite taille, il avait 16 ans. Il dit qu’il était Brahmane, et que ses
parents, quoique pauvres, lui faisaient une pension de 3 roup. (7f,5o) par
mois. Cela suffit pour vivre. M. Thoresby le reçut immédiatement, et, joyeux,
il passa la porte comme si c’était celle du paradis. Il va sans dire que l’enseignement
est entièrement gratuit.
De là , M. Thoresby me conduisit dans les bazars. On appelle de ce nom,
des rues dont toutes les maisons sont des boutiques. La rue Saint-Honoré,
en plusieurs de ses parties, la rue Vivienne, la rue Dauphine, à Paris, Be-
gent’s-Street et Bond-Street, à Londres, seraient des bazars dans l’Inde. Ceux
de Bénarès renferment bien peu d’objets de fabrique européenne. Il n’y a
presque pas de coutellerie native; des gens qui vivent de riz bouilli ou de
minces galettes de pain mal cu it, n’ont, pas besoin de couteau. Les pièces
les plus remarquables de l ’industrie indienne sont des pendules imitées entièrement
des nôtres, selon le goût de 1750; on les dit bonnes, mais elles
sont plus chères qu’en Europe. Des miroirs encadrés d’ivoire sont fort jo lis ,
mais chers aussi. La glace en vient par terre d’Alep à Dehli, où elle est mal
étamée, puis encadrée. Les natifs ici font peu d’usage des étoffes européennes.
De vieilles bouteilles, des verres neufs de diverses formes, des lampes détraquées
et de mauvais lustres enfumés, voilà ce que l’on trouve le plus communément
chez les marchands les mieux fournis. Les riches natifs admirent
surtout dans nos maisons leur brillant éclairage.
Les taureaux consacrés, qui errent libres dans les rues, ne sont pas moins
battus des dévots hindous auxquels ils ferment le chemin, que les boeufs de
trait par les charretiers; leur privilège est de ne pas travailler et de n’être
pas exposés dans leur vieillesse à être mangés. Un boucher musulman qui
en introduirait un traîtreusement dans son étal pour le débiter le lendemain
à ses pratiques, serait probablement massacré par le peuple s’il était
découvert. Un Européen qui, passant dans la ville à cheval, menacé par un
de ces animaux, le tuerait d’un coup de pistolet pour sa propre défense,
ne serait pas insulté.
La paix aurait autant de part que l’équité dans cette conduite. Le fanatisme
de la population, des grandes villes au moins, n’est pas tellement
brûlant qu’il ne calcule fort bien les chances du martyre et ne s’y expose pas.
Je demandai à M. Thoresby ce qu’il adviendrait si le Gouvernement envoyait
l’ordre de démolir tous les édifices du culte hindou. — « Révolte armée de
toute la population.» Mais si, à l’appui des 3,000 hommes de garnison qu’il
y entretient, et qui seraient insuffisants pour faire obéir le peuple à une telle
mesure, il envoyait un renfort de 10,000 ou 12,000 autres, les Hindous laisseraient
abattre tous leurs temples.
Us ne se révoltèrent pas jad is, quand Aurengzeb les démolit pour élever
des mosquées sur leurs ruines.
A Bénarès, comme dans toutes les stations militaires, les soldats natifs et
européens ne peuvent sortir de leurs cantonnements sans une permission
spéciale. On ne les voit jamais dans la ville. Cette restriction est commandée
par l’humeur bruyante et trop joyeuse des soldats anglais quand ils ont bu
pour un païce (of,o4 ) d’Araek. Les soldats anglais, dans leurs heures de liberté,
au repos , n’ont pas affaibli l’idée qu’ils ont donnée de leur courage aux
natifs sur le champ de bataille ; mais ils y ont ajouté malheureusement celle
de grossièreté et de brutalité. Ce sont leurs excès jadis qui font qu’aujourd’hui
une pauvre femme, vieille et laide, qui ne songe pas à se couvrir le
visage quand des natifs passent devant elle, s’arrête et tourne le dos du plus
loin qu elle voit venir un Européen. Les épanchements de leur cordialité ne
sont pas moins redoutés des Indiens que leur humeur querelleuse, parce
que leur familiarité est brutale. S’ils rencontrent près d’un puits des sipahis
tirant de l’eau, ils leur donneront, comme à un camarade, une bonne claque
sur l’épaule, le plus amicalement du monde, par forme de salut et de plaisanterie.
Cela désespère un pauvre diable d’Hindou, parce q u e , traduite en
hindoustani, cette politesse est un affront. Il grogne un peu et ne se fâche
pas sérieusement, parce qu’il connaît l’intention cordiale delà chose, et l’An