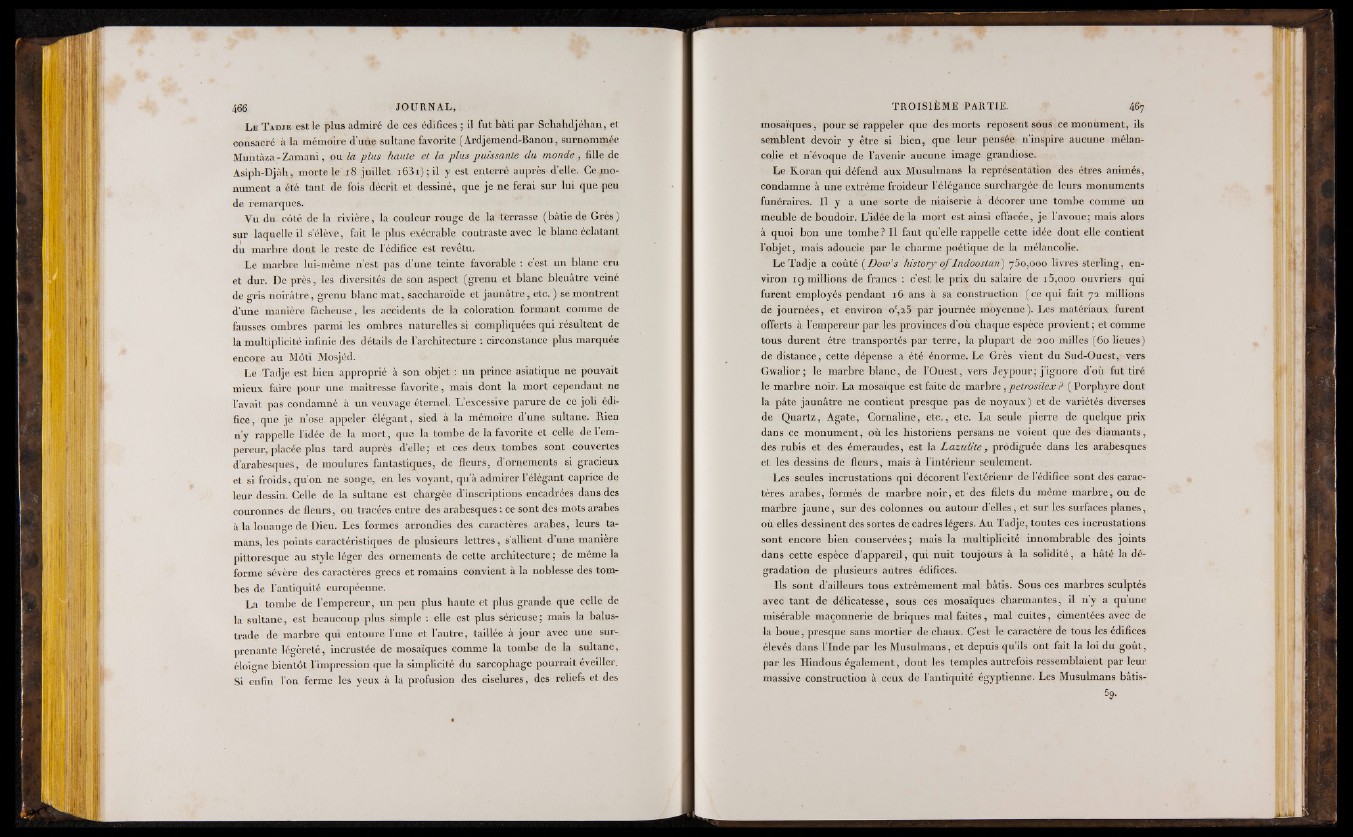
L e T a d j e est le plus admiré de ces édifices ; il fut bâti par Schahdjéhan, et
consacré à la mémoire d’une sultane favorite (Ardjemend-Banou, surnommée
Muntâza - Zamani, ou la plus haute et la plus puissante du monde, fille de
Asiph-Djâh, morte le 18 juillet x63 i) ; il y est enterré auprès d’elle. Ce.mo-
nument a été tant de fois décrit et dessiné, que je ne ferai sur lui que peu
de remarques.
Vu du côté de la rivière, la couleur rouge de la terrasse (bâtie de Grès)
sur laquelle il s’élève, fait le plus exécrable contraste avec le blanc éclatant
du marbre dont le reste de l’édifice est revêtu.
Le marbre lui-même n’est pas d’une teinte favorable : c’est un blanc cru
et dur. De près, les diversités de son aspect (grenu et blanc bleuâtre veiné
de gris noirâtre, grenu blanc mat, saccharoïde et jaunâtre, etc. ) se montrent
d'une manière fâcheuse, les accidents de la coloration formant, comme de
fausses ombres parmi les ombres naturelles si compliquées qui résultent de
la multiplicité infinie des détails de l’architecture : circonstance plus marquée
encore au Môti Mosjéd.
Le Tadje est bien approprié à son objet : un prince asiatique ne pouvait
mieux faire pour une maîtresse favorite, mais dont la mort cependant ne
l ’avait pas condamné à un veuvage éternel. L ’excessive parure de ce joli édifice,
que je n’ose appeler élégant, sied à la mémoire dune sultane. Rien
n’y rappelle l’idée de la mo rt, que la tombe de la favorite et celle de 1 empereur,
placée plus tard auprès d’elle ; et ces deux tombes sont couvertes
d’arabesques, de moulures fantastiques, de fleurs, d’ornements si gracieux
et si froids, qu’on ne songe, en les voyant, qu’à admirer l ’élégant caprice de
leur dessin. Celle de la sultane est chargée d’inscriptions encadrées dans des
couronnes de fleurs, ou tracées entre des arabesques : ce sont des mots arabes
à la louange de Dieu. Les formes arrondies des caractères arabes, leurs ta-
mans, les points caractéristiques de plusieurs lettres, s’allient d’une manière
pittoresque au style léger des ornements de cette architecture ; de même la
forme sévère des caractères grecs et romains convient à la noblesse des tombes
de l'antiquité européenne.
La tombe de l’empereur, un peu plus haute et plus grande que celle de
la sultane, est beaucoup plus simple : elle est plus sérieuse; mais la balustrade
de marbre qui entoure l ’une et l’autre, taillée à jour avec une surprenante
légèreté, incrustée de mosaïques comme la tombe de la sultane,
éloigne bientôt l’impression que la simplicité du sarcophage pourrait éveiller.
Si enfin l ’on ferme les yeux à la profusion des ciselures, des reliefs et des
mosaïques, pour sé rappeler que des morts reposent sôus ce monument, ils
semblent devoir y être si bien, que leur pensée n’inspire aucune mélancolie
et n’évoque de l’avenir aucune image grandiose.
Le Koran qui défend aux Musulmans la représentation des êtres animés,
condamne à une extrême froideur l’élégance surchargée de leurs monuments
funéraires. Il y a une sorte de niaiserie à décorer une tombe comme un
meuble de boudoir. L ’idée de la mort est ainsi effacée, je l’avoue; mais alors
à quoi bon une tombe ? Il faut qu’elle rappelle cette idée dont elle contient
l’objet, mais adoucie par le charme poétique de la mélancolie.
Le Tadje a coûté {Dow’s historp o f Indoostan) 760,000 livres sterling, environ
19 millions de francs : c’est le prix du salaire de i 5,ooo ouvriers qui
furent employés pendant 16 ans à sa construction* ( ce qui fait 72 millions
dé journées, et environ of,25 par journée moyenne). Les matériaux furent
offerts à l’empereur par les provinces d’où chaque espèce provient ; et comme
tous durent être transportés par terre, la plupart de 200 milles (60 lieues)
de distance, cette dépense a été énorme. Le Grès vient du Sud-Ouest, vers
Gwalior; le marbre blanc, de l’Ouest, vers Jeypour; j ’ignore d’où fut tiré
le marbre noir. La mosaïque est faite de marbre , petrosilex ? ( Porphyre dont
la pâte jaunâtre ne contient presque pas de noyaux ) et de variétés diverses
de Quartz, Agate, Cornaline, etc., etc. La seule pierre de quelque prix
dans ce monument, où les historiens persans ne voient que des diamants,
des rubis et des émeraudes, est la Lazulite, prodiguée dans les arabesques
et les dessins de fleurs, mais à l'intérieur seulement.
Les seules incrustations qui décorent l’extérieur de l ’édifice sont des caractères
arabes, formés de marbre noir, et des filets du même marbre, ou de
marbre jaune, sur des colonnes ou autour d’elles, et sur les surfaces planes,
où elles dessinent des sortes de cadres légers. Au Tadje, toutes ces incrustations
sont encore bien conservées; mais la multiplicité innombrable des joints
dans cette espèce d’appareil, qui nuit toujours à la solidité, a hâté la dégradation
de plusieurs autres édifices.
Ils sont d’ailleurs tous extrêmement mal bâtis. Sous ces marbres sculptés
avec tant de délicatesse, sous ces mosaïques charmantes, il n’y a qu’une
misérable maçonnerie de briques mal faites, mal cuites, cimentées avec de
la boue, presque sans mortier de chaux. C’est le caractère de tous les édifices
élevés dans l’Inde par les Musulmans, et depuis qu’ils ont fait la loi du goût,
par les Hindous également, dont les temples autrefois ressemblaient par leur
massive construction à ceux de l’antiquité égyptienne. Les Musulmans bâtis-
Sg.