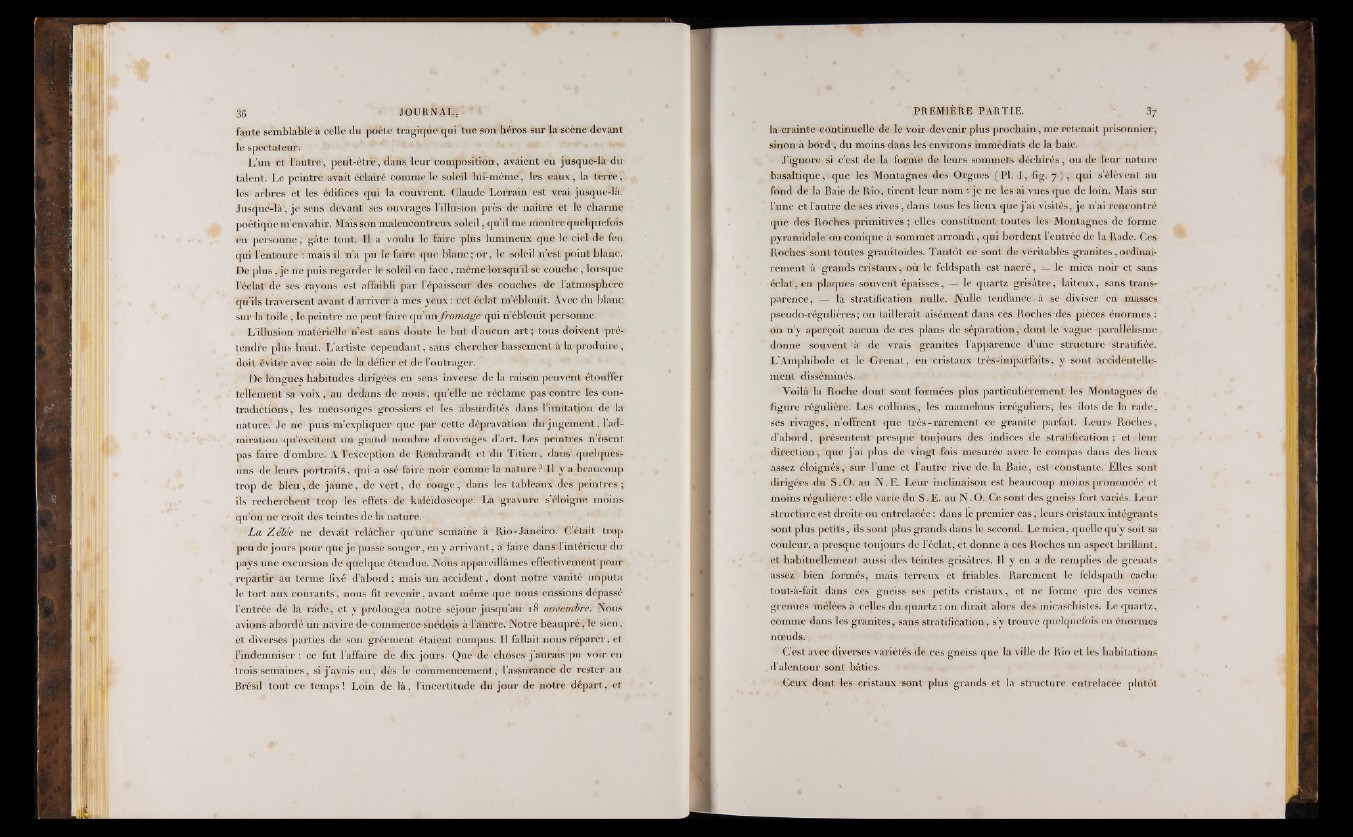
faute semblable à celle du poète tragique qui tue son héros sur la scène devant
le spectateur.
L’un et l autre, peut-être, dans leur composition, avaient eu jusque-là du
talent. Le peintre avait éclairé comme le soleil lui-mêmé, les eaux, la terre,
les arbres et les édifices qui la couvrent. Claude Lorrain est vrai jusque-là.
Jusque-là , je sens devant Ses ouvrages l’illusion près de naître et le charme
poétique m’envahir. Mais son malencontreux soleil, qu’il me montre quelquefois
en personne, gâte tout. Il a voulu le faire plus lumineux que le ciel de feu
qui l’entoure : mais il n’a pu le faire que blanc; or, le soleil n’est point blanc.
De plus, je ne puis regarder le solèil en face, même lorsqu’il se couche, lorsque
l’éclat de ses rayons est affaibli par l’épaisseur des couches de l’atmosphère
qu’ils traversent avant d’arriver à mes yèux : cet éclat m'éblouit. Avec du blanc
sur la toile , le peintre ne peut faire qu’un fromage qui n’éblouit personne.
L’illusion matérielle n ést sans doute le but d’aucun art ; tous doivent prétendre
plus haut. L’artiste cependant, salis chercher bassement à la produire,
doit éviter avec soin de la défier et de l'outrager.
De longues habitudes dirigées en sens inverse de la raison peuvent étouffer
tellement sa voix, au dedans de nous, qu’elle ne réclame pas contre les contradictions,
les mensonges grossiers et. les absurdités dans l’imitation de la
nature. Je ne puis m’expliquer que par cette dépravation du jugement, l’admiration
qu’excitent un grand nombre d’ouvrages d’art. Les peintres n’osent
pas faire d’ombre. A l’exception de Rembrandt et du Titien , dans quelques-
uns de leurs pôrtraitâ, qui a osé faire noir comme la nature? H y a beaucoup
trop de bleu, de jaune, de vert, de rouge, dans les tableaux des peintres ;
ils recherchent trop les effets de kaléidoscope. La gravure s’éloigne moins
qu’on ne croit des teintes de la nature.
La Zélée ne devait relâcher qu’une semaine à Rio - Janeiro. C ’était trop
peu de jours pour qùe je pusse songer, en y arrivant, à faire danS l ’intérieur du
pays une excursion de quelque étendue. Nous appareillâmes effectivement pour
repartir au terme fixé d’abord; mais Un accident, dont notre vanité imputa
le tort aux courants’, nous fit revenir, avant mêmè que nous eussions dépassé
l’entrée dé la rade, et y prolongea notre séjour jusqu’au 18 novembre. Nous
avions abordé un navire de*commerce suédois à TanCre/Notre beaupré, le sien,
et diverses parties de son gréement étaient rompus. Il fallait nous réparer, et
l’indemniser : ce fut l’affaire de dix joürs. Que de choses j’aurais pu voir en
trois semaines, si j ’avais eu, dès le commencement, l’assurance de rester au
Brésil tout ce temps ! Loin de là , l’incertitude du jour de notre départ, et
la crainte continuelle de le voir devenir plus prochain, me retenait prisonnier,
sinon à bord , du moins dans les environs immédiats de la baie.
J’ignore si c’est de la forme de leurs sommets déchirés, ou de leur nature
basaltique^ que les- Montagnes des Orgues (Pl. I, fig. 7) ; qui s’élèvent au
fond de la Baie de Rio, tirent leur nom : je ne les ai vues que de loin. Mais sur
l’une et l’autre de ses rives, dans tous les lieux que j’ai visités, je n’ai rencontré
que des Roches primitives ; elles constituent toutes les Montagnes de forme
pyramidale ou conique à sommet arrondi, qui bordent l’entrée de la Rade. Ces
Roches sont toutes granitoïdes. Tantôt ce sont de véritables granites, ordinairement
à grands Cristaux, où le feldspath est nacré , le mica noir et sans
éclat, en plaques souvent épaisses ^ j l l e quartz grisâtre, laiteux, sans transparence
, — la stratification nulle. Nulle tendance à se diviser en masses
pseudo-régulières; on taillerait aisément dans ces Roches des pièces énormes :
011 n’y aperçoit aucun de -ces plans de séparation, dont le vague parallélisme
donne souvent à de vrais granites l’apparence d’une structure stratifiée.
L’Amphibole et le Grenat, en cristaux très-imparfaits, y sont accidentellement
disséminés. >v
Voilà la Roche dont sont formées plus particulièrement les Montagnes de
figure régulière. Les collines, les mamelons irréguliers, les ilôts de la rade,
ses rivages, n’offrent que très - rarement ce granite parfait. Leurs Roches,
d’abord, présentent presque toujours des indices de stratification ; et leur
direction , que j ’ai plus de vingt fois mesurée avec le compas dans des lieux
assez éloignés, sur l’une et l’autre rive de la Baie, est constante. Elles sont
dirigées du S . O. au N ; E. Leur inclinaison est beaucoup moins prononcée et
moins régulière : elle varie du S . E. au N . O. Ce sont des gneiss fort variés. Leur
structure est droite ou entrelacée : dans le premier cas, leurs cristaux intégrants
sont plus petits, ils sont plus grands dans le second. Le mica, quelle qu’y soit sa
couleur, a presque toujours de l’éclat, et donne à ces Roches un aspect brillant,
et habituellement aussi des teintes grisâtres. Il y en a de remplies de grenats
assez bien formés, mais terreux et friables. Rarement le feldspath cache
tout-à-fait dans ces gneiss ses petits cristaux, et ne forme que des veines
grenues mêlées à celles du quartz : on dirait alors des micaschistes. Le quartz,
comme dans les granites, sans stratification , s’y trouve quelquefois en énormes
noeuds.
C ést avec diverses variétés de. ces gneiss que la ville de Rio et les habitations
d’alentour sont bâties.
Ceux dont les cristaux sont plus grands et la structure entrelacée plutôt