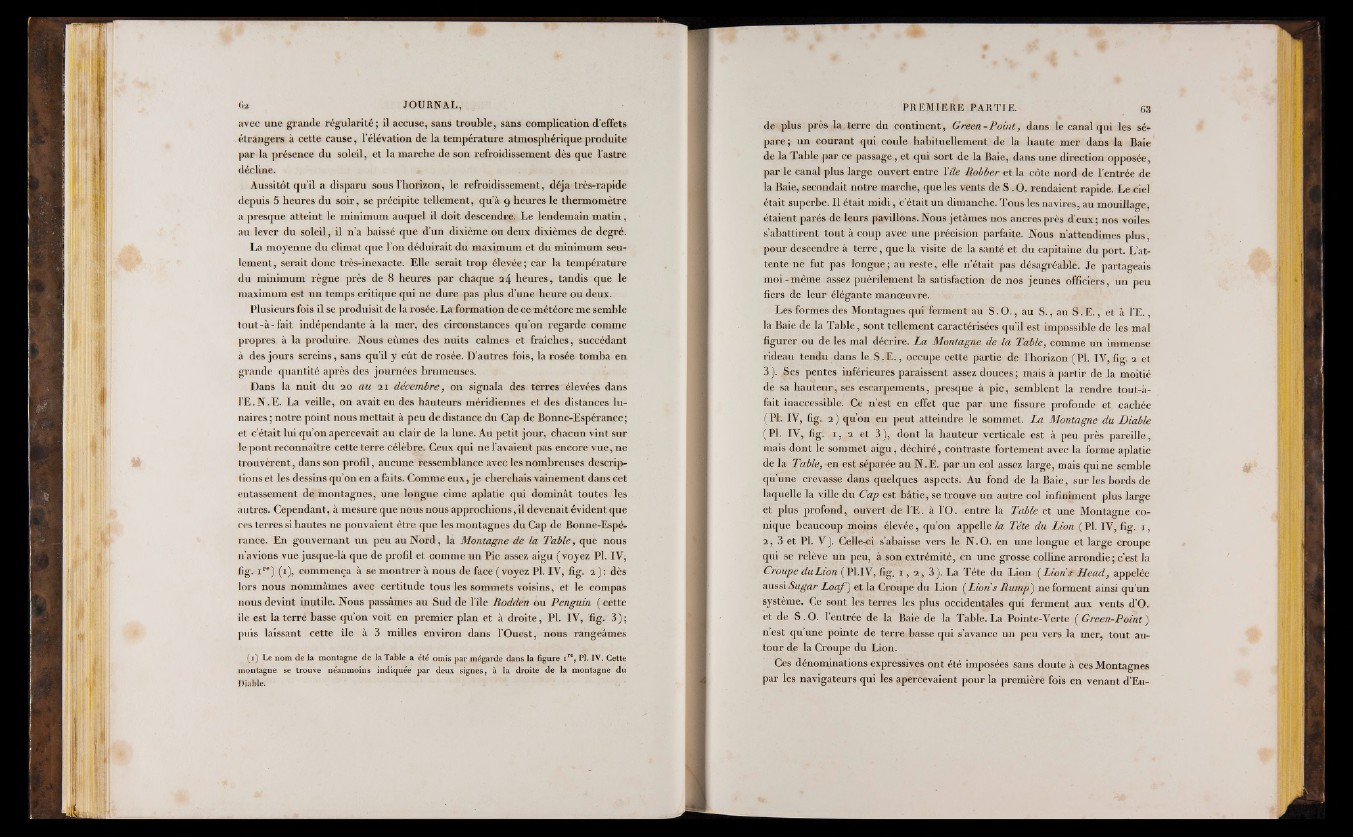
avec une grande régularité ; il accuse, sans trouble, sans complication d’effets
étrangers à cette cause, l’élévation de la température atmosphérique produite
par la présence du soleil, et la marche de son refroidissement dès que l'astre
décline.
Aussitôt qu’il a disparu sous l’horizon, le refroidissement, déjà très-rapide
depuis 5 heures du soir, se précipite tellement, qu’à 9 heures le thermomètre
a presque atteint le minimum auquel il doit descendre. Le lendemain matin,
au lever du soleil, il n’a baissé que d'un dixième ou deux dixièmes de degré.
La moyenne du climat que l’on déduirait du maximum et du minimum seulement,
serait donc très-inexacte. Elle serait trop élevée; car la température
du minimum règne près de 8 heures par chaque 24 heures, tandis que le
maximum est un temps critique qui ne dure pas plus d’une heure ou deux.
Plusieurs fois il se produisit de la rosée. La formation de ce météore me semble
tout-à-fait indépendante à la mer, des circonstances qu’on regarde comme
propres à la produire. Nous eûmes des nuits calmes et fraîches, succédant
à des jours sereins, sans qu’il y eût de rosée. D’autres fois, la rosée tomba en
grande quantité après des journées brumeuses.
Dans la nuit du 20 au 21 décembre, on signala des terres élevées dans
l’E . N . E. La veille, on avait eu des hauteurs méridiennes et des distances lunaires
; notre point nous mettait à peu de distance du Cap de Bonne-Espérance;
et c’était lui qu’on apercevait au clair de la lune. Au petit jour, chacun vint sur
le pont reconnaître cette terre célèbre. Ceux qui ne l’avaient pas encore vue, ne
trouvèrent, dans son profil, aucune ressemblance avec les nombreuses descriptions
et les dessins qu’on en a faits. Comme eux, je cherchais vainement dans cet
entassement de montagnes, une longue cime aplatie qui dominât toutes les
autres. Cependant, à mesure que nous nous approchions, il devenait évident que
ces terres si hautes ne pouvaient être que les montagnes du Cap de Bonne-Espérance.
En gouvernant un peu au Nord, la Montagne de la Table, que nous
n’avions vue jusque-là que de profil et. comme un Pic assez aigu (voyez Pl. IV,
fig. i re) (1), commença à se montrer à nous de face ( voyez Pl. IV, fig. 2 ) : dès
lors nous nommâmes avec certitude tous les sommets voisins, et le compas
nous devint mutile. Nous passâmes au Sud de l’île Rodden ou Penguin. ( cette
île est la terre basse qu’on voit en premier plan et à droite, Pl. IV, fig. 3) ;
puis laissant cette île à 3 milles environ dans l’Ouest, nous rangeâmes
(1) Le nom de la montagne de la Table a été omis par mégarde dans la figure i re, Pl. IV. Cette
montagne se trouve néanmoins indiquée par deux signes, à la droite de la montagne du
Diable.
de plus près la; terre du continent, Green - Point, dans le canal qui les sépare
; un courant qui coule habituellement de la haute mer dans la Baie
de la Table par ce passage, et qui sort de la Baie, dans une direction opposée,
par le canal plus large ouvert entre Xile Robber et la côte nord de l’entrée de
la Baie, secondait notre marche, que les vents de S .O. rendaient rapide. Le ciel
était superbe. Il était midi-, c’était un dimanche. Tous les navires, au mouillage,
étaient parés de leurs pavillons. Nous jetâmes nos ancres près d’eux ; nos voiles
s’abattirent tout à coup avec une précision parfaite. Nous n’attendîmes plus,
pour descendre à terre, que la visite de la santé et du capitaine du port. L’attente
ne fut pas longue ; au reste, elle n’était pas désagréablé. Je partageais
moi-même assez puérilement la satisfaction de nos jeunes officiers, un peu
fiers de leur élégante manoeuvre.
Les formes des Montagnes qui ferment au S . O ., au S ., au S . E . , et à l’E . ,
la Baie de la Table, sont tellement caractérisées qu’il est impossible de les mal
figurer ou de les mal décrire. La Montagne de la Table, comme un immense
rideau tendu dans le S .E . , occupe cette partie de l’horizon (Pl. IV, fig. 2 et
3 l|ïïSes pentes inférieures paraissent assez douces; mais à partir de la moitié
de sa hauteur, ses escarpements, presque à pic, semblent la rendre tout-à-
fait inaccessible^ Ce n’est en effet que par une fissure profonde et cachée
(Pl. IV, fig. 2) qu’on en peut atteindre le sommet. La Montagne du Diable
(Pl. IV, fig. i,.*2 et 3 \, dont la hauteur verticale est à peu près pareille,
mais dont le sommet aigu, déchiré, contraste fortement avec la forme aplatie
de la Table, en est séparée au N.E. par un col assez large, mais quine semble
qu’une crevasse dans quelques aspects! Au fond de la Baie, sur les bords de
laquelle la ville du Cap est bâtie, se trouve un autre col in f in im e n t plus large
et plus profond, ouvert de l’E. à l’O. entre la Table et une Montagne conique
beaucoup moins élevée, qu’on appelle la Tête du Lion (Pl. IV, fig. 1,
2, 3 et Pl. V). Celle-ci s’abaisse vers le N.O. en une longue et large croupe
qui se relève un peu, à son extrémité, en une grosse colline arrondie; c’est la
Croupe duLion (Pl.IV, fig. 1 , 2, 3 ). La Tête du Lion {Lions Head, appelée
aussiSugar Loaf ) et la Croupe du Lion (Lions Rump) ne forment ainsi qu’un
système. Ce sont les terres les plus occidentales qui ferment aux vents d’O.
et de S.O. l’entrée de la Baie de la Table. La Pointe-Verte ( Green-Point )
n’est qu’une pointe de terre basse qui s’avance un peu vers la mer, tout autour
de la Croupe du Lion.
Ces dénominations expressives ont été imposées sans doute à ces Montagnes
par les navigateurs qui les apercevaient pour la première fois en venant d’Eu