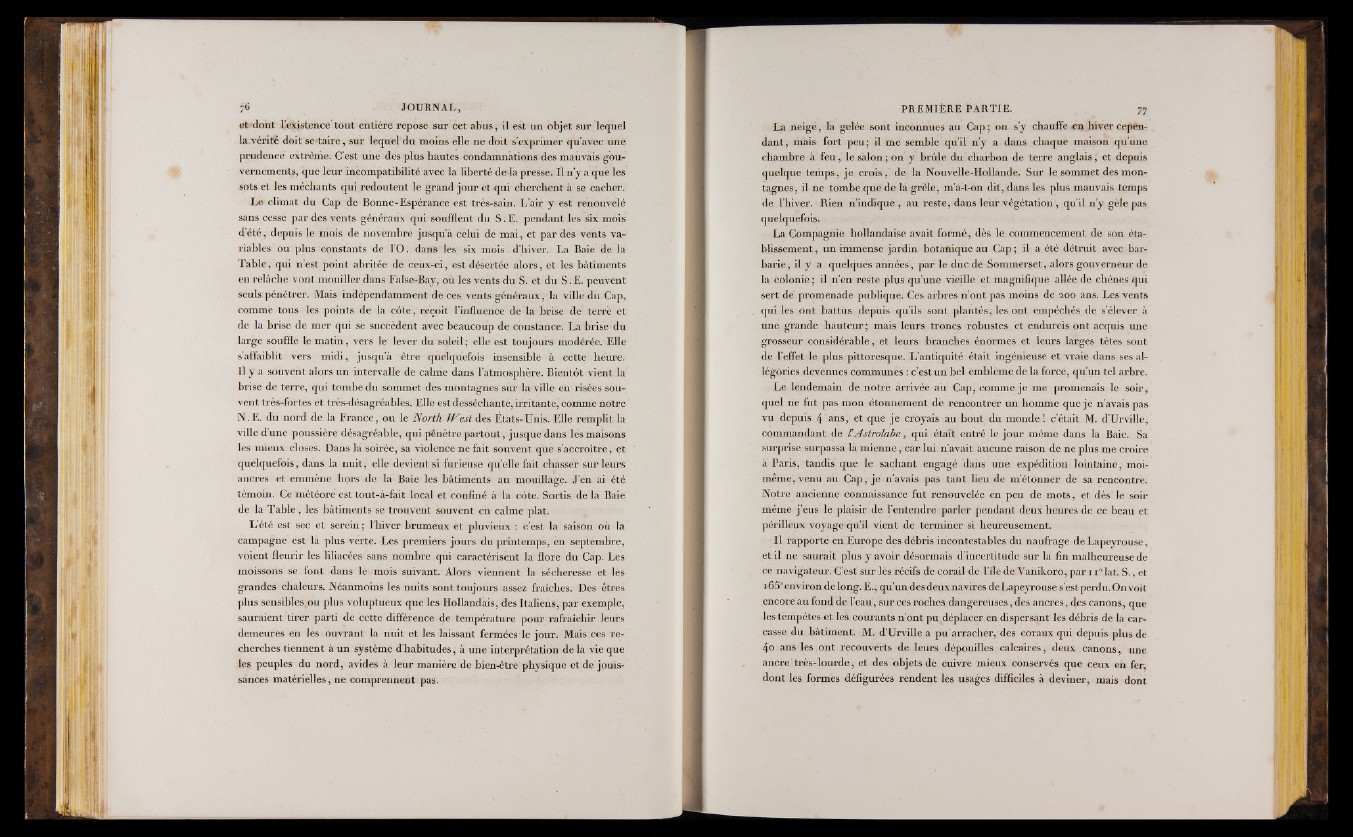
et dont l’existence tout entière repose sur cet abus, il est un objet sur lequel
la.vérité doit sectaire, sur lequel du moins elle ne doit s’exprimer qu’avec une
prudence extrême. C’est une des plus hautes condamnations des mauvais gouvernements,
que leur incompatibilité avec la liberté de-là presse. Il n’y a que les
sots et les méchants qui redoutent le grand jour et qui cherchent à se cacher.
Le climat du Cap de Bonne-Espérance est très-sain. L’aif y est renouvelé
sans cessé par des vents généraux qui soufflent du S ; E. pendant les Üx mois
dété, depuis le mois de novembre jusqu’à celui de mai, et par dés vents variables
ou plus constants de l’O . dans les six mois d’hivér. La Baie de la
Table, qui n'est point abritée de ceux-ci, est désertée alors, et les bâtiments
en relâche vont mouiller dans False-Bay, où les vents du S. et du S.E. peuvent
seuls pénëtrer. Mais indépendamment de ces vents généraux,Ta ville du Cap,
comme tous les points de la cote , reçoit l’influence de la brise de terré et
de la brise de mer qui se succèdent avec beaucoup de constance. La brisé du
large souffle le matin, vers le lever du soleil; elle est toujours modérée. Elle
s’affaiblit vers midi, jusqu’à être quelquefois insensible à cette heure.
Il y a souvent alors un intervalle de calme dans l’atmosphère. Bientôt vient la
brise de terre, qui tombe du sommet des môntagnes sur la ville en risées souvent
très-fortes et très-désagréables. Elle est desséchante, irritante, comme notre
N.E. du nord de la France, ou le North West des États-Unis. Elle remplit la
ville d une poussière désagréable, qui pénètre partout, jusqùe dans lés maisons
les mieux closes. Dans la soirée, sa violence ne fait souvent que s’accroître, et
quelquefois, dans la nuit, elle devient si furieuse qu’elle fait chasser sur leurs
ancres et emmène hors de la Baie les bâtiments au mouillagOe. J’en ai été
témoin. Ce météore est tout-à-fait local et confiné à la côte. Sortis de la Baie
de la Table, les bâtiments se trouvent souvent en calme plat.
L’été est sec et serein ; l’hiver brumeux et pluvieux : c’est la saison où la
campagne est la plus verte. Les premiers jours du printemps, en septembre,
voient fleurir les liliacées sans nombre qui caractérisent la florè du Cap. Les
moissons se font dans le mois suivant. Alors viennent la sécheresse et lés
grandes chaleurs. Néanmoins les nuits sont toujours ¡assez fraîches. Des êtres
plus scnsibles/m plus voluptueux que les Hollandais, des Italiens, par exemple,
sauraient tirer parti de cette différence de température pour rafraîchir leurs
demeures en les ouvrant la nuit et les laissant fermées le jour. Mais ces recherches
tiennent à un système d’habitudes, à une interprétation de la vie que
les peuples du nord, avides à leur manière de bien-être physique et de jouissances
matérielles, ne comprennent pas.
La neige, la gelée sont inconnues au Cap ; on s’y chauffe en hiver cependant
, mais fort peu ; il me semble qu’il n’y a dans chaque maison qu’une
chambre à feu, le sàlon; on y brûle du!charbon de terre anglais; et depuis
quelque temps, je crois , de la Nouvelle-Hollande. Sur le sommet des montagnes,
il ne tombe que de la grêle, m’a-t-on dit, dans les plus mauvais temps
de l’hiver. Rien n’indiqué , au reste, dans leur végétation, qu’il n’y gèle pas
quelquefois.
La Compagnie hollandaise avait formé, dès le commencement de son établissement,
un immense jardin botanique au Cap; il a été détruit avec barbarie,
il y a quelques années', par le dùc de Sommerset, alors gouverneur de
la colonie ; il n’en reste plus qu'une vieille et magnifique allée de chênes qui
sert de promenade publique. Ces arbres n’ont pas moins de 200 ans. Les vents
qui les .ont battùs depuis qu’ils sont plantés, les ont empêchés de s’élever à
une grande hauteur; mais leurs troncs robustes et endurcis ont acquis une
grossèur considérable , et leurs branches énormes et leurs larges têtes sont
de l’effet le plus pittoresque. L’antiquité était ingénieuse et vraie dans ses allégories
devenues communés : c’est un bel emblème de la force, qu’un tel arbre.
Le lendemain de notre arrivée au Cap, comme je me promenais le soir,
quel lie fut pas mon étonnement de rencontrer un homme que je n’avais pas
vu depuis 4 ans, et que je croyais au bout du monde ! c’était M. d’Urville,
commandant de tAstrolabe, qui était entré le jour même dans la Baie. Sa
surprise surpassa la mienne, car lui n’avait aucune raison de ne plus me croire
à Paris, tandis' que le sachant engagé dans une expédition lointaine, moi-
meme, venu aù Gap, je n’avais pas tant lieu dé m’étonner de sa rencontré.
Notre ancienne connaissance fut renouvelée en peu de mots, et dès le soir
même j’éus le plaisir de l’entendre parler pendant deux heures de ce beau et
périllèux voyage qu’il vient de terminer si heureusement.
Il rapporté en Europe des débris incontestables du naufrage. de Lapeyrouse,
et il ne saurait plus y avoir désormais d’incertitude sur là fin malheureuse de
ce navigateur. C’est sur les récifs de corail de l’ilc de Yanikoro, par 11 “ lat. S., et
i>65” environ de long. E., qu’un des deux navires de Lapeyrouse s’est perdu. On voit
encore au fond de l’eau , sur ces roches dangereuses, des ancres, des canons, que
les tempêtes et les coürants n’ont pu déplacer en dispersant lés débris de la carcasse
du bâtiment! M. d’Urville a pu arrachér, des coraux qui depuis plus de
4o ans les ont recouvérts de leurs dépouilles calcaires, deux canons, une
ancre très-lourde, et des objets dé cuivre mièux conservés que Ceux en fer,
dont les formes défigurées rendent les usages difficiles à deviner, mais dont