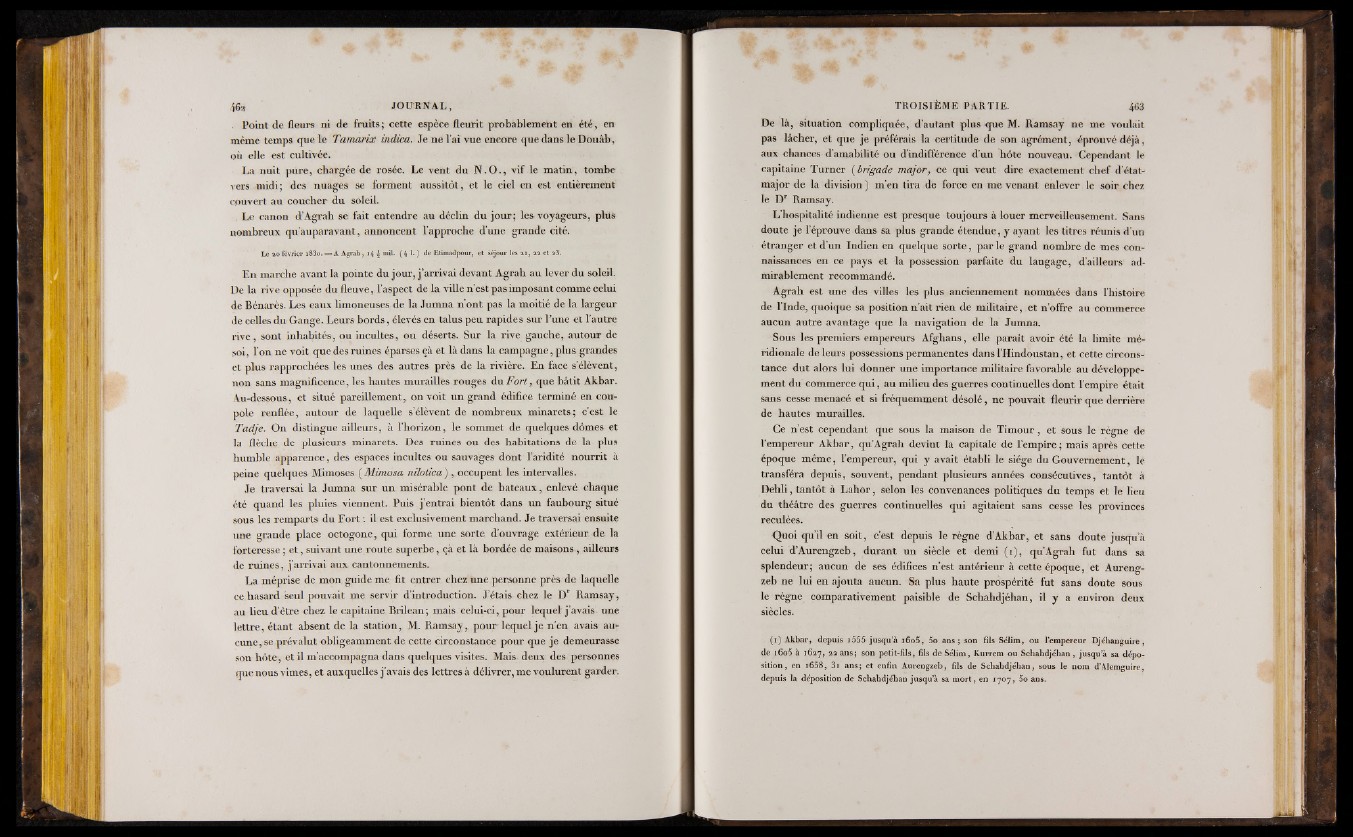
. Point de fleurs ni de fruits ; cette espèce fleurit probablement en été, en
même temps que le Tamarix indica. Je ne l’ai vue encore que dans le Douâb,
où elle est cultivée.
La nuit pure, chargée de rosée. Le vent du N .O . , v if le matin, tombe
vers midi; des nuages se forment aussitôt, et le ciel en est entièrement
cpuvert au coucher du soleil.
, Le canon d’Agrah se fait entendre au déclin du jour; les voyageurs, plus
nombreux qu’auparavant, annoncent l’approche d’une grande cité.
Le ao février i 83o. — À Agrah, 14 ^ mil. ( 4 !• ) de Etimadpour, et séjour les a i, aa et a3.
En marche avant la pointe du jour, j ’arrivai devant Agrah au lever du soleil.
De la rive opposée du fleuve, l’aspect de la ville n’est pas imposant comme celui
de Bénarès. Les eaux limoneuses de la Jumna n’ont pas la moitié de la largeur
de celles du Gange. Leurs bords, élevés en talus peu rapides sur l ’une et l’autre
riv e , sont inhabités, ou incultes, ou déserts. Sur la rive gauche, autour de
soi, l’on ne voit que des ruines éparses çà et là dans la campagne, plus grandes
et plus rapprochées les unes des autres près de la rivière. En face s’élèvent,
non sans magnificence, les hautes murailles rouges du .Fort, que bâtit Akbar.
Au-dessous, et situé pareillement, on voit un grand édifice terminé en coupole
renflée, autour de laquelle s’élèvent de nombreux minarets; c’est le
Tadje. On distingue ailleurs, à l’horizon, le sommet de quelques dômes et
la flèche de plusieurs minarets. Des ruines ou des habitations de la plus
humble apparence, des espaces incultes ou sauvages dont l’aridité nourrit à
peine quelques Mimoses (Mimosa nilotica), occupent les intervalles.
Je traversai la Jumna sur un misérable pont de bateaux, enlevé chaque
été quand les pluies viennent. Puis j ’entrai bientôt dans un faubourg situé
sous les remparts du Fort : il est exclusivement marchand. Je traversai ensuite
une grande place octogone, qui forme une sorte d'ouvrage extérieur de la
forteresse; e t, suivant une route superbe, çà et là bordée de maisons, ailleurs
de ruines, j ’arrivai aux cantonnements.
La méprise de mon guide me fit entrer chez une personne près de laquelle
ce hasard seul pouvait me servir d’introduction. J’étais chez le Dr Ramsay,
au lieu d’être chez le capitaine Brilean; mais celui-ci, pour lequel j ’avais une
lettre, étant absent de la station, M. Ramsay, pour-lequel je n’en avais aucune,
se prévalut obligeamment de cette circonstance pour que je demeurasse
son hôte, et il m’accompagna dans quelques visites. Mais deux des personnes
que nous vîmes, et auxquelles j ’avais des lettres à délivrer, me voulurent garder.
De là, situation compliquée, d’autant plus que M. Ramsay ne me voulait
pas lâcher, et que je préférais la certitude de son agrément, éprouvé déjà,
aux chances d ’amabilité ou d’indifférence d’un hôte nouveau. Cependant le
capitaine Turner ( brigade major, ce qui veut dire exactement chef d’état-
major de la division ) m’en tira de force en me venant enlever le soir chez
le Dr Ramsay.
L ’hospitalité indienne est presque toujours à louer merveilleusement. Sans
doute je l’éprouve dans sa plus grande étendue, y ayant les titres réunis d’un
étranger et d’un Indien en quelque sorte, par le grand nombre de mes connaissances
en ce pays et la possession parfaite du langage, d’ailleurs admirablement
recommandé.
Agrah est une des villes les plus anciennement nommées dans l’histoire
de l’Inde, quoique sa position n’ait rien de militaire, et n’offre au commerce
aucun autre avantage que la navigation de la Jumna.
Sous les premiers empereurs Afghans, elle paraît avoir été la limite méridionale
de leurs possessions permanentes dans l’Hindoustan, et cette circonstance
dut alors lui donner une importance militaire favorable au développement
du commerce q u i, au milieu des guerres continuelles dont l’empire était
sans cesse menacé et si fréquemment désolé, ne pouvait fleurir que derrière
de hautes murailles.
Ce n’est cependant que sous la maison de T imou r, et sous le règne de
l’empereur Akbar, qu’Agrah devint la capitale de l’empire; mais après cette
époque même, l’empereur, qui y avait établi le siège du Gouvernement, le
transféra depuis, souvent, pendant plusieurs années consécutives, tantôt à
Dehli, tantôt à Lahor, selon les convenances politiques du temps et le lieu
du théâtre des guerres continuelles qui agitaient sans cesse les provinces
reculées.
Quoi qu’il en soit, c’est depuis le règne d’Akbar, et sans doute jusqu’à
celui d’Aurengzeb, durant un siècle et demi ( i ) , qu’Agrah fut dans sa
splendeur; aucun de ses édifices n’est antérieur à cette époque, et Aureng-
zeb ne lui en ajouta aucun. Sa plus haute prospérité fut sans doute sous
le règne comparativement paisible de Schahdjéhan, il y a environ deux
siècles.
(r) Akbar, depuis 1555 jusqu’à i 6o5, 5o ans ; son fils Sélim, ou l’empereur Djéhanguire,
de i6o-5 à 1627, aa ans; son petit-fils, fils de Sélim, Kurrem ou Schahdjéhan , jusqu’à sa déposition,
en i658, 3i ans; et enfin Aurengzeh, fils de Schahdjéhan, sous le nom d’Alemguire,
depuis la déposition de Schahdjéhan jusqu’à sa mort, en 1707, 5o ans.